PHILIPPE VILAIN s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai LA LITTÉRATURE SANS IDÉAL (Grasset, 2016) :
1 – Vous publiez un essai, La Littérature sans idéal, que l’on peut d’ores et déjà considérer comme un ouvrage d’une grande valeur critique en cela qu’il nous permet de faire – comme très peu d’essais jusqu’à présent – la différence saisissante entre l’œuvre de Céline et celle de Proust, mais surtout, entre leur impact sur la langue et l’écriture, et donc de comprendre ce qui est arrivé à la littérature dans la société française depuis un demi-siècle. Il serait long ici de détailler cette étude que vous livrez, mais elle est détentrice d’une pertinence que nous pensons éclairante quant à la situation que nous vivons actuellement devant la publication – par milliers – de tous ces petits romans dont la « finalité est commerciale », et ces quelques œuvres remarquables qui, bon an mal an, parviennent à voir le jour, mais sans plus passionner les critiques ni les lecteurs alors même que ces dernières constituent le véritable défi de notre littérature ainsi que sa grandeur artistique. Pouvez-vous revenir sur la conception de votre essai : qu’est-ce qui en a déclenché l’écriture ? Comment l’avez-vous envisagé au regard même de votre démarche d’écrivain et de votre œuvre romanesque ? Pour vous, cet « art français de ne plus écrire » d’œuvres ambitieuses quant au style et à l’immanence de sa langue pour produire, à la place, cette prose désincarnée et impersonnelle si commune aux œuvres actuelles (« raconter une histoire en axant le récit sur l’émotion pour faire entendre une morale positive »), est-il symptomatique de toutes les sociétés, ou sommes-nous particulièrement plus touchés en France qu’ailleurs où il semblerait (Asie, Amérique du Nord et du Sud) qu’il s’y produise encore des œuvres importantes ? En quoi cela vous paraît-il souligner une gravité plus particulière, plus aiguë, voire plus problématique, chez nous par rapport aux autres pays ?
Je crois que ce qui a motivé l’écriture de cet essai est tout à la fois mon amour pour la littérature et ma passion de comprendre les choses, de tout vouloir intellectualiser. J’avais besoin de prendre de la distance par rapport à ma propre pratique littéraire, de faire une pause dans l’écriture de mes romans pour observer le paysage littéraire contemporain, voir ce qui s’y passait. C’était important pour moi de faire ce travail, de dire ce que je voyais, ce qui me semblait, ce que je pensais, de décrire l’évolution du paysage dans lequel je vis depuis 1997, et de le faire sans aprioris idéologiques, en essayant de construire un raisonnement méthodique, lucide, honnête, sans concession. Ce travail me semblait faire partie de mon devoir d’écrivain, de mes obligations de citoyen de la littérature. C’était pour moi un acte de résistance intellectuelle, une façon de m’indigner par rapport à la démagogie ambiante et à une bien-pensance généralisée, intellectuellement paresseuse aussi, à laquelle il est toujours tentant de s’abandonner. Je voulais comprendre la manière dont la littérature s’appréhende à travers les phénomènes d’hyper-démocratisation et d’industrialisation culturelles, vérifier si, oui ou non, la littérature a bien perdu son idéal littéraire au profit d’un idéal commercial ; si elle a perdu sa croyance en un idéal poétique supérieur ; si la production littéraire obéit bien à cette crise de la culture analysée par Hannah Arendt au début des années 60.
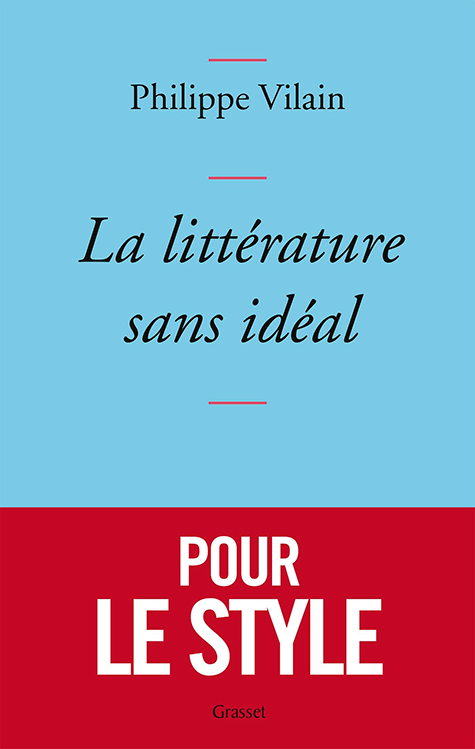
Disant cela, évoquant cette crise, je ne me sens pas du tout pessimiste et je ne veux pas dire que je ne crois plus à la littérature à laquelle j’ai consacré mes longues études doctorales et une bonne partie de ma vie, cette littérature qui reste pour moi un idéal de culture et n’est pas un simple divertissement culturel ; je ne veux pas dire non plus qu’il n’existe plus de bons écrivains (au hasard, j’aime et je lis Pierre Michon, Pascal Quignard, Annie Ernaux, Patrick Modiano, Philippe Forest, Pierre Jourde, Dany Laferrière, Pierre Bergounioux, Emmanuel Carrère, Richard Millet, Dominique Fernandez, Alain Fleischer, ou, plus près de nous, la relève, Maylis de Kerangal, Serge Joncour, Lorette Nobécourt, Éric Chevillard, Arnaud Guillon, Jean-Baptiste del Amo, Catherine Cusset, Laurent Mauvignier, Mathias Énard, Vincent Almendros, Mathieu Riboulet, Christine Montalbetti, Christian Garcin, Philippe Claudel, Jean-Marc Parisis, et d’autres que j’oublie, comme le trop méconnu Alain Spiess, malheureusement décédé il y a peu), juste que ces auteurs, tendus vers la réalisation d’une œuvre, faisant de l’écriture un enjeu poétique majeur, constituent une minorité littéraire au cœur de l’hyper-production littéraire.
Lisant beaucoup de littérature contemporaine, pour mon plaisir et selon les recherches que je suis amené à faire, plusieurs aspects de cette littérature me frappent. D’abord, la revendication d’autonomie de cette littérature, son déshéritage, sa prétention à naître de rien qui traduit soit sa méconnaissance de l’histoire littéraire, soit un déni volontaire de cette histoire. Cette littérature contemporaine semble, en effet, ne plus avoir de conscience historique, et, orgueilleuse, ne veut plus se reconnaître de modèle. Le sentiment et l’emprise de son histoire littéraire ont disparu au profit d’un goût présentiste pour l’immédiateté, narcissique pour son époque. Ce phénomène de récusation de l’histoire est intéressant dans la mesure où il permet de poser deux questions essentielles : comment écrire l’histoire d’un temps qui récuse son histoire ? Qu’est-ce qu’écrire, incarner son histoire ou représenter son temps ? Ensuite, le second aspect de cette littérature est sa vénération du réel, son fantasme de l’apocalypse, comme en témoignent les fictions du réel : l’autofiction comme mythologie personnelle, la biofiction sacre des triomphants et le docufiction ou le journalisme littéraire. Cette vénération permet paradoxalement la création d’un nouveau moment littéraire, que j’ai appelé le Post-réalisme.
À ce constat, sans doute symptomatique de la mutation culturelle de la littérature contemporaine, il faudrait ajouter un autre, plus essentiel, qui exprimera mieux que tout débat l’option prise par cette littérature : sa mise en question de l’idéal esthétique, du sacré de la langue qui n’est plus l’enjeu de la littérature, qui n’est plus fétichisée. Nombre de romans, oralisés, semblent écrits par les voix anonymes, sans nécessité, de la Kulturindustrie. Il semble que la littérature entretienne désormais un lien faible à l’écriture, qu’elle se construise sur un ressentiment de la langue, sur l’irréligion de son Verbe. L’écriture ne cherche plus à s’écrire, elle s’oralise dans une prose sans reliefs et sans aspérités, selon les règles d’un désécrire et des modes simplifiés trahissant sa non-nécessité de faire de la langue son enjeu. La tendance oralisante de la langue qui, tout écrivain confirmé le sait, est la tendance scripturale la plus accessible, celle du débutant – ce qui n’exclut ni que cette tendance produise des chefs-d’œuvre ni qu’elle ait son excellence. Le problème n’est pas que cette tendance existe – elle a toujours existé – mais qu’elle se soit systématisée, vraisemblablement pour se formater aux lois du marché. Si le marché du livre se porte bien, la littérature, elle, c’est un fait, se vend beaucoup moins. Elle doit, pour se vendre et séduire le consommateur, ne pas devenir trop littéraire, c’est-à-dire trop écrite, elle doit oraliser son écriture comme standardiser ses genres (tyrannie du réel, docufiction, biofiction, autofiction), mondialiser ses formes narratives comme internationaliser son écrire. La littérature la plus vendeuse est presque toujours, à quelques exceptions près (l’excellent Mathias Énard, est un contre-exemple), la plus accessible, dont la langue est la plus traduisible. Ce constat du désécrire entraîne, par voie de conséquence, d’autres phénomènes observables, que j’ai tenté d’expliquer dans La Littérature sans idéal :
A – Soucieuse de se conter, adepte du storytelling, aliénée à sa propre marchandisation, la littérature se donne moins l’intention de penser, de réfléchir le monde, elle s’en fait l’illustration, le reflet, le miroir, à peine différemment, finalement, du projet réaliste des écrivains du XIXe siècle, de l’intention de peindre le monde tel qu’il est.
B – L’écrivain réduit sa dimension au racontage, sans plus s’intéresser et se soucier du sort de son art, sans plus s’interroger sur sa pratique. Ses textes sont de plus en plus illustratifs et de moins en moins réflexifs – la disparition de la littérature d’analyse n’est, à ce titre, pas un hasard.
C – Dans leur majorité, les écrivains ne sont plus des penseurs, mais des raconteurs d’histoire. L’écrivain total, tels que pouvaient l’être des écrivains comme Gide, Camus, Sartre, Gracq, et d’autres, se réduit à n’être plus qu’un simple romancier. C’est que l’écrivain ne s’engage plus en littérature. Il n’est pas forcément concerné par la littérature elle-même, pas nécessairement un grand lecteur. De fait, la conscience critique, historique, c’est-à-dire également politique, de son art est limitée. D’ailleurs, l’écrivain exerce le plus souvent son activité d’écriture dans un contexte amateur, en dehors et en marge de sa véritable activité professionnelle, comme une activité parallèle. Ainsi, pour nombre d’écrivains, la littérature n’est plus un engagement, mais une passion assouvie dans le cadre de loisirs actifs, elle est un supplément en même temps qu’un outil de distinction sociale. Cette restriction du statut de l’écrivain, sa déprofessionnalisation, l’amoindrissement de ses prérogatives expliquent en partie la délittérarisation de la littérature, sa simplification.
Ce qui me paraît grave et problématique, en fait, ce n’est pas tant l’existence de cette crise, que sa négation. Le problème n’est pas tant, en effet, que la littérature soit devenue un divertissement culturel, mais que la plupart de ses principaux acteurs – écrivains, éditeurs, critiques, libraires – ne veuillent pas le reconnaître. La littérature préfère ainsi ne pas regarder l’infidélité qu’elle fait au littéraire, en continuant d’entretenir un double-discours mensonger à son propos : ainsi toute littérature serait littéraire, et tout plumitif serait écrivain. Le mensonge de la littérature est d’adopter une vision pan-littéraire démagogique qui refuse l’idée d’un classement de sa production pour mieux dissimuler que, dans la réalité, ce classement existe : il suffit de constater l’importance accordée, par tous les acteurs du monde du livre, au classement des meilleures ventes pour s’en rendre compte : ce classement détermine l’économie future du livre et sa médiatisation : puisque les médias solliciteront davantage un livre qui fait le buzz ; puisque les prix récompenseront d’abord un livre qui se vend déjà et dont la notoriété impactera, en retour, sur le prix lui-même (il est très rare qu’un prix récompense un livre qui ne fonctionne pas commercialement et qui n’a pas dépassé au moins 10 à 15 000 exemplaires ; puisque un livre qui se vend sera favorisé pour les traductions, etc. Ce classement structure pourtant l’économie même de la littérature contemporaine : pourquoi le nier ? On peut s’interroger, par ailleurs, sur la moralité de ce classement publié dans les journaux – un peu comme si, sur la porte d’entrée de l’entreprise, on affichait la grille des salaires des employés -, sur son éthique qui réduit la littérature à son aspect le plus marchand, qui montre toute l’injustice du système où seul ce qui vend semble valoir. Qu’on le veuille ou non, l’argument commercial tient désormais lieu d’argument littéraire : on pardonnera à un roman de ne pas être littéraire s’il se vend, mais on ne pardonnera pas à un roman littéraire de ne pas se vendre. Que la reconnaissance et la légitimité littéraires passent en premier lieu par un succès commercial en dit long sur le cynisme de la pensée ultralibérale qui préside aux destinées de la littérature contemporaine ! En réalité, la littérature est obsédée par sa valeur marchande, c’est sans doute pour cette raison qu’elle s’efforce de le dénier, mais c’est aussi en cela que la littérature est foncièrement pessimiste : parce qu’elle ne croit plus à son pouvoir littéraire, parce qu’elle a perdu son idéal poétique.

2 – À ce titre, vous abordez une question qui, sans doute, est le cœur du problème : la systématisation, par une majorité d’auteurs, d’un usage singulatif du temps au détriment d’un usage itératif, à savoir d’un présent de « facilité » et de « l’incapacité à rompre avec soi-même » au détriment d’un passé permettant « l’enjeu même d’une réflexion sur le temps » qui, précisément, donne toute leur dimension esthétique aux œuvres comme cette bonne distance avec soi-même qui soulignerait la qualité et la pertinence d’une pensée. Soulignons que l’usage singulatif est celui de Céline tandis que l’itératif est celui de Proust. Cette comparaison que vous parvenez à établir concernant ces deux usages du temps illustrerait à vos yeux – depuis que l’œuvre de Céline l’aurait emportée sur celle de Proust – le process de dévaluation et d’appauvrissement de l’écriture dans la littérature depuis le milieu du 20e siècle. Ne peut-on pas, pour autant, considérer que ce process est réversible et qu’avec d’autres effets de mode et d’habitus, cet usage singulatif passera tout autant, finalement, que cette passion, étrangement hystérique, pour l’œuvre de Céline ? Ne pouvons-nous pas également considérer que cet usage singulatif n’est pas le seul fait de la reconnaissance de l’œuvre de Céline sur celle de Proust mais, plus communément, de la volonté d’une majorité d’auteurs publiés s’estimant « écrivains » et qui – sans œuvre singulière ni marquante – se glorifient et se réclament précisément de cet « art français de ne plus écrire », ceux-ci ayant plutôt choisi l’écriture pour assouvir leur égo que pour faire prendre des risques à leur écriture afin que celle-ci œuvre réellement pour et dans la littérature ? À cet égard, n’est-ce pas Céline qui rappelait que, pour écrire une œuvre digne de ce nom, il fallait mettre sa peau sur la table car « si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n’avez rien. Il faut payer ! » ? Pouvez-vous revenir pour nous sur cet enjeu des usages singulatif et itératif et la manière dont vous envisagez l’avenir par rapport à ce constat que vous avez établi ?
Là encore, il s’agit d’une observation. Le singulatif (raconter une fois ce qui est arrivé une fois) est le mode dominant de la littérature contemporaine qui s’écrit selon un régime narratif élémentaire, un mode programmatique reproductible à l’envi, fabriqué selon une alternance de descriptions et de dialogues, une utilisation systématique du récit singulatif, une thématisation des personnages par leur nom indiquant leur entrée dans le romanesque, un modèle rhétorique d’intrigue établi suivant le procédé nouement/dénouement de l’action/transformation en drame, une certaine impersonnalité du style et une ambition récréative. La littérature a renoncé à utiliser des temps et des modes exigeants, plus abstraits, comme l’imparfait d’habitudes et l’itératif (raconter une fois ce qui nous est arrivé plusieurs fois). En effet, si une des finalités de la littérature est de donner forme au temps, si écrire est une façon de lutter contre le temps, le plus beau legs de l’auteur de La Recherche du temps perdu demeure le mode temporel infiniment abstrait, philosophique et hypermoderne de l’itérativité, qui consiste en une répétition syncrétique, totalisante, des temps en un seul.
Au moins pour cet usage, la Recherche marque, en effet, un tournant dans l’histoire de la littérature puisque, après elle, la littérature entre dans ce nouveau règne que j’ai appelé le règne du singulatif, dominé non seulement par l’injonction de ne plus écrire au passé, mais aussi par le renoncement à s’envisager dans le temps de façon abstraite et à envisager la littérature comme une œuvre totalisante, thématiquement et stylistiquement homogène : l’après Proust, en effet, privilégie dans son ensemble, la forme fragmentaire, le mode singulatif, la préhension émotive d’un temps à dimension et à perspective restreintes, soit la pratique d’une littérature expressive plus que réflexive, émotive plus qu’intellectuelle. La littérature privilégie la facilité des temps de son expression sur l’exigence des temps de son raisonnement, comme si elle n’avait plus ni la patience ni les compétences de réapprendre une écriture laborieuse qui requiert une maîtrise technique supérieure de la langue et de la narration, comme un effort d’abstraction conséquent. C’est ainsi qu’avec l’usage d’une forme grammaticale et d’un type de discours, une forme de l’expérience humaine se perd et disparaît de la littérature ; la systématisation du singulatif, au détriment de l’itératif, signale un appauvrissement objectif des ressources de l’écrivain.
Pour reprendre l’analyse de La Littérature sans idéal, je dirais que la littérature choisit de traiter le temps de manière présentiste et singulative, de faire un usage réducteur, simplifié, pour ne pas dire simpliste du temps : un narrateur raconte au présent, ou dans un présent dérivé (passé composé) ce qui lui arrive : son présent, constatif, se borne à dire et décrire l’actualité, sans se rétroprojeter ou se projeter, sans dire le passé ou s’envisager dans le futur, comme pour concurrencer l’actualité, restreindre le décalage entre ce qui vient de survenir et ce qui s’écrit. Le présent singulatif, qui est un présent de facilité, est le temps de la continuité intérieure, le temps qui prolonge sa propre vie dans l’écriture et qui ne veut pas se terminer, c’est le temps de l’impossible sublimation et de l’incapacité à rompre avec soi-même. C’est le temps du direct, du live où tout doit se vivre à peu près en même temps que s’énoncer. Avec ce présent-là, sans habitudes, qui ne fait accéder à aucune profondeur, qui fait glisser les mots sur les vitres du temps, les laisse vide ou entrer en résonance avec la seule actualité de leur énonciation, les restreint à leur fonction illustrative, la littérature singulative s’est choisie le temps de son handicap, de son incapacité à s’abstraire, et, partant, la voie d’une certaine défaite de sa pensée, d’une résignation à ne plus réfléchir, à ne plus se réfléchir. La littérature singulative a perdu sa réflexivité, puisqu’il n’est plus question pour elle de se donner l’ambition de penser directement, d’analyser, puisqu’il n’est plus question pour elle que de montrer et d’illustrer, par une succession de scènes et d’images supposées receler en elles-mêmes une potentialité réflexive. Il semble bien que la littérature de pensée ait perdu depuis longtemps la guerre contre la littérature du montrer, et que ne domine plus, au fond, dans la pratique de la littérature, que l’efficace et trop restrictive leçon enseignée dans les ateliers d’écriture américains, « Creative writing », retenue par l’écrivain de best-sellers, Katherine Pancol : « On n’écrit pas : un homme est triste. On montre pourquoi il est triste » (« Katherine Pancol : Petites confidences entre amis », par Tatania de Rosnay, Journal du Dimanche, 15 juillet 2012). Le roman n’entend plus donner à penser mais donner à voir, montrer la nature telle qu’elle est. C’est aussi en cela que, depuis Proust, la littérature a perdu son temps. Elle n’a pas évolué, croyant le faire, parce qu’à vouloir guerroyer l’académisme on ne finit que par en recréer un autre, en refonder un sur des bases standardisées, commercialement formatées, admissibles par le plus grand nombre, sur des conventions commerciales communément partageables : la littérature de ces dix dernières années s’est en effet, et ainsi, restreinte à une pratique singulative du montrer.

3 – D’un côté, vous déplorez l’absence de style dans la langue de la littérature actuelle et, de l’autre, vous estimez que le style d’un Céline pose un véritable problème, notamment, du fait que l’ambivalence de son discours remplacerait le jeu des contradictions de la langue, à la manière où, comme l’a magistralement exposé le philosophe Christian Godin (La Totalité, Champ Vallon, 1997), lorsqu’on préfère la syntaxe à la sémantique, on se retrouve finalement à offrir l’exemple consternant de défendre des négationnistes – tel Chomsky – estimant qu’après tout, leur discours n’est qu’un discours, donc un discours comme un autre. Christian Godin argue ainsi – rejoignant par là votre propre démonstration – que, « dans le même sens, on a célébré Céline, non sans raison, comme un écrivain majeur de notre siècle. Mais alors, il convient d’en tirer les conséquences, et de constater qu’il aura en somme manqué à Mein Kampf d’être écrit en beau style. On ne hait pas le sens impunément ». Pouvez-vous ainsi revenir pour nous sur cette notion de « style » : qu’est-ce que devrait être le style en littérature aujourd’hui ? Sur quoi reposerait-il, à vos yeux, en dehors des usages singulatif et itératif ? Comment faire la différence d’un style qui en serait un avec un autre qui cacherait, de par la manière stylisée de son langage, une parfaite absence de style ?
Ce n’est pas tant l’absence effective de style que je déplore que l’intention de ne pas faire de la langue un enjeu poétique, car l’absence de style, si et seulement si elle est intentionnelle, voulue, affirme en soi un style : que l’on se rappelle simplement la neutralité d’écriture des Nouveaux Romanciers, ou celle de L’Étranger de Camus, formidables exemples de non-styles érigés en styles. Et, par style, il est utile de préciser que je n’entends pas le « bien écrire » – qui ne veut rien dire en soi -, mais la justesse d’un écrire accordé à son être comme à son sujet, l’intention d’une élaboration stylistique témoignant à la fois d’une maîtrise technique et d’un savoir sur la littérature. Il se trouve que la dominance de l’écriture oralisée dans la littérature contemporaine témoigne peu de cette maîtrise et de ce savoir, et que cette manière est aussi la plus accessible, la plus spontanée, la plus facile à adopter lorsque l’on écrit parce qu’elle requiert le moins de temps. Il suffit, pour s’en convaincre, de faire le test dans un atelier d’écriture en proposant deux manières d’écrire antagoniques, l’écriture rationnelle et l’écriture expressive : la tendance ira à la seconde manière. Je ne veux pas dire que la manière oralisée n’a pas ses difficultés et son excellence, juste que cette manière requiert moins de compétences littéraires et de temps. Or, ce qui distingue l’écriture de la parole est précisément le temps : de maturation, d’immersion et de conception. L’écriture oralisante, elle, abolit ce temps pour concurrencer la simple parole, son urgence et sa spontanéité. L’exemple de Marguerite Duras, qui est passé par une langue académique pour finir son œuvre par une « écriture courante », très orale, est intéressante, parce que cette écriture courante est l’aboutissement d’un processus d’écriture et la réalisation de toute une œuvre, mais si « l’écriture courante » avait dominé l’œuvre de Duras, cette œuvre aurait été de peu d’intérêt littéraire.
Je n’ai absolument rien contre la littérature de Céline, même si celle-ci n’est pas du tout mon goût, à laquelle je reconnais même un certain génie de la langue, une violence caractéristique du grand écrivain, mais j’en veux surtout à ses épigones, à ses suiveurs qui abusent des facilités de la pratique oralisée. Il faut sans doute avoir une certaine expérience d’écriture et s’être essayé aux deux manières d’écrire – le rationnel proustien et l’affect célinien – pour sentir la différence d’exigence entre ces deux pratiques d’écriture : la première, classique, analytique, privilégie la justesse et recourt à la réflexion ; la seconde, baroque dans sa forme, bavarde, pléthorique, privilégie l’expression de l’affect et admet, de fait, l’approximation du langage. Écrire selon Céline, c’est adopter une langue spontanée, affective, pour s’abandonner à une esthétique du parlé, c’est abuser de la fonction émotive du langage – celle que nous employons lorsque l’on écrit une lettre à un proche – pour faire crier en nous la petite voix de l’affect, la petite musique de mélomanes qui ne connaissent pas toujours le solfège. Une certaine idée de la littérature rationnelle, meurt avec cette prose de l’affect. Céline n’écrit pas, il déparle ; de temps à autres, il poétise, trouve dans l’argot des images et des échappatoires poétiques, il illustre, il hystérise, il hurle, rote et onomatopète par la langue, il vomit et sphinctérise la syntaxe, provoque pour faire criser la littérature. Sa modernité est de présenter le narrateur non plus comme une conscience réfléchissante mais comme un organisme vivant, non plus comme un scripteur mais comme un diseur cherchant sa respiration et une rythmique dont il fait remonter l’origine à la cadence du music-hall anglais (c’est là, prétend-t-il, que « j’ai pris mes trilles », non dans le « babillage » mais dans l’audace des gestes et des corps). Assurément, la technique célinienne est ingénieuse sans être géniale, elle repose sur une certaine richesse de trouvailles poétiques, une profusion étourdissante alternant la verdeur du langage populaire, la crudité argotique et les images poétiques, multipliant les effets par différents niveaux de langue qui harmonisent et unifient le récit. Si toute pratique possède son excellence, il est, cependant, des pratiques plus accessibles que d’autres, des esthétiques plus aisées à s’approprier, et ce n’est probablement pas un hasard si la littérature contemporaine s’est à ce point oralisée, célinisée d’une certaine façon, libérée de ses contraintes narratives en croyant naïvement se libérer de ses conventions, si l’écriture de l’affect gagne sur l’écriture de la raison, si le plus banal expressionnisme tient lieu de « style », si envahissent les proses oralisées, les parlottes diarrhéiques, les logorrhées défiguratives, les gloubiboulguiennes verbalisations immédiates, qui feignent d’embrasser le langage de leur temps dans le mouvement même où elles se relâchent, s’éloignent le plus de l’intelligible, se perdent dans une littérarité qui trouve absurde de faire sens, cherche son sens dans le non-sens et une conscience parlante, monologuant, démissionnant la raison (l’immense succès populaire des vulgarisations historiques de Jean Teulé, ex-animateur d’une émission de télévision pour enfants, en témoigne : Mangez-le si vous voulez, Charly 9 ou Héloïse, ouille !, scabreuse dérive des poétiques célinienne, rabelaisienne, bourdardienne, et de la bande-dessinée : « farcir à la bite », en « avoir ras la moule », « observe son cul », etc.). Sans doute Céline aura-t-il fait beaucoup de mal à la littérature contemporaine non tant en introduisant le langage parlé dans l’écriture, mais en donnant à ses épigones l’illusion que la littérature était une tâche aisée, qu’il suffisait de savoir s’exprimer pour savoir écrire.
Le style de Céline, censée tenir lieu de parole moderne, épocale, parlons-en ! Que Céline rompe avec la littérature dite « officielle », innove, doit être discuté, puisque la portée de son innovation procède de divers emprunts : on sait, d’ailleurs, que Céline innove moins qu’il rénove, pillant ici chez Flaubert son intention de faire du style le personnage central de ses romans, volant là à Joyce – qu’il dément avoir lu – sa manière oralisée, et, surtout, reprenant à Rabelais le projet de démocratiser la langue, de la débarrasser de ses conventions bourgeoises, académiques, en la scatologisant et en la rabaissant à une phonétique populaire, à un délitement syntaxique ; comme Rabelais, Céline livre des guerres pichrocholines à l’académisme de la langue. Dire que le rabelaisien Céline est moderne quand on refuse cette modernité à Proust, a, il est vrai, quelque chose de consternant, dans la mesure où rien n’est plus héritée que la prétendue modernité de Céline, rien n’est plus littérairement enracinée que sa langue. Là où le projet célinien semble cependant échouer, c’est dans son ambition de démocratiser la langue, dans cette même populiste revendication « antibourgeoise », qui soucieuse -ou feignant de l’être- de donner la parole à un peuple jugé habituellement indigne de figurer en littérature, ne fait, en réalité, que conforter les valeurs de l’idéologie bourgeoise dominante, dans la mesure où Céline ne cesse de déprésenter et caricaturer l’homme du peuple, de le montrer dans sa dimension la plus avilissante et haïssable, comme un misanthrope, raciste, vulgaire, lâche… ; Céline fait de l’homme du peuple un homo demens condamné à délirer dans un argot parigot ringard, à déparler dans une langue décultivée, abjecte, qui exprime sa propre faillite, la défaite de sa raison, son impossible transcendance, son inconcevable élévation. Céline ne réhabilite personne, il laisse ses personnages dans l’égout et le dégoût où il les a trouvés, dans l’aliénation où il les admet : point de rémission par la morale, de rédemption par le style, de salut par la poétique dont l’oralité régressive dégrade et déshumanise, se soumet à la dictée de son nihilisme, de son racisme social, de sa détestation du peuple.
De fait, il y a, je trouve, quelque chose de profondément ironique à constater que le grand lectorat choisit toujours Céline contre Proust et trouve précisément dans ce singeur méprisant de populace leur porte-parole. Car le médecin des pauvres – et je n’évoque même pas les thèses racistes que Céline soutenait : si le style est l’affirmation d’une vision du monde, il faudrait se demander comment on peut s’enticher d’un auteur comme Céline, de son style, sans cautionner la vision du monde qu’il défend, en faisant abstraction du sens que cette vision présente – n’est sans doute, si l’on y songe, qu’un écrivain pour les riches, dont le vœu de popularité œuvre facticement dans une langue parodique réduite à la dérision, et qui, en réalité, se donne avant tout comme une esthétique du dominé, une écriture du pauvre pour les littérateurs, une poétique décultivée destinée à des lecteurs cultivés capables de jouir de l’exotisme social et culturel qui, souterrainement y opère. Le populisme de Céline confine à un engagement esthétique stérile, à une provocation stylistique, à une poétique vide qui est loin d’avoir la dimension politique de la poétique d’un Genet, le chantre des bannis qui fait entendre subtilement leur voix dans une sublime langue classique volée, justement, à l’ennemi bourgeois : en quoi la poétique de Céline n’est pas performative comme celle de Genet, en quoi elle reste une pure expérience poétique, une pratique ludique des limites du langage qui, ce faisant, désengage son auteur, ne révolutionne aucun destin, ne solutionne ni ne transcende rien, n’offre d’issue à l’homme du peuple qu’une stagnation morbide dans l’abject, quand la poétique de Genet, elle, au contraire, l’engage, l’élève, le libère, le complexifie, opère une transcendance supérieure.
4 – Quel sont les conséquences de votre essai sur votre œuvre romanesque ? Vous pousse-t-il à une remise en question, à des doutes, à une volonté de reconsidérer votre projet, à un désir de recommencement… ou pas ? Pourquoi ?
Les conséquences directes de mon essai sur mon œuvre, je ne peux pas les envisager. Je continue d’écrire comme je l’ai toujours fait, en obéissant à la stricte nécessité d’écrire. D’ailleurs, mon prochain roman, qui sera publié en 2017 chez Grasset, concerne un genre que je décris dans La Littérature sans idéal : l’autofiction. Je reviens ainsi à une veine que j’avais quittée, pour raconter une histoire d’amour, infiniment romanesque, qui m’est arrivé il n’y a pas si longtemps. À mes yeux, il n’y a pas de sous-genres, et l’autofiction appartient bien à la littérature. Ce n’est pas parce que j’ai consacré un chapitre critique à l’autofiction que je la méprise, loin de là même, puisque que j’en ai écrit et que je continue d’en écrire. Il s’agissait de décrire un phénomène, non de le vilipender. Le problème que j’ai soulevé dans mon essai ne relève, à ce titre, pas tant des genres à proprement parler que de leur réalisation et de la manière de les mettre en écriture, de leur style et de leur intention poétique. On peut écrire une autofiction, un docufiction ou une biofiction de façon très littéraire, et on peut écrire, sans faire preuve de littérature, une fiction de pure imagination, lorsque l’auteur ne fait pas de l’écriture son enjeu et qu’il se laisse dominer par son sujet ; ce n’est pas le genre et le sujet choisi qui font la qualité d’un texte, mais son écriture, plus exactement, son style.
S’il y en a, les conséquences de cet essai seront peut-être indirectes, extra-littéraires. Je n’ignore pas les risques encourus en publiant cet essai, et je ne doute pas que m’exposer comme je l’ai fait, en dénonçant les insuffisances et les injustices de l’institution littéraire, en faisant un état des lieux critique de la littérature à laquelle je suis concerné, dont je suis moi-même un acteur, influera sur les critiques de mes prochains romans. Les personnes qui se sont senties visées ne manqueront pas de soumettre ma prose au miroir de mes analyses, et il n’est pas difficile d’imaginer que celles-ci ne me pardonneront pas grand-chose, qu’elles manqueront d’indulgence envers mes textes et que la moindre faille me sera fatale ; on voudra donner la leçon à celui qui, croyait-on, voulait en donner une. Tout cela est prévisible et fait partie du jeu, des risques du métier, si j’ose dire ! J’ai écrit cet essai sans me soucier des conséquences. Je n’ai pas une nature prudente, sans quoi je n’aurais pas consacré ma vie à l’écriture, et je n’ai pas cherché à construire des réseaux pour me protéger, je suis seulement un parieur qui a tout misé sur sa liberté et cette discipline aléatoire, subjective dans son appréciation, belle et violente, délicate et parfois injuste, qu’est la littérature. Au reste, l’important est ailleurs, il est que la littérature permette un débat ; et je suis heureux pour cela, de l’avoir initié. Cela dit, je ne dois pas me plaindre, j’ai reçu également beaucoup de soutiens d’écrivains, de critiques et d’éditeurs, d’universitaires et de quelques politiques même, comme quoi la littérature demeure un enjeu important de notre culture ; comme quoi mon état des lieux n’est peut-être pas si éloigné de la réalité. J’ai reçu des lettres de soutien et des textos d’encouragements de personnes publiques, dont je tairais évidemment les noms, et qui ne peuvent souscrire publiquement à mon propos, « de peur de se fâcher avec son époque et avec ses institutions », m’a écrit l’une d’elles. De mon côté, je n’ai pas de problèmes avec les critiques, elles sont vitales – lorsqu’elles sont intellectuellement honnêtes -, j’en ai déjà reçu depuis mon premier roman en 1997, – toutes n’étaient pas imméritées d’ailleurs ; étant exigeant avec moi-même, je suis le premier à considérer les insuffisances de certains de mes romans. Et puis, on n’écrit pas si l’on est sensible aux critiques. Publier, c’est s’exposer. Il faut savoir se blinder contre les critiques négatives, mais également contre les positives. Pour ma part, les éreintements comme les compliments ne m’agacent et ne m’enthousiasment guère plus d’une heure ; très vite, ceux-ci s’effacent en moi. Si la reconnaissance est indispensable pour continuer d’écrire et avoir une existence dans le paysage, celle-ci ne peut pas être une fin en soi. Je veux croire que l’on ait un autre idéal, qu’on écrive pour une bonne raison, comme donner du sens à sa vie, comprendre le monde ou construire une œuvre par exemple (je n’ai pas d’autres ambitions pour ma part : depuis quelques années, je songe à écrire un texte-somme, ce que j’appelle mon « texte définitif », que j’ai décrit dans mon essai, Le Paradoxe de l’écrivain (figurant dans l’ouvrage universitaire consacré à mon travail : Philippe Vilain ou la dialectique des genres, sous la direction d’Arnaud Schmitt et Philippe Weigel). Je veux croire que la nécessité, avant tout, motive l’écriture. Au moins, si je peux m’enorgueillir d’une chose, c’est bien d’écrire sous le sceau de la nécessité, de conserver une marge de liberté importante qui ni ne m’oblige à plaire, ni ne me contraint pas à séduire le lectorat, comme il est facile de le faire en faisant des concessions, en adaptant ses sujets au goût du lectorat, en renonçant aussi à une certaine exigence d’écriture. Depuis vingt ans, j’écris ce que je dois écrire, ce qui me hante et m’obsède, voilà tout, sans me soucier des opinions, sans peur de l’échec. Et je suis foncièrement reconnaissant à mon éditeur, Charles Dantzig, comme aux éditions Grasset, de me soutenir en publiant cet essai, de me permettre également de donner une suite – sur laquelle je travaille – à cette Littérature sans idéal. Ce n’est pas si évident.
Entretien © Philippe Vilain & D-Fiction – Illustrations © DR
(Paris, oct. 2016)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
