À la mémoire d’Isabelle Creusot dont nous n’oublierons pas l’acuité d’esprit, ni la ferveur.
Éric Marty est-il un nouveau genre de Cordwainer Smith ? Tout pousse à croire en effet que l’ambition hors norme qui a animé l’auteur extraordinaire des Seigneurs de l’Instrumentalité (sorte de légende des siècles du futur qui relate l’évolution humaine sur plusieurs millénaires) est également celle qui anime Éric Marty, car si l’axe de réflexion de ce dernier – la littérature « blanche » et les sciences humaines – et sa forme de prédilection – l’essai et le roman – le séparent quelque peu de son confrère qui s’est tourné, quant à lui, vers les sciences politiques et la science-fiction, essentiellement à travers la nouvelle et le roman, bien des similitudes les rapprochent, à commencer par cette conscience humaniste, c’est-à-dire cette clairvoyance, qui leur permet toutes sortes de spéculations anthropologiques, tant visionnaires que salutaires pour leurs lecteurs. Ainsi, après l’édition des œuvres complètes de Roland Barthes et la publication de nombreux essais qui comptent à nos yeux de par cette manière si particulière qui est la sienne d’aborder des sujets qui fâchent, froissent ou font frissonner les frileux, Éric Marty publie aujourd’hui une somme imposante, aussi époustouflante par son ampleur et ses « révélations », que solaire par son analyse perspicace et sans compromis, comme par ses hypothèses convaincantes : Le Sexe des Modernes – Pensée du Neutre et théorie du genre (Le Seuil, 2021).

Il est indéniable que cet essai compte d’ores et déjà parmi les plus conséquents de l’année 2021, sinon de ces dernières décennies, et cela pour différentes raisons que nous résumerons rapidement : d’une part, c’est le premier essai qui a l’ambition de retracer la propagation (et les soubresauts) d’un terme qui est devenu un concept – le genre – en remontant à ses prémices littéraires, philosophiques, et psychanalytiques afin d’en suivre les applications sociale, politique et médicale qui en ont découlé au cours du 20e siècle et cela jusqu’à l’émergence de la théorie qu’en a tirée Judith Butler en 1990, avec la publication de son ouvrage majeur, Trouble dans le Genre (trad. La Découverte, 2005). D’autre part, l’essai d’Éric Marty a l’ambition d’analyser l’évolution de cette théorie au regard des postures intellectuelles française et américaine du dernier demi-siècle, et de mettre donc cette évolution en perspective même de la pensée du Neutre telle qu’exposée par les Modernes – Barthes, Deleuze, Derrida, Lacan, Foucault… – pour faire surgir les « malentendus », « approximations », et autres « détournements » que Judith Butler fait subir au terme même de « genre » pour en forger une théorie dont on peut dire aujourd’hui qu’elle est aussi flexible qu’un roseau: elle plie, mais semble ne jamais devoir rompre, même si ses contorsions sont nombreuses, créant ainsi de délicates confusions… de genre précisément, confusions qui sont l’objet même de l’analyse, et de l’enjeu de l’essai d’Éric Marty.
Déjà, dans une œuvre fictionnelle – La Fille (Le Seuil, 2015) – Éric Marty avait retenu notre attention concernant cette notion qui nous occupe plus personnellement : le Neutre. Ainsi décrivait-il la voix de cette Fille comme étant « sans timbre, sans résonance, inimitable, monocorde, atonale, neutre comme un gaz sans odeur, épuisée, morte, gémissante d’ennui, aspirante, attirante comme un vent tiède arrivé avec retard du Sud lointain ». La présence du terme « neutre » apparaissait ainsi à la manière du « degré zéro » – cette « inaudible et illisible notation des effets », disait Althusser – d’un signifiant qui n’apporte pas de réponses aux questions que nous nous posons sur la Fille, mais suscite au contraire, via le narrateur qui en relate l’histoire, une étrange interrogation sur nous-mêmes en jetant un certain « trouble » justement, sur notre perception de la réalité, car en fait, la fille en question n’est autre qu’un garçon… Ainsi, le Neutre permettait à Éric Marty, non pas tant de déjouer ces oppositions masculin-féminin (que nous nous efforçons de déjouer de notre côté à la « lettre », dans nos oeuvres personnelles, par l’application d’un sujet absolument neutre, au contraire du sujet amalgamé et géminé de l’écriture inclusive), que de traiter déjà de cette problématique qui traverse Le Sexe des Modernes, et taraude toute la réflexion de ce nouvel essai : le sexe comme image, comme réel, comme différence, comme projection, mais aussi comme spectre, puisqu’il constate que le sexe « est le spectre le plus insistant de notre humanité contemporaine suscitant les vocations des nouveaux Hamlet, dont le to be or not to be prend la forme d’une imprévisible et légitime antienne planétaire : de quel sexe suis-je ? That is the question ».
Mais avant d’entrer plus dans le corps de cet essai, soulignons qu’il se lit avec un immense plaisir, plaisir propre à ce qui est irrigué d’une énergie vitale et nécessaire, à savoir celle du « plaisir du texte » revendiqué par Barthes et dont on se rappellera les paroles, tant elles opèrent avec tout autant d’enchantement dans l’essai de Marty :
Écrire dans le plaisir m’assure-t-il – moi, écrivain – du plaisir de mon lecteur ? Nullement. Ce lecteur, il faut que je le cherche, (que je le « drague »), sans savoir où il est. Un espace de la jouissance est alors créé. Ce n’est pas la « personne » de l’autre qui m’est nécessaire, c’est l’espace : la possibilité d’une dialectique du désir, d’une imprévision de la jouissance : que les jeux ne soient pas faits, qu’il y ait un jeu.
Ce sont effectivement cet espace, cette dialectique du désir, cette jouissance, et ce jeu même qui subjuguent et hypnotisent le lecteur qui va ouvrir Le Sexe des Modernes pour le dévorer – littéralement parlant – comme un véritable roman à clef.
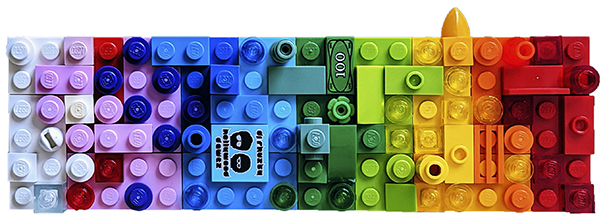
L’ouvrage se découvre à travers quatre parties distinctes, un peu comme les quatre mondes de la construction séphirothique. La première partie représenterait le « monde de l’émanation » : présentation de l’objet de recherche du point de vue méthodologique, historique et social qui le constitue et en illustre le postulat. La deuxième partie, le « monde de la création » que développe le thème traité du « sexe travesti ». La troisième partie, le « monde de la formation » que proposent les différentes manières d’aborder le sujet du Neutre. Quant à la quatrième et dernière partie, elle représenterait le « monde de l’action » et se démarque des trois premières du fait qu’elle est toute entière consacrée au philosophe Michel Foucault et à ses travaux autour de l’Histoire de la sexualité, et plus particulièrement son premier volume : La Volonté de savoir (1976). La raison en est simple : Éric Marty explique que ce n’est pas la déconstruction, dont Derrida a systématisé l’usage et théorisé la pratique, qui a nourri la pensée de Judith Butler sur le genre – comme on pourrait s’y méprendre (la référence de Butler à Derrida n’est qu’un « leurre », prévient Éric Marty) – mais directement le foucaldisme. En effet, Butler échafaude sa théorie (qu’elle préfère d’ailleurs qualifier d’ « études ») à partir de la pensée de Foucault, et notamment à partir du deuxième, ou « dernier », Foucault – celui du tournant néolibéral – qui avait alors été séduit par le performatif et le pragmatisme de la philosophie américaine. Marty relate ainsi que c’est à partir de ce « tournant », de cette réévalutation de sa pensée, de la remise en question de son approche, que Foucault fait surgir cette notion de « positivité » sociale par laquelle il accomplit un renversement épistémologique et une rupture historique majeurs qui lui permettent ainsi de soutenir le postulat que « la société est en train de cesser d’être une société essentiellement articulée sur la loi pour devenir une société essentiellement articulée sur la norme » (d’après une citation tirée de l’un de ses articles et de La Volonté de savoir que Marty contracte pour rendre compte de la teneur du propos).
Sans reprendre les différents points qu’Éric Marty développe avec force arguments pour expliquer l’ampleur de cette réévalutation foucaldienne, il en est un précis qui nous interroge et nous laisse même sans voix : celui où il analyse la haine de la littérature ressentie soudainement par le philosophe, littérature dont ce dernier ne s’embarrasse plus – comme d’un animal de compagnie que l’on abandonne sur le bord de la route – et qu’il qualifie de « chose passée », ce qui le pousse à rompre hic et nunc avec ses pairs, confrères et amis en remettant en cause leurs travaux, et en s’engageant dans un combat systématique contre la « souveraineté du signifiant » et ce caractère qu’il estime arriéré de la « figure de l’écrivain » comme autorité intellectuelle, lançant même une offensive aux conséquences lourdes (on en prend aujourd’hui socialement la mesure) contre l’ « écriture ». Cet appel à la destitution, sinon à l’anéantissement d’une technique et d’un art jusqu’alors garants à travers les siècles de notre langue, de notre culture, de notre histoire, de notre identité, de l’avènement de la pensée occidentale, nous semble particulièrement symptomatique de l’émergence de ce néo-parler qui règne partout, depuis ces attaques foucaldiennes contre la littérature, jusque dans ce qu’on ose encore aujourd’hui désigner comme telle – généralement sous la forme de « roman » – et qui ne recèle plus qu’une prose creuse, évidée de toute épaisseur, de toute esthétique, de tout style, c’est-à-dire précisément de toute « littérature » dont les contenus suintent – au choix – le pathos sociologique (prose testimoniale) ou la mièvrerie sociale (feel good books), bien éloignés de l’exigence et de l’ambition intellectuelles qu’un Foucault mettait pourtant lui-même dans son écriture et sa pensée, révélées par une vision généralement originale, sinon inattendue, du monde, comme celle prémonitoire qu’il formule – bien que stupéfiante pour l’époque (1966) – de l’effacement de l’homme, à savoir de sa disparition définitive, « comme à la limite de la mer un visage de sable ».
Si l’on s’accorde à dire que « le style est le sang de la pensée », on comprend mieux pourquoi, aujourd’hui, il n’y a non seulement plus de style parce que plus de « sang » (sève), mais aussi plus de « pensée » parce que plus d’écriture (littérature). Et par cette allusion quasi menstruelle et lacanienne de l’écriture qu’incarne toute véritable littérature, on peut ainsi discerner ce refoulement et cette haine qui ne disent pas leur nom, c’est-à-dire, au fond, leur « objet » : celui de la femme (née biologiquement de sexe féminin), refoulement et haine très largement partagés dans toutes les sociétés au cours de toutes les époques qui rêvent d’en finir avec une fois pour toutes avec ce genre biologique, comme en rend compte Virgilio Martini qui, dans une fiction prémonitoire – Le Monde sans femmes (1971) – nous raconte comment un virus – eh oui… – ravage la terre entière et atteint les femmes en âge de procréer : le monde sombre alors dans la décadence, appartenant « désormais aux misogynes et aux célibataires involontaires » ! Effroyable roman qui en dit déjà long du refoulement et de la haine qui ont gagné aujourd’hui jusqu’aux « genders » eux-mêmes, pour qui la femme née de sexe féminin – tout comme l’homme né de sexe masculin – ne seraient en fait qu’une « construction » sociale, culturelle, autant que médicale (chirurgie de réattribution sexuelle).
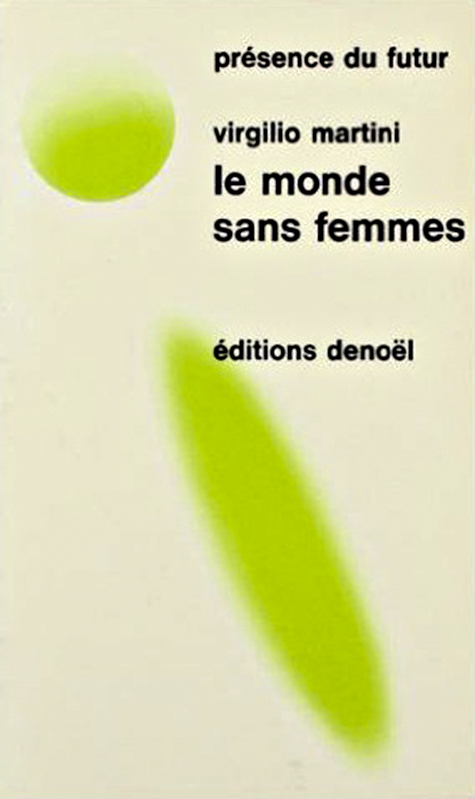
Cette haine de l’être humain, et plus particulièrement de la femme, associée à celle de la littérature, sans cesse rabaissée, moquée, mais surtout dévaluée, et de plus en plus effacée (par l’extermination même de son écriture) depuis cette haine exprimée par Foucault, n’est d’ailleurs pas sans rappeler cette autre haine – tout aussi viscérale – à l’égard du peuple juif, par excellence peuple du Livre et de la Loi comme le démontre Stéphane Zagdanski – l’un de nos plus puissants penseurs contemporains – à travers son passionnant et non moins courageux séminaire – La Gestion génocidaire du globe – dont les thèmes et les arguments ébranlent avant de retourner littéralement ces a priori et autres croyances (sociales, politiques, culturelles, religieuses, etc.) dont nous sommes autant les dupes que les responsables, c’est-à-dire ces idiots complaisants et utiles de la bonne conscience sociale forgeant cette Norme aliénante. Mais cela est un autre débat…
Simplement, on comprend à quel point cette haine de Foucault envers la littérature remonte chez lui à cette « haine de soi » – si commune en Occident de nos jours – elle-même découlant de cette réévaluation néolibérale (le « souci de soi ») qui lui était si chère et que l’on pourrait donc pertinemment rebaptiser aujourd’hui de « haine de soi » donc. De là à affirmer que cela explique la haine que Judith Butler ressent d’elle-même, eh bien il n’y a qu’un pas que nous franchirons d’autant plus aisément qu’Éric Marty relate comment Butler a dénoncé – à la manière d’une véritable « tache » (dans le sens rothien) – le fait d’être effectivement « blanche », « juive » et « diplômée », mais aussi « lesbienne » (à savoir le fait d’être une « femme née biologiquement de sexe féminin »), ce qu’elle déplore parce que les « signes » de cette identité prouveraient le sceau d’une suprématie sociale, sceau aussi infâme qu’infamant, quasi équivalent à cette fameuse marque de la Bête de l’Apocalypse ! Pour peu, on aurait presque envie de conseiller à Butler d’arrêter Dan Brown et de passer à Dorothy Allison, à Hilda Doolittle ou encore, à Ursula Le Guin pour revenir à une certaine forme de délicatesse et d’amour propre, mais bref…
Cette haine de la femme en tant que telle, tout comme cette haine de la littérature, de l’élitisme, de l’esprit, etc. jusqu’à cette haine de l’Occident, alors perçu tout autant comme « nature » que comme « culture » – génétiquement coupable dans les deux cas – serait ainsi alimentée aujourd’hui par cette volonté forcenée d’ « effacement » de ses valeurs, comme d’effacement de la femme « biologiquement née de sexe féminin », volonté à l’œuvre à travers les conflits internes aux « genders », et qui agite en particulier les transgenres par un retour du refoulé qui, là non plus, ne dit pas son nom, mais qui se définit tout de même, comme l’explique Éric Marty, par l’apparition du terme gynophobie. Ce terme nous semble d’ailleurs déclencher un genre de violences proches, sinon quasi identiques, à celles que nous pouvons percevoir également de cette « littératurophobie » prégnante et de cet antisémitisme viscéral qui obsèdent tant nos sociétés. La boucle est donc bouclée !

Pour en revenir à Foucault, il est ainsi étonnant que personne à notre connaissance – Marty ne l’évoque pas non plus lui-même – ne revienne sur une déclaration du philosophe en 1978, soit deux ans après son fameux « tournant » par lequel, avec La Volonté de savoir, il s’est détourné de la Loi au profit de la Norme, et qui en dit long sur son refoulement intellectuel – apparemment profond – concernant une certaine pensée juive :
Quand je reconnais les mérites des philosophes de l’école de Francfort, je le fais avec la mauvaise conscience de celui qui aurait dû les lire bien avant, les comprendre plus tôt. Si j’avais lu ces œuvres, il y a un tas de choses que je n’aurais pas eu besoin de dire, et j’aurais évité des erreurs. Peut-être que, si j’avais connu les philosophes de cette école quand j’étais jeune, j’aurais été tellement séduit par eux que je n’aurais rien fait d’autre que de les commenter. Ces influences rétrospectives, ces gens que l’on découvre après l’âge où on aurait pu subir leur influence, on ne sait pas si on doit s’en réjouir ou s’en désoler.
(« Entretien avec D. Trombadori (1978) » in Dits & Écrits, t. 4, p. 74).
Car si l’on s’accorde, en effet, pour dire que l’école de Francfort est le « lieu » qui symbolise cette pensée juive – de la Loi (Messianisme scholemien), du Temps (la flânerie benjaminienne), de la Mort (désastre andersien), de la Négation intégrale (critique marcusienne), de la condition humaine (vita activa arendtienne), de l’Élitisme culturel (dialectique horkheimer-adornienne) – en bref, de tout ce qui fait essentiellement littérature, que devons-nous déduire du fait que, à cette même date, Foucault rejette donc cette pensée de par ce retournement néolibéral, et malgré quelques regrets qu’il exprime sous forme de pirouettes ? Cette schizophrénie qui, là encore, ne dit toujours pas son nom, ne pose-t-elle pas la question – très spéculative, certes – de sa crédibilité intellectuelle, sinon éthique, deux ans à peine après la publication de La Volonté de savoir (un titre révélateur puisque que savoir n’est pas connaître…) qui accréditerait l’hypothèse d’un « doute » concernant ce tournant néolibéral (la Norme plutôt que la Loi), mais que le philosophe a préféré refouler plutôt que de devoir se dédire ? On peut déceler plusieurs motivations à cette posture : de l’opportunisme, du cynisme, une psychorigidité intellectuelle incroyable, mais aussi – pourquoi pas ? – une soif de revanche sur l’ordre établi, sans doute même une certaine volonté de puissance (surgissant donc ici comme cette volonté de savoir) sur le champ intellectuel qu’il s’apprête donc à retourner pour mieux en détruire l’aura – au sens benjaminien – de cette connaissance qu’il rejette à présent. Est-ce la raison de la « disparition » quasi totale, de nos jours, de tout intellectuel d’envergure du paysage socio-politico-médiatique ?
Cependant, ce « tournant » que prend Foucault avec fracas – abjurant donc définitivement le « père » en quelque sorte (à ce moment-là, ce sera pour lui Maurice Blanchot) – ainsi que cette rupture radicale qu’il opère par rapport à l’ensemble de ses confrères, dénotent également une conviction et une audace hors du commun qui peuvent tout autant éblouir que fasciner. Nous le soulignons d’autant que nous ferons nous-mêmes l’aveu de cet éblouissement et de cette fascination, mais aussi, du profond malaise qui, au regard de l’annihilation de la littérature que cette conviction et cette audace entraînent, nous préoccupe depuis des années avec angoisse, car nous ne pouvons oublier ce qu’un autre « père » – Georges Bataille – a pu déclarer de son côté :
La mort et le désir ont seuls la force qui oppresse, qui coupe la respiration. L’outrance du désir et de la mort permet seule d’atteindre la vérité.
Et quelle est cette vérité, sinon bien évidemment, cette littérature qui nous fait humainement vivre et nous transformer, notamment pour devenir ce que nous serons, c’est-à-dire pour faire advenir cet « autre » en nous-mêmes ? Et là, pas besoin de positivité sociale, de chirurgie de réattribution sexuelle, de changement d’identité civile, d’écriture inclusive, ni de néolibéralisme et de « conso »… C’est ce combat même entre les tenants de la Loi et de la Norme, entre les tenants de la littérature et du capital – tous ces « Seigneurs de l’Instrumentalité » – qu’illustre l’essai d’Éric Marty. Un combat à mort qui semble résulter d’une interprétation schumpeterienne – foncièrement dualiste et destructrice – de la pensée marxiste en ravivant cette lutte antithétique entre la matière et l’esprit, cette vieille lutte cartésienne sur la nature même de notre conscience, lutte devant laquelle, aujourd’hui, nous sommes plus démunis que jamais, d’autant que les suppositions d’Éric Marty confirment assez, au bout du compte, un certain postulat foucaldien, et nous laissent peu d’espoir quant à leur dénouement…
Mais nous appuierons encore un peu sur ce point qui fait mal concernant Foucault, et soutiendrons ainsi que sans l’étude de la Loi, c’est-à-dire de la littérature même, le monde cesserait tout simplement d’exister. Foucault ne pouvait pas ne pas le savoir, comme il ne pouvait ignorer l’histoire de ce sage de la kabbale, en train de méditer sur d’épais ouvrages – tout comme lui-même le faisait – et à qui l’Esprit, en le voyant en cet état de méditation, à savoir de non-action apparente, souffle : « C’est l’étude de la Loi qui soutient le monde ». Il existe d’ailleurs une sentence du Zohar (II, 52a) dont Foucault aurait dû se méfier avant d’attaquer, de la sorte, la Loi : « Malheur aux coupables qui prétendent que l’Écriture n’est qu’une simple narration », de même que l’estiment aujourd’hui ces autres thuriféraires de la prose testimoniale et du feel good. Et qui prétendent encore qu’elle ne serait qu’une narration simplement « inutile » comme ceux qui veulent en finir avec la littérature au prétexte qu’elle ne serait que passions (inutiles là aussi), perversion, perte de temps et élitisme… En nous inspirant de mots prononcés par Heinrich Heine, nous dirions volontiers que là où l’on annihile la littérature, on finit par anéantir les hommes. Que faire dès lors – parmi ces Modernes – de Foucault devenu le chantre à tout-va de ce 21e siècle à l’agonie ? L’oublier tout à fait à la manière de Baudrillard ? Le destituer définitivement à la manière de ces jusqu’au-boutistes anti « foucaultphiles et foucaulâtres » ? Ou bien le récupérer quand même à la manière de Butler, et en tirer autre chose, mais quoi ? Et so what finalement ?
De la même manière que la littérature permet d’imaginer pourquoi l’esprit précède toujours la matière, on saisira d’autant mieux pourquoi la pensée précède l’écriture qui précède elle-même l’œuvre qui précède à son tour l’ouvrage. Et non l’inverse. Alors, on comprendra ce qu’Éric Marty énonce plus explicitement concernant les lettres L et T au sein du sigle LGBT+. Analysant la position finale du T, il montre effectivement que dans sa « pulsion d’hégémonie », celui-ci donne « une résonance qui vaut pour une coda déterminante » sur les lettres L, G et B, en devenant la « lettre unique qui les efface toutes, et leur demande allégeance », le + recouvrant d’un « silence courtois » toutes celles qui suivent : Q, I… Se faisant, Marty avance que le T (Transgenre) l’emporterait au sein de ce sigle sur les lettres L, G et B dont l’identité sexuée (Lesbienne, Gay, Bisexuel) serait aujourd’hui obsolète, sinon ringarde. Marty constate donc que « le terme transgenre n’est pas un mot quelconque puisqu’il est producteur d’un paradigme (transgenre/cisgenre) aspirant à dominer tout le champ sémantique du genre ». Pourtant, force est de constater que le L, tout comme le G et le B, précéderont cependant toujours le T dans l’alphabet… Ainsi, comme le fait remarquer avec pertinence Marty, la « demande insistante de reconnaissance d’un sexe, et d’un seul » l’emporte finalement sur cette « aspiration d’une identité en perpétuel devenir » imposé par le transgenre. De la même manière que l’aspiration à une technologie en perpétuel « augmentation » imposée par la réalité virtuelle va à l’encontre de la demande insistante de reconnaissance d’un monde physique, et d’un seul : un monde respirable et viable pour des êtres humains.
N’est-ce pas la meilleure preuve que la littérature précédera toujours la technique, qu’elle restera prépondérante comparée à cette dernière, de la manière dont l’exprime David Mitchell dans la Cartographie des nuages où l’humanité finit par revenir à elle-même, c’est-à-dire par retrouver la nature humaine de son espèce en acceptant sa dimension mortelle, mais aussi – et peut-être surtout – sa dimension spirituelle ? Voilà pourquoi nous pouvons dès à présent saisir – justement grâce à la littérature – que le basculement technologique que nous nous préparons à opérer est le signe même d’un retournement ontologique inévitable pour l’humanité – peut-être encore difficilement imaginable à notre époque – vers une prise de conscience de sa nature fondamentale qui lui fait tant défaut, et qui n’a évidemment rien à voir avec le dogmatisme de ces religions mortifères, elles-mêmes destructrices de la Loi ; et cela peu importe nos identités sexuelle, ethnique, sociale, etc. Il est d’ailleurs cocasse de songer qu’une telle fiction a fait l’objet d’une adaptation cinématographique par les Wachowski, avant qu’ils ne deviennent tous deux… des femmes transgenres ! On songe à tout ce qu’ils auraient pu confier à Lacan qui en aurait certainement tiré quelque enseignement éclairant pour nous prouver finalement que – par exemple – « il n’y a pas de rapport (trans)sexuel ». Et que si rapport il y a, il est toujours d’ordre symbolique, donc inévitablement constitué par la littérature…
Nous tenterons d’achever ce compte rendu en revenant à Roland Barthes qui, une fois de plus, apparaît ici comme le grand sage de toute cette histoire. Car sans lui, point de salut ni même plus aucun sens aux signes… Et en lisant l’essai d’Éric Marty, nous avons eu l’impression que la mort de Barthes n’est pas qu’un accident, tout comme Laurent Binet l’a si bien projeté dans son redoutable et brillant roman, non que cette mort ait à voir avec cette « septième fonction » du langage que Barthes aurait découverte – et qu’auraient convoitée toutes sortes de politicards dénués de scrupules en passant un « contrat » sur sa tête – mais par cette conscience précisément qu’il avait du « désastre » qui s’annonçait suite au reniement et aux attaques de Foucault contre la littérature, au moment où il songe lui-même à l’écriture d’un roman, et donc à sa « préparation » (thème de son séminaire au Collège de France entre 1978 et 1980).

Ce « désastre », Barthes en mesurait certainement l’irréversibilité et la finalité : l’extermination de l’ordre symbolique incarné par l’écriture que sont la langue, la pensée, la littérature, pour aboutir à l’extermination de l’Homme. En fait, il nous semble que Barthes a eu la vision de l’holocauste terminal à laquelle la Norme, en remplacement de la Loi, allait conduire l’humanité à terme, et dont Éric Marty, sans divulgâcher la conclusion de son essai, tire le même enseignement. Sans doute, cette vision a-t-elle été pour Barthes si émotionnellement insupportable – surtout après le décès de sa mère en 1977 – que son accident peut être considéré soit comme une sorte de suicide, soit comme un meurtre, symbolique certes, mais un meurtre quand même, dans le sens où les mots peuvent également tuer puisque, comme il a été dit jadis, « il y a des mots aussi meurtriers qu’une chambre à gaz ».
Le « tournant » de Foucault a sans nul doute été pour Barthes un choc, une trahison, un véritable coup de poignard, au point qu’il a été meurtri plus qu’aucun autre Moderne – plus que Derrida, Deleuze ou même Lacan – car c’est bien lui l’inspirateur du premier Foucault, son Neutre – ce « degré zéro » – influençant l’écriture même d’Histoire de la Folie, auquel la première préface de Foucault rendait d’ailleurs hommage. À ce titre, si Éric Marty rappelle que Jean Laplanche envisageait « le monde des normes sans loi promu par Foucault comme un monde inhumain », il ne nous dit rien sur ce qu’en pensait lui-même Roland Barthes alors même que ce dernier a bien dû exprimer quelque chose sur cette question qui le touchait directement. Quoi qu’il en soit, les difficultés éprouvées par Barthes pour écrire son roman – La Vita Nova (titre quelque peu troublant vue sa mort prématurée) – peuvent être considérées comme la conséquence directe de ce « tournant » foucaldien ressenti par l’ensemble des Modernes tel un véritable séisme, tant intellectuel qu’existentiel. Sans doute Barthes, devant ce « tournant », a-t-il perdu en quelque sorte le sens même du signifiant et du signifié, ce qui expliquerait peut-être le titre de son roman, mais également qu’il n’a plus su quel sens donner à son rôle, à sa mission, à son désir, c’est-à-dire à sa raison de vivre la plus profonde.
L’essai de Marty nous fait prendre conscience – entre autres – que ces enjeux découlant de la pensée du Neutre et de la théorie du genre ne sont pas sans conséquences, et que ce qui semblerait n’être, pour cette société cupide et compulsive du clic et du like, qu’un débat intellectuel de plus, puéril ou négligeable, est en fait aussi primordial pour l’évolution de notre « humanité », et pour son avenir même, que celui touchant aux principes éthiques et politiques développés, en un autre temps, lors du procès de Nuremberg.
Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
