Tolle, lege ? Je n’ai entendu aucune voix inconnue. Rien ni personne ne s’est introduit dans mon bureau – ni cygne ni vieillard. Pas la moindre trace de pluie d’or qui m’aurait signifié de prendre et de lire. Mais je prends – et je lis – de la mémoire des commencements à la conversion, en passant par les aventures du coeur et de l’esprit, les erreurs et les errances, les intermittences du vouloir et les résolutions. (Cécile Guilbert)
Si la « fille aux cheveux noirs », sous les traits d’Emily Hnatt dans Le Dieu venu des Centaures, de Donna Hawthorne dans Substance Mort, de Sherri Solvig dans SIVA, et de Rybys Romney dans L’Invasion divine, surgissait dans les œuvres de Philip K. Dick – sans doute l’un des rares écrivains « prophètes » que, avec Kafka, cette planète ait produits – c’est parce qu’elle apparaissait à son géniteur comme ce personnage invariant et démiurgique, surpassant n’importe quel autre personnage, du fait qu’elle incarnait à ses yeux – par excellence – la figure fantasmée et multiple de l’écriture dont le nom n’est autre que « Littérature ».
Quelques décennies plus tard, de l’autre côté de l’Atlantique, au cœur de cette Start-Up Nation qui n’est plus que l’ombre d’elle-même, la « fille aux cheveux noirs » ressurgit, mais cette fois sous les traits de Cécile Guilbert dans Feux sacrés (Grasset, 2025), un récit qui relate son propre parcours où le Réel et l’Autobiographie se mêlent pour brosser le portrait d’une femme qui a fait de sa vie son meilleur roman. Car fidèle à cette fille mythique qui a traversé une existence marquée par des expériences mystiques, le doute et l’abus de drogue, Cécile Guilbert a fait de ces mêmes expériences addictives, mélancoliques et spirituelles, l’instrument de la transmutation de son esprit et de son cœur pour devenir, aujourd’hui, l’un des rares écrivains que compte encore cette nation.
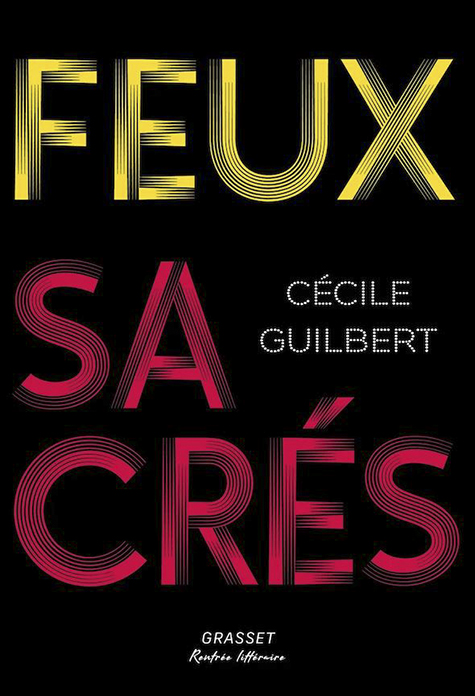
L’écriture de Cécile Guilbert porte ainsi haut la parole qui résiste à la propagande spectaculaire de la marchandise et à la reproduction de tous ces petits romans autocentrés sur les étals des « librairies » devenues, pour la plupart, vitrines du mainstream à l’époque de sa reproductibilité numérique. Car, tandis que règnent la néantisation de la langue, l’épuration du style et l’affadissement de la textualité, Cécile Guilbert monte au front en combattante brillante – telle que l’origine germanique de son nom marital et de plume (wig & berht) le souligne – bien décidée à en découdre avec la soi-disant « rentrée littéraire » où il ne se passe plus rien qui vaille depuis si longtemps, du moins rien qui mérite encore d’être considéré, au niveau de cette dimension incandescente de la littérature grâce à laquelle nos existences ressortaient jadis réveillées et vivifiées, notamment grâce à tous ces « sorciers du verbe », ces « amants des dieux », ces « chercheurs d’absolu » ces « voleurs de feu », ces « violents clandestins » que vénère elle-même l’auteur de ces pages.

Posons donc d’emblée que la naissance de Cécile Guilbert ne remonte pas seulement au temps où elle a vu le jour, mais bien au moment où elle a basculé des passions juvéniles et insouciantes de la vie à celui des affres saisissantes et révoltantes de la mort, autrement dit, à cet instant où la littérature s’est imposée à elle comme une véritable mariophanie – entendue ici hors de toute dimension religieuse, et que l’on pourrait tout aussi bien qualifier d’épiphanie – lui permettant d’entendre directement la littérature s’adresser à elle, et en retour, de faire résonner sa propre voix à travers celle-ci. Ainsi qu’elle le fait dans Feux sacrés, Cécile Guilbert part d’un « je » rationaliste, passionné de poésie et de philosophie pour revisiter l’expérience de la perte – cousin suicidé, grand-mère en veille, frère disparu de manière bouleversante – et faire de cet abîme un passage vers une Vita Nova par laquelle elle se souviendra que « nulle chose ne peut avoir pour destination ce qu’elle n’a pas pour origine ». Son récit, en mêlant rigueur de l’intellect et analyse du voyage intérieur, permet de faire glisser le scepticisme initial en une quête d’éveil qui la conduira vers l’autre rive – celle des ashrams du Kerala, des cérémonies de Bénarès et des silences sacrés de l’Inde qui devient à la fois, pour elle, paysage extérieur et miroir intérieur. Dans ce théâtre intime, les maîtres yogis, les ritualités du feu et la spiritualité indienne ne sont pas seulement décor : ils sont la matière d’une métamorphose.

Toutefois, il est malaisé d’exposer ainsi le sujet de Feux sacrés, car cela reviendrait à le réduire à l’apparence un peu triviale d’un compte rendu de type journalistique, alors même que l’importance de son enjeu resterait en suspens. En effet, quiconque prendrait connaissance de ce livre sous la forme d’un tel compte rendu serait en droit de se demander, au fond, en quoi le parcours ainsi exposé de Cécile Guilbert présente-t-il quelque chose d’essentiel, sinon de nécessaire à retenir sa curiosité, son intérêt, ou même encore cette part de voyeurisme qui lui sied si bien, pour une vie dont il n’a pas idée, et dont l’idée même lui échappe complètement au regard de tout ce par quoi il est lui-même retenu par ailleurs – c’est-à-dire par les séries télévisées, les réseaux sociaux ou encore les grilles de sudoku, ce « casse-tête » le plus populaire du monde – chacune de ces activités apparaissant soudain comme un contre-effet logique aux avalanches de pseudo-romans storytellés qui ont fini par détourner les lecteurs de la littérature, comme la littérature de nos existences si banales et sournoises.

Devant nombre de comptes rendus lus ici et là, nous constatons ainsi que ceux-ci ne traitent, le plus souvent, que de l’aspect matériel et social de l’écriture. Ils ignorent tout de son geste et demeurent silencieux quant à l’intention de celui-ci, quant à son énergie même, préférant faire fi du signe que ces dernières symbolisent, de ce signe qui relève de l’art, quand le livre ne relève, lui, que de ce qui se partage communément entre posture et imposture. Ainsi, quand le signe indique l’œuvre, les comptes rendus font un tour du livre et puis s’en vont, à la manière du hamster qui tourne à vide dans sa roue, pour s’accrocher à cette singerie sociale qui n’a plus d’autre sens, aujourd’hui, que de feindre d’ignorer ce vide qui nous anesthésie confortablement. N’est-ce pas d’ailleurs ce que Tito, l’oncle de Cécile Guilbert, lui explique lorsqu’il décide de rejoindre son guru au Kerala malgré les risques de dégradation physique dus au cancer qui le ronge, et alors que justement l’auteure s’émeut de l’absence de traitement, voire de médecin compétent ou encore d’accès à un simple hôpital dans un pays aussi démuni ? : « Ma petite Cécile, tout ce que tu évoques appartient au monde phénoménal, aux illusions créées par ton mental qui s’agite comme un hamster tourne en vain dans sa roue » ? Voilà pourquoi il est inutile de revenir sur le parcours de Cécile Guilbert et des traumas personnels et familiaux qui l’ont parsemé. Le plus important est en effet « ailleurs », plus précisément dans la métamorphose psychique et spirituelle qui en a découlé et qui a permis à l’auteure de dépasser ces traumas, de les transformer en une vie vivante, ou pour le dire autrement, en une révélation d’elle-même dans l’existence de cette vie-là. C’est là que se situe tout l’enjeu de son récit.

C’est de cette même volonté de transformation et de révélation dont nous devons faire preuve pour exposer cet enjeu, dont il n’est pas certain – à ce stade – que Feux sacrés puisse être vraiment lu plus qu’il ne nous lise toujours davantage lui-même. Car c’est sur cette ligne ténue qu’il se développe : le lecteur avancera, happé par des pages qui l’absorberont, tandis qu’il ne parviendra tout à fait à les absorber, elles. Pour dépasser donc l’explication de texte concernant autant le fond (souvenance mémorielle) que la forme (description autobiographique d’une intimité) – et qui en appelle à cette règle psychanalytique d’un double « je » (je-nous), dont Michel Leiris a inauguré le principe « moderne » avec L’Âge d’homme en 1939 – on peut d’ores et déjà affirmer que Feux sacrés impose cette audace que l’âge dont il est question ici n’est plus seulement celui de l’homme, ni même d’ailleurs de la fille, mais celui d’une femme qui, en tant qu’auteure, nous apparaît pour la première fois peut-être dans la littérature française contemporaine comme cette « figure fantasmée et multiple de l’écriture » formulée plus haut : celle donc de la littérature qui, à l’image d’une lueur dans les ténèbres, gît au milieu des décombres éditoriaux déversés par toute cette bonne conscience culturelle que produit jusqu’à la saturation ce capitalisme aussi crevard que tardif.

Car dans Feux sacrés, le lecteur découvre ce que magnétisent les mots qui le composent, c’est-à-dire le signe qui fait de ce récit une œuvre à part entière, mais aussi la nature même de ce signe, de quoi il est le nom, tout comme, chez Proust, le « nom du pays » est simplement « le pays ». Ici, le nom de Feux sacrés n’est autre que celui qui s’insère entre ces deux mots, mais aussi entre tous les mots de ce récit, comme entre deux êtres – par exemple, entre l’auteur et son lecteur – sinon entre ceux encore capables d’exprimer leur amour. Ce nom est « Désir ». Et c’est de lui, ce désir, dont Cécile Guilbert a nourri son récit, que le lecteur devra faire l’expérience.

D’abord de ce désir simple, par lequel il se laissera aller à quelques sensations, comme celle du plaisir de goûter à cette langue – ce « plaisir du texte » même que d’aucuns ont affirmé être une jouissance du fait que toute lecture d’un véritable texte procède toujours d’une caresse. Ensuite de ce désir vif qui l’attrapera, le captivera, le submergera comme une ivresse des sens, puisque les mots d’une telle langue participent de ce plaisir que d’autres ont également qualifié de « charnel ». Et en définitive de ce désir violent, qui le renversera de manière aussi imprévue que la lecture d’un tel livre était tout aussi imprévue dans son quotidien épuisant et monotone, au point de remettre en cause ses présupposés sur elle, c’est-à-dire le sens même de celle-ci au sein d’une société qui n’a plus rien à lui proposer que de produire et de consommer. Et alors, le lecteur ne pensera plus à rien – autour de la mort, de l’amour, des livres – qu’à ces feux d’une vie : sacrée flamme d’un devenir-soi, d’un « apprendre à renaître pour mieux vivre », et à ce désir inexpugnable, secret de son existence enfin libérée.

Texte © Caroline Hoctan – Photographies © Isabelle Rozenbaum – Illustration © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
