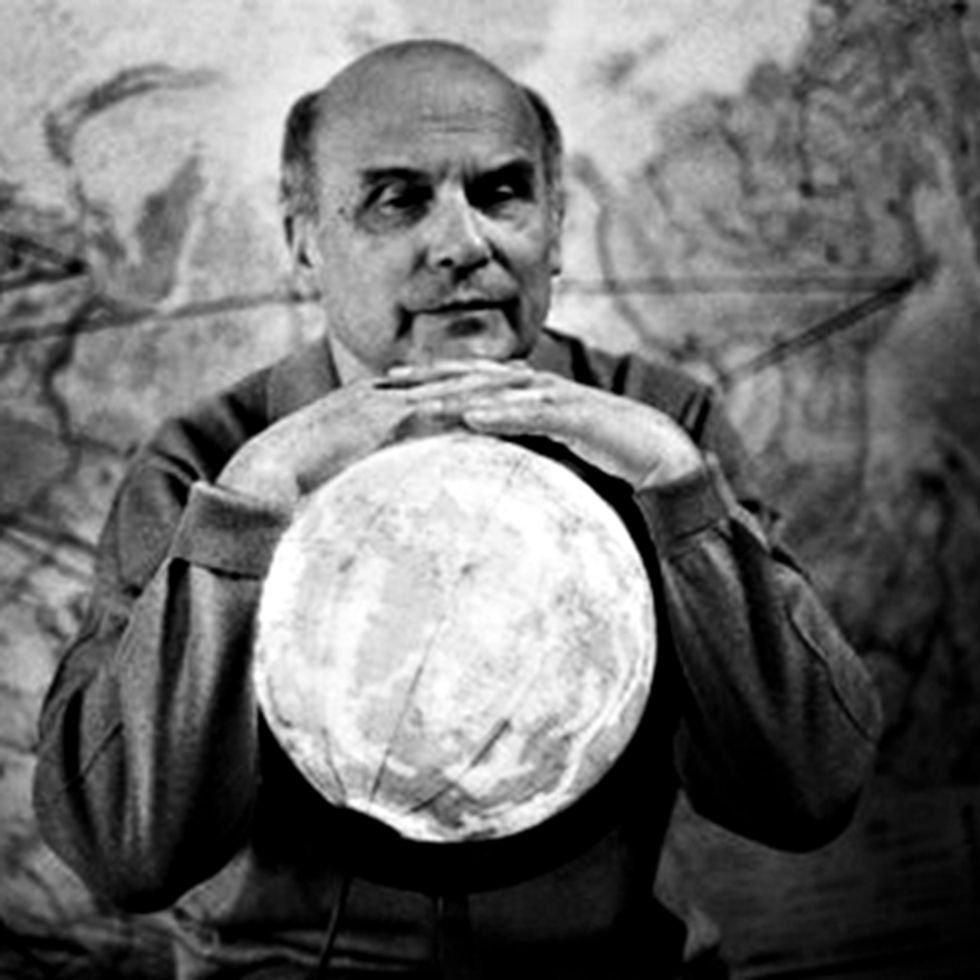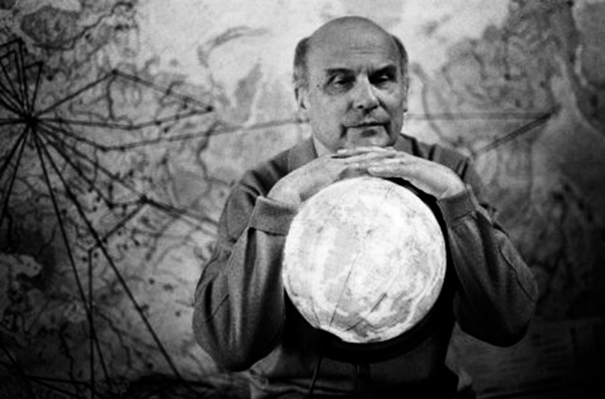
À la recherche des grands romans africains, désireux de flairer, parmi les ouvrages de référence ou les pépites inconnues, l’incursion la plus fouailleuse dans ce magma d’aventures, j’ai trouvé Ébène : aventures africaines (1998, rééd. 2002) de Ryszard Kapuściński. Correspondant permanent en Afrique pour l’agence de presse polonaise, Kapuściński dédaignait les quartiers européens et les commodités encore en place pour les blancs du post-colonialisme. Les éditeurs jouèrent à raison de cette image d’infiltré authentique de Kapuściński. De son arrivée au Ghana, en 1958, à une certaine soirée mémorable, en 1991, qui clôt le livre Ébène, l’écrivain et journaliste polonais, arpenteur inépuisable de l’Afrique tropicale d’ouest en est, semble s’être jeté dans l’Afrique comme un volontaire dans un ouragan. Lorsque l’envie de lire quelque chose d’intense tenaille un lecteur, je pense que beaucoup doivent rêver d’un tel livre. Il n’y est plus question d’un style et des obsessions d’un homme montés en écrin linguistique car Kapuściński a donné sa place à la matière démente qu’en trente ans il avait amassée dans la multitude de bouts de monde où il s’était perdu. La construction en chapitres d’Ébène parvient à contenir un flot sombre comme les fleuves Niger ou Congo, un charroi opaque dont l’auteur est parvenu à extraire quelques réalités articulables. Je ne m’attendais pas ni ne désirais trouver au centre de pittoresques descriptions, des situations solennelles de contes tiers-mondistes découpant sur fond de crépuscules des êtres rendus mutiques par l’énormité des souffrances. Kapuściński trouve sans forcer la sobriété de croisière de souvenirs à jamais frais dans sa mémoire. Un homme ne manque pas de s’y découper à mesure qu’il s’avance en mots, mais avec un effacement complet qui surclasse la pudeur et ses poses. Rien ne m’assure que le Polonais fut aussi droit et généreux dans son comportement que ne le laissent entendre les faits relatés, il n’en reste pas moins que ce livre dessine en creux un homme attentif et courageux, particulièrement doué pour cet amour humain tout terrain qu’il faut posséder à un très haut niveau pour endurer et persister à endurer les conditions rudes des relations africaines. Partout où il arrivait, se faufilait, Kapuściński représentait le riche, le profiteur et le bourreau feutré, l’Européen blanc à détrousser et à regarder de travers. Témoin auréolé d’un danger permanent, toujours latent, émanant des hommes et du climat, Monsieur K. offre à son lecteur ce kaléidoscope ultra-réaliste et dément que peut espérer le lecteur curieux d’Afrique. L’auteur admet lui-même, n’étant ni botaniste ni animalier, ses connaissances restreintes de la faune et de la flore. Ces connaissances limitées contribuent au blast énigmatique des régions africaines infiltrées et à l’impression massive qui en émane. K. nous dévoile la découpe franche existant entre le Sahara, le Sahel, le verdoiement équatorial et l’impitoyable sécheresse tropicale. Au fil des pages, nous nous accoutumons, à la faveur des aller-retour effectués entre ces latitudes, aux symboles climatiques des régions respectives et aux bornes qui les emmêlent. Ainsi, ai-je l’impression que l’eucalyptus est partout, que les manguiers, parfois seuls au milieu de la terre aride, sont ubiques, que de la terre rouge du Sahel aux portes sahariennes du désert, les acacias et les aubépines jettent en buissons les herses symboliques d’une tétanie montée de la terre, et ces paysages juxtaposés, coupés, quelque part entre l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda, par des arches de Noé soudainement débarquées sur les pistes, en troupeaux de zèbres, d’antilopes, en groupes de lions à l’ombre, en léopard paradant, solitaire, rappellent l’Afrique rêvée depuis l’Europe hivernale ; l’Afrique de Tarzan en couleur, au-delà de la savane et de la brousse, une Afrique plus grande que le ciel, plantée de montagnes bleues et vertes comme peintes, au pied desquelles « la grande forêt » érige des arbres que l’auteur compare aux gratte-ciel de la 5e avenue. Mais Ébène aborde surtout l’homme noir, expose, en une suite de rencontres et de compte-rendus de chaos politico-sociaux, la transe jamais calmée d’un continent-chaudron perclus de souffrances. Nous y apprenons, notamment, que l’image stéréotypée que l’Européen se forme du continent est une carte postale tiers-mondiste édulcorée.

K. dépeint abondamment, sans qu’il puisse être question d’en contester la réalité écrasante, une nature maléfique, persécutrice, à laquelle l’homme résiste dans un combat inégal. Kapuściński ne cesse de reprendre à zéro la description des fournaises spécifiques de chaque région et invente à la force de cuisson, on le sent à travers ses lignes, les mots et les images qui conviennent. Ce n’est pas une chaleur pour les hommes mais un feu contre les hommes, dont ils ne peuvent se protéger, ou de façon si dérisoire que la survie d’un grand nombre des indigènes, ou le simple fait qu’ils ne fuient pas définitivement, par exemple les Somaliens, les Éthiopiens, relève d’un mystère entier qui a partie liée à l’appartenance à une terre, qui rejette pourtant de toutes ses forces ses habitants humains. Un exemple : pris en camion au bord du désert, K. et son chauffeur tombent en panne en plein Sahara et doivent pour survivre, se cacher sous le camion. À ces chaleurs brûlantes, vouant les hommes à des torpeurs dont rien ne peut donner l’idée, qui plus est à doses quotidiennes, s’ajoutent les fractures inter-ethniques donnant lieu à d’invraisemblables nids de haine et de cruauté entretenus par les rapports de force et les jeux de violence et de vengeance sans fin qu’ils engendrent. Le cas du Rwanda, ce massacre à la machette tardivement relayé par les médias et dans lequel les autorités françaises ont joué un rôle sinistre, est exemplaire de ces enclaves africaines devenues des annexes de l’enfer auxquelles le monde entier tourne le dos, Kapuściński décortique le mécanisme de haine en boucle et la fatalité sanguinaire qui frappe les Hutu et les Tutsis. Le conflit soudanais – à un million de morts – mené à huis-clos mondial, et pour cause moins connu, paraît à ce titre, tel qu’il est décrit dans Ébène, le parangon des hécatombes secrètes en Afrique. Les phénomènes de haines claniques ou de luttes pour le pouvoir dégénèrent en sous-guerres sans fin, presque partout sur le continent. Kapuściński brosse ainsi le portrait de tyrans notoires, tels que Amin Dada, le bourreau ougandais, mais aussi d’une catégorie de sous-tyrans appelées « seigneurs de guerre » exploitant et martyrisant les plus pauvres en leur volant toute nourriture, une population désarmée, de femmes et d’enfants surtout, à qui les dons alimentaires internationaux sont volés. Les mêmes finissent par s’agglutiner aux marges des grandes villes, chassés par la sécheresse, la famine et les guerres. D’autres damnés de la terre, exilés, épaves d’enfants-soldats devenus clochards ballotés, criminels sans force, bondent le pourtour des villes et hantent par hordes les rues, commettent pillages et rapines, on les appelle les « bayayes ». Il ressort des chapitres d’Ébène, une canicule des temps primitifs, une fournaise de préhistoire aux talus lointains de dépotoirs militaires. Et puis, là où le Polonais s’est risqué, il y a des places fortes de l’imaginaire, des hauts-lieux de l’improbable, des trous d’inhumanité incandescente qui prennent de vitesse, à la lecture, les ravalements de glotte. Soudain, nous ne sommes plus au bout du monde, mais dans l’un de ces envers inconcevables, là où l’on s’étonne que des yeux restent ouverts et que des cœurs battent encore. Ébène termine sur deux acmés africaines, deux sommets de l’indicible. Nous sommes loin de cette riviera de mirages, aux restaurants grecs et hôtels italiens, jardins odorants et bougainvilliers, décrite depuis la fenêtre d’un train, entre Dakar et la Mauritanie, nous sommes en Afrique paludéenne qu’un soleil blanc rôtit en soudures de tôles ondulées. Car l’Afrique de Monsieur K. ne compte que des bidonvilles ou des baraques isolées, cernées par des jungles inextricables. L’attirail des bidonvilles, c’est la tôle ondulée, éventuellement la marmite, et la natte, où la nuit, grouillant partout dans les trous, rampent les insectes, blattes, araignées, chenilles, scarabées, dont la noria « gratteuse et piqueuse » attend le dormeur. Voilà où le Polonais s’est rendu, ce qu’il a voulu approcher, voir et ressentir avec ces gens, dans la rue type des bidonvilles et dans les cabanes enfouies loin de tout village. Dans Ébène, on découvre donc, au-delà de ces expériences de la misère africaine néolithique et brûlante, des « extras », des summums. Je remercie à l’avance Kapuściński de m’offrir des lieux de romans pour ainsi dire vacants que je n’écrirai peut-être pas ou ne lirai jamais ailleurs, investis par ceux en qui ils ont allumé un désir ; pour moi, quoi qu’il advienne, ils brûlent au-devant de l’imagination comme leur bas-fonds d’élite. Je repense ainsi à l’évocation de Zanzibar, lointain flou à consonance exotique maximale, du moins jusqu’au récit du Polonais rappelant le passé de l’île située au large de l’Afrique, dans l’Océan indien. Sur cette île maléfique, les esclaves transférés du continent étaient exposés et vendus au marché de Mkunazini. Une précision glaçante en dit plus que de longs développements :
Les esclaves gravement malades, pour lesquels personne n’a voulu donner même un cent, sont jetés sur la rive pierreuse à la fin du marché : là, ils sont dévorés par des hordes de chiens sauvages qui rôdent dans les parages.
L’auteur place ce rappel historique dans le feu de l’action, tandis qu’il couvre un coup d’état à Zanzibar. Clandestinement transporté en avion avec deux de ses confrères, puis échouant à quitter l’île dans un bateau refoulé sur les côtes, l’auteur tisse et noue, dans une charge documentaire mêlée d’exotisme, un genre littéraire hybride, très haut en couleurs et en danger latent, qui caractérise le livre. Un pourtour ou un prisme de catastrophe ne quitte jamais la mire du récit. Deux des derniers chapitres : « Un enfer pétrifié » et « Scènes érythréennes » s’apparentent aux confins de l’Afrique selon Ryszard Kapuścińsk. L’arrivée au Liberia, racontée par l’auteur, se déroule dans une accélération de cauchemar éveillé, quand tout bascule dans une agression violente. Monsieur K. est en effet empoigné, ou tout comme, dès sa sortie de l’avion où une nuée d’hommes teigneux lui volent ses papiers et disparaissent. Pris en charge par deux guides, le voilà conduit au centre de Monrovia. En quelques notations, l’auteur crée sur son lecteur un effet de réel puissant, une vision de rue où s’engouffrent air vicié et désolation brutale. Parois d’immeubles de ville évacuée, reprise par des trafiquants et des bandes, la rue de l’hôtel où descend K. ne ressemble à rien de connu. Plus que les traînées noires d’anciens incendies, les parois des tours paraissent maculées de veines sombres, de marbrures et de pâleurs. On soupçonne à l’arrière des façades des cours immondes où pendent des guirlandes de poisson pourri. Mais ce voisinage immédiat est le fait, probablement, de l’espèce de cage ou de hall où s’agglutinent, en guise d’entrée de l’hôtel, ou dans une excavation adjacente, une grappe de prostituées littéralement écrasées les unes contre les autres dans un silence de mort. Que dire, quand Monsieur K. entre à l’intérieur, à demi mort de chaleur, quand assoiffé, il se rue sur deux bols d’eau sans avoir la force de s’effrayer au spectacle des deux seules présences visibles au ras du comptoir, posées comme deux têtes décapitées ! Mais ce n’est pas tout, ce n’est qu’un prélude à l’hôtel, aux étages, à la chaleur qui modèle les faces, les anime par à-coups, en grimaces lentes et irréelles, ce n’est qu’un prélude à la chambre. L’on s’attendait, après un tel préambule, après ce record absolu de coupe-gorge au mètre carré, à quelque attentat sévère. La chaleur, apparemment, dictait l’horreur en vigueur, et celle-ci se lovait entière dans une chambre d’hôtel. Kapuściński monte avec sa clef, ouvre, et nous signale une pièce noire. Or, soit que la répulsion provoque un réflexe de déni, soit que nous faisons mine de ne pas comprendre, nous ne croyons pas qu’il s’agit d’un « recouvrement » au noir de la chambre. C’est pourtant le cas de cette chambre intégralement recouverte d’un granit d’insectes. Aucune scène d’horreur ne peut rivaliser. Personne, a priori, ne peut tenir, que ce soit par défiance, habitude ou inconscience. Or, Kapuściński doit s’être gravement africanisé et endurci, dans la brousse, à de telles compagnies, car il s’installe, ni plus ni moins qu’un client dans une chambre au lit frais. S’ensuit l’une des scènes les plus ahurissantes du livre sur le peuple grouillant de la chambre et le comportement du locataire. Il semblerait que Monsieur K. ait trouvé là de quoi atteindre le fin fond de l’Afrique, un pur extrait, entre quatre murs, de sa quintessence. Je n’ajouterai qu’une chose : l’auteur, passablement ému, quand même, à la vue des insectes, n’en revient pas, ils les trouve « gros comme des tortues ». Une autre scène, presque finale, une autre vision définitive donne son corollaire panoramique à la chambre de Monrovia. C’est Debre Zeit, l’océan d’épaves militaires en Érythrée. Parvenu à passer différents postes désertiques, Monsieur K. accède finalement à une petite place au-delà de laquelle Kapuściński se trouve soudain en surplomb d’un désert entier, un plateau de terre sèche sans arbres, à perte de vue. Sur l’étendue géante, une quantité de matériel militaire dépassant l’entendement couvre le sol jusqu’à l’horizon. Entrepôts, hangars, canons, lance-missiles, blindés, chars d’assaut, fuselages de migs, mitrailleuses lourdes, par centaines. Un équipement fourni par la Russie à Mentgisu le dirigeant éthiopien, du temps de Brejnev. Des moyens matériels capables d’assurer la conquête de l’Afrique entière, là, sous le regard solitaire de Ryszard Kapuściński.
Texte © Nicolas Rozier – Portrait © David Reynolds – Illustrations © DR
Un garçon impressionnable est une série de critiques artistiques et littéraires.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.