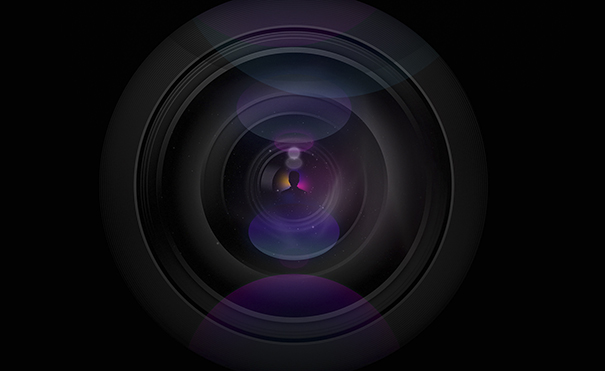
LÉO STRINTZ s’entretient avec CAROLINE HOCTAN à l’occasion de la publication de son premier roman, L’EMPIRE ET L’ABSENCE (Éd. Inculte, 2020) :
1 – Léo, vous publiez L’Empire et l’Absence, votre premier roman. Mais plus qu’un premier roman – vu son épaisseur et son ambition – on pourrait parler d’une véritable « fiction de langagement » dans le sens d’une œuvre d’écriture totale, c’est-à-dire dont l’écriture donne autant au roman sa forme que son fond, à savoir son style que son sujet, à la manière dont les termes mêmes de votre titre l’illustrent : d’une part « l’Empire » – la puissance, l’autorité, et l’épaisseur (comme forme et style) – de l’autre « l’Absence » – la perte, la quête, le secret (comme fond et sujet). L’incipit de votre roman illustre d’ailleurs également à merveille cette écriture totale comme forme et fond, style et sujet : « Les feuilletons personnels n’avaient jamais été aussi nombreux – et à un certain niveau, ici, dans la ville narrative, ils n’avaient jamais été aussi aboutis ». Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’un tel roman qui est le récit, tout à la fois, d’une fiction écrite au travers d’une série, et filmée au travers d’un roman ?
C’est assez simple. Je pars du principe qu’une œuvre doit être ce qu’elle dit. Si elle parle d’abandon, elle doit s’abandonner – donc être écrite d’une traite, dépasser le contrôle de l’auteur. Si elle parle d’amour, elle doit faire l’amour – donc donner vie, et corps, à des personnages. C’est quelque chose qui m’a très rapidement habité de manière purement intuitive, et qui a fait de moi un lecteur et un spectateur très sévère. Pour le dire plus clairement, j’exècre la pose : ce qui dit sans être. L’Empire et l’Absence parle du concept de feuilleton, c’est-à-dire plus généralement de la narration généralisée : les vies intimes de Instagram, de la télé-réalité, de Netflix, du storytelling politique, etc. Il était évident pour moi qu’il fallait donc embrasser le feuilleton, dans la forme romanesque, tout en y résistant. Ni le vivre, ni le nier, mais le pénétrer : c’est-à-dire s’y enfoncer plus qu’y avancer. Il aurait été faible, voire franchement pathétique, de critiquer le feuilleton et pourtant d’en faire, comme il aurait été pathétique de critiquer le feuilleton sans y plonger. Je l’ai donc pris non pas dans la linéarité, mais dans la profondeur. D’où la forme du livre, en spirale, axée autour d’un noyau. Plus concrètement, le narratif ne devait être dans le récit ni une finalité, ni même un moyen : il devait être le conflit. L’antagoniste. L’incitation à apparaître, la dopamine de la story, le pacte faustien d’offrir son histoire à un système, devaient étreindre le texte. Il était nécessaire que le roman soit lui-même en proie à l’envie de céder à l’intrigue. Le conflit, donc, oui, s’exprime dans le fond et dans la forme. Il est intérieur. Être ce que l’on dit. Dire ce que l’on est.
2 – Comment avez-vous imaginé et pensé votre roman au regard de la littérature et du cinéma? D’où vous est venue l’idée de cette « Ville » languienne, de ce « Feuilleton » orwellien, de cette « Production » posthollywoodienne quasi sophocléenne (où nous retrouvons l’allégorie du labyrinthe et de l’énigme) ? Votre roman se veut-il donc un tissage des 5e et 7e arts afin de renouveler l’approche de ces médiums à l’heure de leur déclassement et de leur impuissance à parler du monde actuel, à savoir : du délitement politique et social face à une certaine forme de dictature psychologique du numérique avec les « pratiques » imposées par les réseaux sociaux, mais également par l’imposition de l’info en continu et des séries comme nouvelles normes cognitives et culturelles de raisonnement et de connaissance, bien différentes de celles proposées par le cinéma et la littérature ?
Oui à tout cela, mais pour ce qu’il est de la conception, l’intuition vient avant le concept. Sinon, là encore, j’en viens à pressentir la pose. La ville, c’est moi-même. J’ai un processus d’écriture très direct : je recense mes obsessions. Je les relate en les poussant à l’extrême. Et ce faisant, je réalise qu’elles constituent des contradictions les unes vis-à-vis des autres, donc des conflits, donc potentiellement des personnages. Magnus est une obsession poussée à l’extrême, Lo également, Brandon Marsac également. J’ai l’air d’éviter la question, mais j’y viens : dans le cas de Brandon Marsac, ce dernier remonte à plus loin. À un livre précédent, principalement (et raté). Il y était le narrateur, et habitait la ville que l’on retrouve dans L’Empire : la ville, avant qu’elle ne devienne son feuilleton, et avant qu’elle ne fasse de lui un roi. Avec Marsac, j’avais pour la première fois dans mon écriture, trouvé un axe, une force centrifuge. D’une manière ou d’une autre, je savais qu’il fallait que je reste avec lui pour la suite, mais il fallait également que je m’en éloigne, pour accroître l’ampleur de ma voix et de ma « littérature ». En somme, il fallait pousser le curseur de l’obsession encore plus loin, l’étaler dans le temps, aggraver sa propre monstruosité. La question, c’était : que Brandon Marsac deviendrait, si pendant quinze ans, il était encouragé dans ses névroses, et que cette ville devenait la sienne ? Et, surtout, comment les parts inaltérés de moi-même réagiraient face à cet envahissement du cauchemar ? Brandon, Magnus, Lo et le feuilleton sont nés ainsi. En réaction à des évolutions hypothétiques, à ce qu’auraient pu devenir, dans certaines conditions, différents reflets intérieurs. Le concept se tisse ensuite naturellement, par pure déduction, en toute logique. C’est peut-être décevant à entendre, mais je n’imagine pas qu’un mouvement puisse être un mouvement s’il n’est pas un mouvement intérieur.

3 – On peut dire que votre roman a tout du récit initiatique, sinon d’un véritable bildungsroman à la Goethe (Wilhelm Meister), mais aussi à la Herbert (Dune). Pouvez-vous ainsi nous raconter comment vous avez mené ce chantier littéraire dont l’ampleur nous montre qu’il a dû vous demander une somme de travail titanesque, mais aussi de longues années d’élaboration, de réflexion, de remise en question ? Quelles en ont été les principales embûches, les plus importantes difficultés pour vous ? Comment avez-vous organisé la rédaction de ces 670 pages puissantes et réjouissances, également fluides et complètement addictives ? Comment êtes-vous devenu cette sorte de Goethe herbertien du 21e siècle ?
Je n’ai ni lu Wilhelm Meister, ni Dune. J’ai appris à écrire seul, et je lis peu (ou pas autant qu’on pourrait le croire, en tout cas). Mais la nature de récit initiatique m’est apparue évidente dès le début, oui. De par notamment le rapport personnel, intérieur, qui lie Magnus à Brandon, explicité dans ma précédente réponse. D’une certaine façon – ce n’est sûrement pas très commun – le livre a presque été un roman initiatique en direct: il m’a initié autant que je l’ai initié. Je l’ai commencé, davantage en tant que scénariste, et je l’ai terminé, totalement en tant qu’écrivain. Je m’y étais attelé avec un plan très structuré et des habitudes narratives, et la littérature m’a englouti à travers un temps d’écriture que je n’aurais jamais imaginé si long. On peut dire que l’absence a submergé mon empire : de par cette cohésion de la forme et du fond évoquée plus haut, j’ai moi-même vécu l’initiation. Pourtant, tout était conscient dès le début – je ne pensais simplement pas que cela exigerait autant de moi-même. Le corps a parfois beaucoup souffert. Pour revenir plus précisément sur le processus, j’ai établi en 2011 un plan minutieux, quelque chose de très élaboré, qui m’a servi de guide pendant les six années de l’écriture et duquel je n’ai quasiment jamais dévié. Comme on doit le sentir à la lecture, le récit ne survole pas l’action (à la manière des récits littéraires plus classiques, qui représentent souvent « la fuite du temps » comme dit Proust) : il propose plutôt une succession de blocs, de séquences au présent, à travers lesquelles on raconte ce qui s’est potentiellement passé durant l’ellipse précédente. C’est le résultat de cette structure scénaristique poussée, qui m’offrait une succession de scènes précises, que je pouvais alors réaliser comme un metteur en scène à travers la littérature. On peut presque dire qu’il y a eu deux romans : l’écriture de son plan, de sa forme scénaristique, une espèce de livre plat et sans style, et ensuite l’écriture de sa littérature. Ce que je n’avais pas prévu durant le plan, cependant, mais que j’ai compris à l’écriture et donc exploité, c’est que cette rencontre entre structure scénaristique et littérature, cette forme de « littérature en séquence », avait pour conséquence de créer des tableaux. Un enchaînement, oui, de scènes fixes, au présent. À la fois habitées en pensées et visuelles, à la fois intérieures et extérieures. Or, sans trop en dire, c’est précisément ce que la vie de Magnus est destinée à devenir dans le roman : des tableaux. Il habite, il pénètre, l’art de Lo, cette peinture en apparence révolutionnaire et libre, autant que cet art ne l’habite et ne le pénètre lui. L’Empire et l’Absence raconte une lutte, mais également un envahissement. C’est un récit initiatique, donc c’est aussi une histoire d’amour. La forme, plus que jamais, s’avérait ainsi à mes yeux en cohésion avec le fond, mais non plus de manière double (le roman travaillé par le narratif, comme Magnus est travaillé par le roi), mais de manière triple, puisque ce conflit, ce duel interne à la forme, accouchait en s’entremêlant d’un récit semblable à une exposition. Cela permettait d’embrasser le fait que Magnus, en réfutant la narration, pense travailler pour le roman, c’est-à-dire pour sa propre différence, pour sa singularité parmi l’Empire, sans comprendre que sa vie est parallèlement récupérée en tant que peintures. Dès les premiers chapitres, j’ai donc réalisé que les trois personnages s’incarnaient dans la forme : Brandon Marsac dans la narration, Magnus Gansa dans la littérature, et Lo DeLilla dans la résultante de la tension entre les deux, dans ces tableaux de scènes fixes. Pour être honnête, je ne suis pas sûr de pouvoir un jour refaire cela dans ma vie : j’ai l’impression d’avoir réussi à atteindre une forme de summum personnel dans la maîtrise à la fois narrative et littéraire. Les deux sont des muscles qui se travaillent. J’ai écrit L’Empire et l’Absence à l’époque de ma vie où les deux étaient parfaitement aussi musclés. Quand narratif et littérature, l’un en phase descendante et l’autre en phase ascendante, étaient au même niveau. Je suis, pour le pire et pour le meilleur, passé définitivement du côté de la littérature à présent. Il me semble qu’il existe un moment, dans la vie où la jeunesse et la sagesse se croisent et se superposent : L’Empire représente pour moi ce moment-là.

4 – Magnus Gansa – originaire de la « Ville » et acteur de son état – est peu enclin à apparaître dans le « Feuilleton ». Il a pourtant participé à la conception du projet démiurgique. Mais, à présent, Gansa s’y oppose et cherche une alternative permettant à chacun de redevenir maître de son existence. Narrateur de ce récit-monstre qui, à bien des égard, à des accents proustiens sinon musiliens – ayant conscience de l’Empire autant que de l’Absence, il nous semble, de par sa manière d’évoquer l’emprise du « Roi » sur les esprits, le sort des habitants, l’absurdité de cette existence filmée comme l’oppression de cette « Ville » sombre et irréelle, avoir aussi un petit quelque chose de très kafkaïen et de languien. Gregor Samsa, Joseph K. ou encore Freder Fredersen vous ont-il inspiré, ou est-ce un personnage totalement inspiré d’un homme qui existe, tel Alex Gansa, le scénariste et producteur de télévision américain ? L’héroïne Lo DeLilla semble inspirée elle-même de l’écrivain américain Don DeLillo, sinon l’avatar féminin de son « double », le personnage de David Bell, jeune cadre brillant de la télévision qui finit un jour par tout plaquer pour entreprendre le projet d’un film personnel, œuvre cinématographique infiniment complexe dont le secret est le sujet même d’un roman qu’il démarre en parallèle… et que nous lisons sans doute à travers Americana… le premier roman de DeLillo ! Quelles sont les figures, tant en littérature qu’au cinéma ou dans d’autres domaines, qui vous ont guidé, influencé, inspiré et qui se fondent, dans votre roman, avec vos personnages ?
Tout d’abord, Magnus n’a pas participé à la naissance du projet démiurgique, mais c’est une erreur de compréhension récurrente. Elle m’est donc imputable. Autant en profiter pour éclaircir ce point : Magnus n’a pas pratiqué le feuilleton, il a pratiqué le soap, soit la dernière réminiscence, dans la ville, du monde écrit. Il est un acteur, un fils de bourgeois pour le dire ainsi, qui croit encore au concept d’apprentissage. Lui et son père sont des individus désuets, dans un monde où les vainqueurs sont ceux qui vivent dans l’instantané, et qui plus encore acceptent de perdre dans l’instantané. C’est un peu la phrase de Nietzsche, que je citais dans mon mémoire universitaire sur la télé-réalité, et que j’aurais pu utiliser dans L’Empire si je n’avais pas été si déterminé à proposer un roman libre de toute influence, une œuvre totalement libre et semblant venir de nulle part, comme émergée d’un autre monde : « L’art des artistes doit un jour disparaître, entièrement absorbé dans le besoin de fête des hommes : l’artiste retiré à l’écart et exposant ses œuvres aura disparu : les artistes seront alors au premier rang de ceux qui inventent pour la joie et pour la fête ». Donc, non : Magnus n’a jamais vécu dans le feuilleton, Magnus n’a jamais été dans l’instantané. L’évocation de Alex Gansa est amusante, je ne m’attendais pas à ce qu’on m’en parle, mais elle est juste. Ce n’est néanmoins ni un clin d’œil, ni une source d’inspiration (comme dit plus haut, Magnus est le résultat d’un travail plus personnel… encore que, dans les ébauches initiales du roman, où Magnus était un personnage plus absurde et plus drôle que ce qu’il n’a fini par devenir, je confesse avoir pensé un instant à Bartleby). De Alex Gansa, Magnus tient le nom simplement parce que, en terme de phonétique, en terme de froideur, il correspondait bien au prénom de Magnus, qui est venu presque immédiatement. De plus, à l’époque – nous étions en 2011 – Alex Gansa ressortait d’une longue « traversée du désert », comme on dit (je le suivais depuis les années 90, avec X-Files), ce qui lui conférait une originalité très étrange : il n’y avait encore aucune photo de lui sur Internet (cela a changé dès son succès avec Homeland). Une autre raison, mais sans doute un peu inconsciente, qui m’a poussé à l’associer à Magnus. Pour Musil, Proust, Kafka, DeLillo : aucune forme de littérature n’a inspiré L’Empire et l’Absence. Pas profondément en tout cas. J’ai commencé à lire les auteurs en question (et plus généralement à m’intéresser sérieusement à la littérature) lorsque j’étais déjà bien enfoncé dans le livre, et à ce stade, plus rien ni personne ne pouvait m’influencer. Pas une question de prétention : tout ce qui m’inspire doit remonter loin. Sinon, il est très difficile de réellement « être » au lieu de « dire ». Donc aucun lien avec les quatre écrivains cités plus hauts, que par ailleurs, mis à part Kafka, j’aime peu. Il est préférable que je ne commence pas à expliquer pourquoi, les raisons sont trop précises et différentes pour chacun d’entre eux, elles sont aussi sûrement parfois très subjectives (pour DeLillo, je n’ai pas lu America, cela dit, seulement Outremonde et Bruit de fond). Mais, quoi qu’il en soit, j’ai eu la chance ou la malchance de commencer à lire les grands auteurs lorsque j’étais déjà suffisamment enfoui dans ma propre littérature. C’est quelque chose que j’évoque avec Lo, dans l’épilogue (l’idée d’éclore au cœur de la connaissance, en découvrant ses références a posteriori). Comme dit plus haut, cela a fait de moi un lecteur sévère. Mes principales inspirations viennent de la déchirure, du rêve, de la télé-réalité, du cinéma. Je ne veux surtout pas faire croire que je méprise la littérature : je la mets au-dessus de tout. C’est pour moi le domaine du sacré, le moment du jugement : ce que l’on pense, lorsque on l’écrit, lorsqu’on l’intègre au texte, est immédiatement mis au défi par la visée esthétique. C’est un délice de ressentir à quel point l’exigence de beauté, dans la littérature, finit par transformer nos pensées. Mais enfin, oui, il y a l’idée de la littérature, et il y sa pratique, et je dois admettre que souvent je ne suis pas impressionné. Bref, vous l’aurez compris, malgré l’apparente évidence, même Lo DeLilla donc n’est pas une référence à DeLillo. Il aurait été quasi insupportable pour moi, au vu de ce que j’écris sur la liberté du personnage, que je fasse d’elle une référence. Plus généralement, pour en revenir à ma marotte « d’être ce que l’on dit », pour parler d’un Empire, il faut faire un Empire. Pour parler d’un Roi, il faut faire un Roi. C’est-à-dire créer un monde clos et souverain, où rien ne peut envahir l’intérieur. La référence ne pouvait avoir sa place : l’extériorité devait être annihilée. Mais au bout du compte, maintenant que j’y pense, il y a un lien entre DeLilla et DeLillo, et il est précisément dans la non-référence. On m’avait conseillé, si je n’assumais pas la ressemblance, de la renommer, ce que je n’ai pas voulu faire, estimant que Lo n’avait pas à céder devant Don. La connexion finalement est là : Lo DeLilla ne s’appelle pas ainsi pour DeLillo, elle s’appelle ainsi malgré DeLillo. Elle va par-dessus. Elle l’ignore royalement.
5 – Quand votre personnage dit : « C’était parce que je n’avais pas accès à son art, que son art existait », pensez-vous qu’il en est de même pour votre roman dans cette société qui est la nôtre ? Pensez-vous que c’est parce que l’on n’a pas accès à l’écriture de ce roman, du moins à son secret – notamment en raison du cryptage des références – que votre roman existe, c’est-à-dire que sa réalité dépasse la fiction (le feuilleton) que l’on pourrait y voir si on y avait justement trop facilement accès ?
La phrase que vous citez est une évocation du principe de l’absence. C’est parce que quelque chose manque extérieurement qu’il naît intérieurement. C’est parce que le mystère est absent, qu’il est présent. D’où la quête de Lo, cette peintre dont l’art se nourrit du fait qu’il nous échappe, qui est une quête d’absolu. Ensuite, si vous voulez dire que le roman existe, parce qu’il n’existe pas en tant que feuilleton, oui : c’est sa raison d’être. C’est son conflit intérieur, ce qui le fait battre et provoque l’enfoncée. Mais j’ai déjà traité de cela dans ma réponse à la première question.

6 – Il y a également des références et des objets – au sens le plus matériel du terme – issus de plusieurs univers qui jouent le rôle de « motifs » dans le roman (archives, lettres, rushes, clé, sein, peintures, etc.), à la manière même où Henry James parlait de « motif dans le tapis », c’est-à-dire qui nourrissent le « secret » de l’intrigue tout en l’inscrivant dans un « environnement » culturel. Quels sont vos univers de prédilections, vos références personnelles, comment avez-vous juxtaposés les uns aux autres ? Il nous semble que votre roman n’est que le tissage d’innombrables cryptages et de clins d’oeil tant tirés de la littérature que du cinéma, et évidemment des séries…
La clé est une autre incarnation de ce rapport entre le fond et la forme, de cette narration, de cette tentation du roi, qui s’insémine dans la chair même du texte. C’est une espèce de MacGuffin, ces objets-prétextes des films d’espionnage, devenu ici actif, démoniaque, qui continue à générer de la narration même quand celle-ci est finie. On retrouve un peu la même idée dans le chapitre 12, quand un instant Magnus quitte le roman, avant que Brandon Marsac littéralement ne le rattrape et ne ramène sa voix, en tant que narrateur, dans le texte. Magnus veut quitter l’histoire, entrer dans le néant, tomber hors de la page – mais l’intrigue elle ne veut pas que le roman s’achève. C’est ce que représente la clé. Elle ouvre la possibilité de l’éternité du roi. C’est-à-dire l’infini du narratif. C’est-à-dire l’impossibilité d’être libre. Le désir d’avoir une histoire, le vouloir-vivre du spectacle, qui n’en finit jamais, qui nous poursuit même quand l’on croit avoir échappé à l’Empire, car le désir d’avoir une histoire s’étend au roman lui-même. Mais, encore une fois, il n’y a quasiment aucune référence dans le livre, et quand je commettais l’erreur d’en faire (généralement involontairement, parfois en reprenant une idée ou une tournure de phrase), je les supprimais. L’inspiration première est la télé-réalité. Très principalement Secret Story (un programme original, qui n’a pas été importé, et qui est à mes yeux l’une des plus belles œuvres que la France ait produites ces dernières années), The Hills et Jersey Shore. Le Glamorama de Bret Easton Ellis, parce que sa lecture est lointaine, quasiment oubliée, y est aussi pour quelque chose : elle avait eu, alors, le temps de fermenter, de dépasser le concept, de s’introduire dans mes propres intuitions et dans ma vie, pour que le tout devienne naturel. David Lynch, que j’ai découvert tout petit, a également provoqué une déchirure en moi : une ouverture au rêve. Mais là encore, je ne dirais pas que c’est une référence, plutôt une origine. Il m’a retourné. Emmené vers la nuit. Après, effectivement, j’ai vu beaucoup de films et de séries, mais leur impact sur mon imaginaire, je crois, est maigre. Ils ont davantage contribué à entraîner mes muscles narratifs, comme expliqué précédemment, ma compréhension de la structure, plutôt que de véritablement nourrir mon cœur. Bon il y a Lost, qu’il m’est impossible de ne pas citer, car elle a stimulé l’inconnu en moi, et qu’elle me manque chaque jour. Mais Lost est trop proche. Lost sera même sûrement toujours trop proche. Là encore, c’est une déchirure. Peut-être aussi dois-je citer quand même la philosophie, que je trouve régulièrement supérieure à la littérature. Plus rigoureuse, même souvent plus belle. Je ne suis pas sûr qu’elle m’ait influencé si fortement, mais elle a l’avantage de formaliser des notions chez moi intuitives, et c’est pour cela que contrairement à la fiction je suis capable de davantage la digérer : elle influence moins qu’elle n’offre un vocabulaire. Ou, plus qu’un vocabulaire, un élargissement du descriptible. Je ne parle évidemment pas de la philosophie politique ou éthique : je parle de la philosophie qui se frotte au mur de la chose en soi. J’ai lu et aimé Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard. Même Baudrillard ou George Steiner. Sans eux, le roman existerait, mais n’aurait pas toujours en certains endroits exactement la même langue.
7 – Pour vous, le 8e art – celui des images et des séries – recouvre-t-il au bout du compte tous les autres ? Vous qui êtes issu professionnellement du milieu de l’audiovisuel, quelle est votre position vis-à-vis de la télévision qui a envahi notre quotidien et des séries qui semblent envahir nos existences toujours plus, au point que, bientôt si ce n’est déjà, notre vie ne sera plus rien d’autre qu’un simple défilé d’images en vue de produire des « stories » exploitables commercialement et politiquement, tel que le fait déjà Facebook ?
L’on peut dire que j’ai pris 672 pages pour répondre à cette question. Au-delà de ça, ma position personnelle n’a pas d’intérêt. De plus, elle serait hypocrite de la part de quelqu’un qui s’en est nourri : je suis reconnaissant de ce qui me nourrit. Je dirais simplement qu’en littérature (et sûrement plus qu’en littérature, mais je vais me limiter à ce que je connais), on ne peut pas critiquer quelque chose, si on ne l’aime pas. Sinon, là encore, pose. Idéologie, politique, morale. Houellebecq disait aussi : quand on écrit un roman, il faut perdre. Ceux qui lui reprochent d’être trop flegmatique et concis, trop réfléchi et calculateur, ignorent justement que ce sont là les qualités d’un professeur et d’un maître : je suis sûr que Houellebecq serait capable d’écrire un excellent manuel de littérature. Enfin, oui, la critique doit être amour, passé ou déçu, peu importe. Intérieure, en tout cas. C’est une des raisons qui fait que j’ai toujours été un peu méfiant du genre de la dystopie, qui souvent va « dénoncer », « prendre position », c’est-à-dire exercer un discours qui pourrait être tenu dans un cadre autre que la littérature, et qui donc à mon sens n’a rien à faire avec la littérature, puisque j’estime que celle-ci ne doit concerner que ce qui est impossible à exprimer autrement, tout ce qui, en dehors d’elle, est une impasse et inaccessible. L’Empire et l’Absence est une dystopie, c’est vrai. Mais une dystopie personnelle, intérieure, de l’être. J’utilise le monde pour me décrire. C’est dit, à un moment donné, d’ailleurs : le monde était bien tombé. J’assume la monstruosité. Je serais un enfant si je l’affiliais au monde et la circonscrivais là, bien loin de moi, en prenant position. En gros : si tu n’es pas le problème, n’écris pas sur le problème.

8 – Nous avons évoqué Orwell plus haut car, tout comme lui dans 1984, votre roman semble prophétiser un futur proche : celui où, à force d’en passer par les écrans, notre vie n’aura nulle autre fonction que celle d’être filmée et mise en forme par ceux qui sont déjà aux manettes des plateformes de streaming, des moteurs de recherche et autres réseaux sociaux afin de nous imposer une « réalité », donc des façons de vivre et de penser édités selon des principes d’inclusion et d’exclusion propres aux dictatures et dont de nombreux écrivains et réalisateurs ont déjà pu développer les formes qu’elles prendraient à travers les écrans et la surveillance globale. Votre roman est-il le reflet de vos craintes, de vos questionnements quant à la tournure que prennent les choses en ce monde toujours plus conditionné, délimité, organisé, et enfin, ultra connecté et digitalisé ?
Je n’ai aucune crainte. Je me fiche totalement de ce qui peut arriver au monde. Cela m’intéresse, de toute évidence, et me nourrit, mais je trouve tout à fait absurde l’idée de vouloir le changer, ou de le rapprocher de notre vision des choses. En outre, si je développe davantage ma réponse à cette question, je vais parler de la littérature qui m’occupe à présent, or je crois beaucoup au secret. Ce qui répond quand même à la question, au bout du compte.
9 – En cette rentrée 2020 qui, comme chaque année, déverse son lot de romans aussi insipides que médiocres, sans forme sinon complètement informes, sans langue parce que justement sans « écriture », et dont la nullité n’a d’égale que l’ennui qu’ils procurent, votre roman apparaît comme une sorte d’ « olni », mais surtout comme un astre d’une intensité hors du commun qui vous place d’emblée comme cet auteur qui dépasse et surpasse la masse, le nombre, la platitude de la littérature française contemporaine dont les centres d’intérêt vont des migrants au yoga en passant par la physique quantique mal digérée, sans parler des sempiternelles secrets de famille frelatés et sans aucune envergure noétique ou spirituelle. Vous êtes ainsi l’auteur d’un seul livre, mais déjà d’un livre qui représente presque l’œuvre d’une vie. Si votre roman est un tour de force, un diamant indescriptible dans la fange littéraire industrielle, il n’en reste pas moins ignoré des instances et des critiques qui devraient, pourtant – vu le peu d’avenir qu’il leur reste encore – se jeter dessus du fait même qu’il révèle une dimension de la réalité qui les concerne au premier chef. Que pensez-vous donc de ce silence assourdissant, de cette « absence » d’intérêt à l’égard de votre roman de la part de l’Empire littéraro-médiatique ? Finalement, la présence miraculeuse de votre roman en ce monde éditorial corrompu et inepte n’est-il pas le signe que, tout comme Magnus Gansa, nous avons les moyens de trouver une porte de sortie, une alternative à ce que le « Système » nous impose partout, jusque dans notre imaginaire, notre intimité, c’est-à-dire, au fond, notre vie elle-même ?
« Ah c’est une très bonne question, c’est une très bonne question » (comme disent les gens quand ils surtout contents d’entendre les compliments qu’on leur fait). Bon. Je ne pense pas que le monde « littéraro-médiatique » soit un Empire. Je pense que je suis l’Empire. Donc, au-delà de cette saillie compréhensible, je l’espère, au vu de ce que j’ai dit précédemment sur le mouvement intérieur et la monstruosité assumée, la réponse est oui. C’est simple, le bonheur qui dépend de l’extérieur, n’est pas un vrai bonheur. On écrit pas un livre comme celui-là sans avoir déjà préalablement démissionné du monde. La séparation est a priori. Le roi le dit dans le livre, d’ailleurs. Pour construire une telle ville, il faut embrasser le fait que le monde ne saura jamais assez grand pour nous rendre la pareille. Tout cela, je le savais déjà en planifiant L’Empire. Et par ailleurs, je ne pense pas que ce soit juste l’œuvre de ma vie.

10 – Une dernière question en guise d’explication, ou de révélation – qui sait ? Expliquez-nous ce que nous devons comprendre de votre geste d’écriture, de votre projet d’écrivain, de votre entendement foncièrement fictionnaliste par ce propos de votre roman : « C’est quand même simple, et nombre de morts marchent avec moi, sur le sujet – la nature n’est pas la réalité. Et le faux n’est pas ce qui fait dériver l’homme en dehors du vrai ; le faux est la seule analogie possible du vrai, le seul moyen d’atteindre une reproduction de l’absolu autrement inaccessible ».
Je ne suis pas bien sûr exactement de ce qu’est le fictionnalisme. Ou de comment mon écriture pourrait s’y référer. Disons que si c’est le fait d’arriver au vrai par le faux, au réel par la fiction, alors peut-être. Certains passages vont sûrement dans ce sens : je pense spontanément à celui où Magnus revient sur les fictions de sa propre vie, comme le feuilleton, le soap ou la série de son père, et estime qu’elles sont pour lui la seule façon de comprendre son existence. Plus généralement, je suppose aussi qu’il est possible, en y réfléchissant bien, que mon processus d’écriture soit une forme de fictionnalisme intérieur : j’extrémise des parties de moi-même, je les fictionnalise en tant que différentes alternatives, pour accéder à une totalité plus véritable. Je le disais plus haut, je suis la ville. Soit le reflet unifié, la somme des différentes hypothèses, des différents fragments d’imaginaires. Donc fictionnalisme, peut-être, mais au service de la nuit, de l’âme. Si l’écriture éclaire le monde, pièce après pièce, comme une tapisserie plate, comme un puzzle du réel, tant mieux, mais c’est presque accessoire pour moi, c’est une conséquence de la structure narrative pour ainsi dire. Je désire moins reformer ou révéler, que trouer, créer une fuite, passer de l’autre côté. Par rapport à la phrase citée, je parle de l’implant mammaire, et même si vous l’avez coupé pour resserrer le sens sur son allégorie centrale, je vais quand même reprendre cet exemple. Le sein naturel, que l’on qualifie à tort de vrai sein, est un héritage matériel et hasardeux ; l’implant mammaire, que l’on qualifie à tort de faux sein, est une transformation, une appropriation du corps. La source nourricière est inversée, renversée sur elle-même : elle ne nourrit plus l’autre. Elle nourrit sa propre forme. Ce n’est pas parce que l’on hérite de quelque chose que c’est vrai : c’est parce qu’on le transforme. Tout ce qui permet de rapprocher la matière de la pensée, est une façon de quitter le faux pour le vrai. Je ne sais pas si c’est ce que je pense – mais c’est ce que Brandon Marsac sait.
Entretien © Léo Strintz & Caroline Hoctan – Illustrations © DR
(Paris, oct. 2020)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
