BRUCE BÉGOUT s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son essai, OBSOLESCENCE DES RUINES – ESSAI PHILOSOPHIQUE SUR LES GRAVATS (Inculte-Dernière Marge, 2022) :
1 – Bruce, tu es spécialiste de la phénoménologie et d’Edmund Husserl, auquel tu as consacré ta thèse de doctorat en 1997, publiée sous le titre La Généalogie de la logique: Husserl et la question du statut phénoménologique de la passivité (éditée chez Vrin en 2000), et plus récemment de ton HDR (Logique du monde prélogique, suivi d’un inédit Le Concept d’ambiance, édité au Seuil en 2020). Tu as dans un premier temps publié certains de tes travaux universitaires (sur Maine de Biran, sur Husserl), et c’est avec Zéropolis (Allia, 2002) que tu t’es fait connaître au-delà des cercles universitaires, ouvrage qui a été suivi d’essais – que l’on peut qualifier de « phénoménologiques » tant dans leur approche que dans leur traitement – sur les banlieues, les motels, Orwell, Las Vegas, la route, la ville, le quotidien, etc. Cette partie de ton œuvre, très importante du point de vue de sa pertinence de réflexion et de son angle d’ « attaque », en cache également une autre qui, avec les années, s’impose toujours davantage dans le paysage littéraire français par son exigence : la fiction. Peux-tu nous retracer ton parcours, nous expliquer ce qu’a représenté pour toi la phénoménologie comme « ossature » de ta pensée et de ton engagement philosophique, et celui de la fiction comme « chair » – en quelque sorte – de cette même pensée ?
En vérité, je me suis retrouvé là un peu par hasard. Lorsque j’étais lycéen, mon projet de vie, si je puis dire, était de me consacrer au cinéma, sous une forme ou sous une autre. Bien sûr, la réalisation en tant que telle m’attirait, et mon adolescence avait été imprégnée par l’influence magique et profonde qu’avaient eu sur elle certains films, certains réalisateurs (Kurosawa, Tarkovski, Welles, Paradjanov, Wenders, Franju, etc. ). En terminale, mes bons résultats d’ensemble (je ne voulais pas poireauter une année de plus au lycée et avais mis les bouchées doubles) firent que l’on me conseilla de déposer un dossier pour entrer en classes préparatoires. J’avais noté que l’hypokhâgne du lycée Montaigne de Bordeaux proposait une option « arts plastiques » avec, ce qui m’intéressait au premier chef, incluse en elle, une initiation au cinéma. Comme mon but était de présenter l’IDHEC (de nos jours la Fémis), je m’étais dit que cela me donnerait à la fois une bonne formation généraliste et constituerait déjà un premier pied dans le monde du cinéma. J’ai donc intégré et fait cette hypokhâgne. Mais les choses ne se sont pas tout à fait passées comme je l’avais prévu. Lorsque j’ai intégré l’ENS-Ulm en 1989, en option « arts plastiques » (je crois que je dois être le seul de mon espèce), un dilemme se présentait à moi. Devais-je poursuivre le rêve de présenter l’IDHEC ou faire un parcours plus classique à l’école au sein du département de philosophie (car, même si j’étais inscrit en arts plastiques, je suivais dans mon cursus universitaire un parcours philosophique classique) ? Pendant deux années, je n’ai pas choisi et j’ai fait les deux (maîtrise et DEA d’esthétique et de philosophie). J’étais inscrit à Paris I en philosophie et en arts plastiques. Mais, peu à peu, je me suis rendu compte que le plaisir pris à l’analyse et à la théorie l’emportait au fond sur la volonté d’art au sens même d’Aloïs Riegl, que j’étais plus une tête analytique que créatrice. J’ai donc délaissé peu à peu le projet initial de suivre une formation cinématographique et me suis investi de manière plus régulière et plus personnelle dans la voie philosophique, en passant l’agrégation tout d’abord en 1991, puis en m’inscrivant en thèse de philosophie en 1993. Mais, à cette époque, même si j’avais abandonné la voie cinématographique, je n’avais pas renoncé néanmoins à toute expression artistique. En effet, je me suis mis à écrire très tôt, c’était sans doute matériellement plus facile à faire que de louer des équipements de prise de vue. Les années de l’ENS ont été ainsi partagées entre ma formation philosophique, qui devenait de plus en plus importante, et les projets d’écriture, tout d’abord poétiques, puis romanesques. Quant à l’orientation phénoménologique, elle tient sans doute à des rencontres décisives : celle avec mon professeur de khâgne à Condorcet, Serge Boucheron, homme et maître merveilleux, puis celle avec deux enseignants d’Ulm, Jean-François Courtine et Didier Franck. Ce sont leur cours et leurs séminaires qui m’ont initié à la lecture de Husserl, Heidegger, Levinas, etc. , et m’ont donné le goût de lire ces auteurs et leurs œuvres. Si ma maîtrise de philosophie portait sur le statut de l’expérience du sublime dans l’esthétique kantienne, et indiquait encore cette hésitation entre philosophie et esthétique, mon DEA, en s’intéressant aux relations entre Hume et Husserl, indiquait déjà le sens futur de mes recherches.
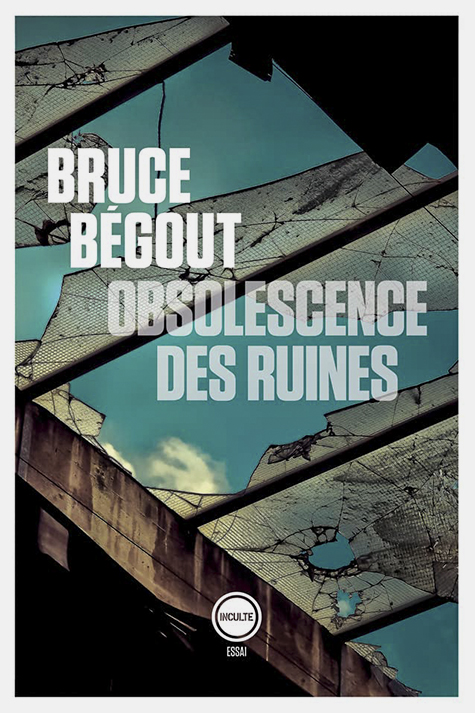
2 – Qu’est-ce qui a motivé tes recherches universitaires après ta thèse de doctorat sur la Lebenswelt chez Husserl ? Pourquoi lui avoir consacré un livre entier (L’Enfance du monde. Recherches phénoménologiques sur la vie, le monde et le monde de la vie, t.1 : Husserl, Éd. de la Transparence, 2007), suivi d’un autre sur la postérité philosophique de ce concept dans la philosophie allemande (Le Phénomène et son ombre. Recherches phénoménologiques sur la vie, le monde et le monde de la vie, t. 2 : Après Husserl, Éd. de la Transparence, 2008) ?
Sait-on vraiment pourquoi on choisit telle voie et non telle autre ? Il y a différents facteurs qui entrent en jeu : les appétences personnelles, le type de questions que l’on se pose et enfin les circonstances et les occasions dont parfois la puissance est grande. Sans doute fait-on la philosophie de l’homme que l’on est, comme le dit Fichte. Alors, je serais au fond un homo phenomenologicus. Ma manière de vivre et de penser devrait s’accorder avec l’esprit phénoménologique, notamment avec sa suspension méthodologique des explications causales et son rejet de l’objectivisme. Il y avait sans doute dans ce courant de pensée une fraîcheur, une volonté de mettre en avant l’expérience vécue et la description du monde qui me convenait. Et également, un rejet du naturalisme et de sa vision restreinte des choses et de leur genèse empirique. Plus sérieusement, j’avais commencé à travailler sur le concept de passivité et sur son histoire depuis Aristote. Peu à peu, j’ai pris conscience de son importance, surtout à partir de Kant. Novalis n’avait-il pas dit qu’il y avait quelque chose à dire en faveur de la passivité ? Je voulais montrer que la passivité n’était pas si passive qu’on le dit, qu’elle n’avait rien à voir avec l’inertie et la paresse, qu’elle exprimait une activité cachée, fondamentale, notamment dans la vie sensible et affective. J’avais donc monté dès 1991 un projet de thèse autour de l’archéologie du concept moderne, ni antique, ni médiéval, de passivité de Kant à Husserl en passant par Coleridge, Maine de Biran, Novalis, Feuerbach, Nietzsche et bien sûr Husserl. Mon directeur de thèse pressenti, Jean-François Courtine, me donna le conseil utile et sage de limiter mon champ d’investigations. C’est la raison pour laquelle, tout en travaillant de mon côté sur Maine de Biran et Coleridge (j’ai publié au milieu des années 90 des articles et des essais sur ces deux auteurs fondamentaux de la modernité), les premiers à penser la passivité autrement, autrement même que Kant, je me suis concentré sur la fin du cycle, à savoir sur Husserl, et sur le Husserl le moins connu, à savoir celui de la vie antéprédicative, et du monde de la vie en effet. Heureusement, je lisais l’allemand et me suis attelé à diverses traductions, dont le volume XI des Husserliana consacré aux synthèses passives. Ma thèse de doctorat (1997), La Généalogie de la logique, publiée chez Vrin en 2000, est presqu’entièrement un commentaire de ce volume XI. Je tente de montrer que, contrairement à une certaine lecture post-husserlienne, la vie passive de la subjectivité n’est pas pour Husserl une dimension réfractaire de l’expérience qui vient contredire son projet transcendantal de constitution de la philosophie en science rigoureuse, mais plutôt une dimension qui vient le consolider. Je n’ai pas vu dans la passivité le moment de décomposition du système, ce qui le met en échec, mais au contraire, dans la perspective de Husserl, sa fondation ultime dans la vie sensible, kinesthésique, affective. C’était prendre à rebrousse-poil toute une interprétation française de la passivité qui voyait en elle une expérience échappant à la fois à la subjectivité constituante et à son projet gnoséologique. À partir de là, je n’ai jamais abandonné le champ théorique de la phénoménologie et continue d’œuvrer en son sein, même si je l’ai souvent croisé avec d’autres, notamment avec celui de la théorie critique et du marxisme hétérodoxe (Lukács, Marcuse, etc. ). Pour moi, la phénoménologie, plus qu’un ensemble de méthodes et de dogmes, est une école de pensée, une école du regard, une école de l’écoute, une façon surtout de suspendre ce que l’on sait habituellement (ou que l’on croit savoir) et de tenter, avec le risque de naïveté que cela comporte, de tout reprendre à zéro. C’est, comme son nom l’indique, l’effort de produire un discours vrai sur les phénomènes, de proposer une description et une compréhension du monde phénoménal qui soient plus éclairantes et pertinentes que d’autres. C’est l’articulation avec ce que nous sentons et ce que nous pensons, le pont jeté par le concept entre l’esprit et le monde. C’est surtout la conviction que tout ne commence pas avec le Verbe, mais qu’il existe un monde perceptif et sensible extrêmement riche que les mots peinent à dire. C’est ce que je nommerai le principe des dix mille couleurs. C’est à peu près le nombre de nuances perceptibles que les scientifiques admettent pour la vision humaine. Face à ces dix milles couleurs ou nuances, combien de mots avons-nous ? Voilà « l’expérience muette » dont parlait Husserl, ce fonds riche, profond, multiple du sensible que le logos exprime avec ses moyens symboliques. Avant la signification, il y a le sens, avant nos expressions, l’expressivité infiniment plurielle du monde et de la vie. Le divers sans unité. Les choses, et leurs phénomènes, expriment un sens avant même que nous mettions en branle notre machine à interpréter.

3 – Martin Heidegger tient une place importante dans ton œuvre philosophique. Dans La Découverte du quotidien (Allia, 2005), aux côtés d’autres penseurs allemands comme Georg Simmel, Edmund Husserl, Jan Patočka ou Alfred Schütz, il te permet de dégager une phénoménologie du quotidien, notamment à partir de l’analytique existentiale du Dasein, dont tu intègres certains éléments dans une perspective critique de l’historialité, censée justement nous sauver du quotidien et de sa déréliction. Ton appréhension de Heidegger est philosophique avant d’être polémique. Tu n’hésites pas, par ailleurs, à mettre en exergue une citation de l’auteur de Être et Temps au début de ton recueil de nouvelles, L’Accumulation primitive de la noirceur. On sait parfaitement, par ailleurs, que les « engagements » du philosophe te répugnent. Tu n’es toutefois jamais intervenu dans la querelle française sur Heidegger qui a opposé Emmanuel Faye à certains de ses traducteurs et à un phénoménologue comme Gérard Guest. Pourquoi ce retrait ? Comment te situes-tu par rapport à cette polémique ? Faut-il, selon toi, « couper » le philosophe de ses « engagements » politiques ?
Comme nombres d’autres phénoménologues, je suis passé progressivement de Husserl à Heidegger et ai délaissé peu à peu, au milieu des années 2000, la perspective d’une phénoménologie de la connaissance pour celle de la vie, ou de ce que Heidegger nomme à partir de 1924 l’existence. Mais, de fait, ce tournant vers le monde de la vie, vers le monde concret et ordinaire de l’existence humaine dans le monde, est déjà opéré par Husserl lui-même notamment dans le tome II des Idées directrices rédigé pendant la Première Guerre mondiale. Tous les dépassements de Husserl sont déjà chez Husserl lui-même, notamment dans ses manuscrits de recherche. Ce qui est sûr, c’est que la langue et l’attitude générale de Heidegger change totalement de celle de Husserl. Elle nous force à prendre en considération les points de contact violents entre le contingent et l’inconditionnel. On peut le regretter, on peut y voir une sorte de virage dangereux vers l’incantation irrationnelle et antimoderne, mais on ne peut rester insensible à son appel comme à un chant de Sirènes venant de la Montagne Noire. J’avoue que le fait d’être d’abord passé par Husserl et sa sécheresse conceptuelle m’a gardé de sombrer dans une fascination totale pour Heidegger et son bel canto maléfique. Mais le fait est que nombre de problèmes que Heidegger se pose m’interrogent également, même son ontologie négative, sa théorie du laisser-être (Gelassenheit), son insistance sur l’indisponible. Si la philosophie est l’art de poser les bons problèmes, alors, pour moi, Heidegger demeure un philosophe essentiel qui est traversé, presque malgré lui, par une dualité constitutive des temps modernes, à savoir celle de l’installation et de l’errance. Car, contrairement à ce que l’on pense, et comme l’a vu et écrit Reiner Schürmann dans son Principe d’anarchie, Heidegger n’est pas tant le philosophe du sol, et des fantasmes nauséabonds d’enracinement dans le terrain communautaire et national qui vont avec, que celui de l’absence de sol, de l’Unheimlich, du fait de ne jamais être véritablement chez soi. Il y a chez lui comme chez d’autres, notamment les penseurs critiques et révolutionnaires, une mise en cause de ce que je nommerai le principe de prestation (Leistung) et la tentative de maintenir dans notre rapport au monde, aux autres, aux événements, bref à l’être envisagé comme cet advenir contingent et sans raison, une attitude qui ne relève pas de la prestation, de la fonction, de l’instrumentalité. Il serait exagéré de croire que tout ce qui échappe ainsi à la Leistung ne soit que de l’ordre du sacré, de l’indicible et du mythologique. Cela relève pour moi des attitudes les plus communes qui n’entrent pas dans la rationalité instrumentale. Mon travail consiste à traquer sous la couche prestative présente dans la vie de la pensée, mais aussi et surtout dans la vie quotidienne, en particulier urbaine, tout ce qui concrètement ne ressortit pas à cette fonctionnalité, à cette mainmise de la relation moyens-fins dans notre appréhension des lieux, des événements, des autres personnes. L’exergue de L’Accumulation primitive de la noirceur que tu mentionnes parle de cela, et les histoires racontées dans ce recueil également : des hommes se trouvent pris dans les dispositifs sociaux et architecturaux du fonctionnalisme qui les obligent à négocier à chaque instant avec le principe de prestation. Or le plus souvent, ils échouent à le faire, soit parce qu’ils s’identifient de manière excessive à lui jusqu’à la folie, soit parce qu’ils pensent naïvement qu’ils peuvent lui échapper par des attitudes immatures de rébellion et de provocation. Quant aux polémiques concernant l’engagement politique et l’antisémitisme de Heidegger, que dire ? La réception de l’œuvre de Heidegger a été en elle-même un Kampfplatz. Ce point serait trop long à développer, à démêler tous les fils de ces débats souvent biaisés par des idées préconçues et des provocations qui ne ressortissent pas à la recherche universitaire ou qui ne devraient pas en ressortir, à exposer à la fois l’unité problématique du chemin de pensée de Heidegger et à rendre compte de la manière dont il est de nos jours interprété. Il est incontestable, surtout après l’importante publication des Cahiers noirs, que Heidegger développe dans son œuvre une espèce d’antisémitisme métaphysique des plus idiots et des plus caricaturaux. Les pires préjugés du café du coin à Nuremberg en 1933 sont à peine maquillés dans la langue prophétique d’un harangueur de parvis. Cela doit-il nous conduire à ne plus le lire ? À ne plus tenir compte du reste ? Ni même à l’enseigner, comme un médiocre histrion des réseaux sociaux, en manque manifestement de présence médiatique et de pouces bleu, le propose ? Bien sûr que non. Au contraire même. On apprend plus à lire nos ennemis que nos amis, et j’ai pour ma part plus appris en lisant et travaillant des penseurs (Friedrich Nietzsche, Carl Schmitt, Eric Voegelin, Leo Strauss, etc.) dont je ne partageais en aucune façon la vision du monde hiérarchique et antisocialiste, et dont je combattais avec mes modestes armes les conséquences politiques, qu’en ajoutant des notes en bas de pages aux œuvres avec lesquelles j’étais déjà d’accord. Si le scandale a une vertu, il doit consister à nous obliger à une révision sincère et probe de nos présupposés. Or, il n’en reste pas moins que les élèves les plus talentueux de Heidegger, et qui ont été formés par lui, sous son égide quotidienne pour ainsi dire, Karl Löwith, Hans Jonas, Herbert Marcuse, Hannah Arendt, Günther Anders, sont juifs, et que manifestement, ils n’ont pas perçu dans sa pensée, qu’ils connaissaient de manière plus directe et intime que nos commentateurs contemporains enivrés par l’odeur capiteuse du scandale, un noyau antisémite si coriace qu’il les aurait prévenus d’aller plus loin dans la fréquentation intellectuelle de l’homme.
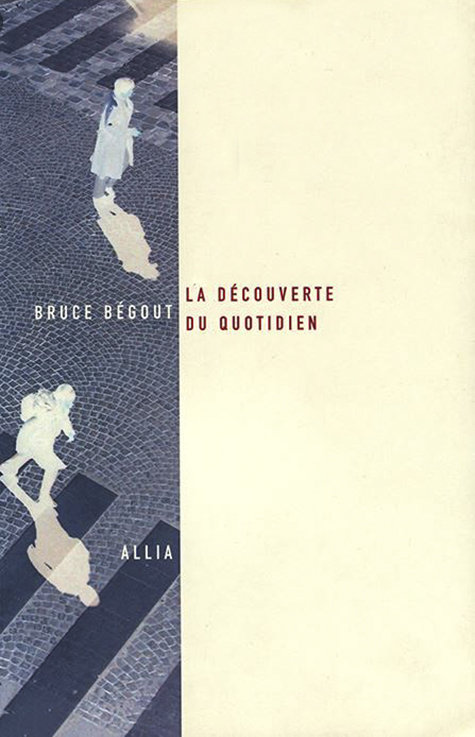
4 – En 2007, tu publies Pensées privées : Journal philosophique (1998-2006) (Jérôme Millon, 2007), où l’on ne trouve rien d’intime, mais des réflexions ponctuelles, écrites au fil de l’eau, une sorte de laboratoire critique où s’esquisse en quelque sorte le chantier de certains de tes livres. Pourquoi publier un tel journal, quelque chose qui n’est pas encore élaboré, tâtonnant ? Cela répond-il à la volonté d’introduire dans la philosophie des réflexions journalières, des matériaux bruts, concrets. Bref, de revenir encore et toujours « à la chose elle-même » ?
Oui, c’est un journal impersonnel, entièrement consacré à l’enregistrement quasi journalier de pensées, et non un journal fait d’impressions et de commentaires sur ma vie et le monde. Même si, de fait, au travers des méditations ainsi transcrites, on doit pouvoir retrouver en creux un autoportrait intellectuel et un état du monde. Mais dans ce journal, je voulais vraiment me consacrer exclusivement à des réflexions liées à mes lectures, à mes travaux, à mes réflexions. C’est comme un cahier préparatoire en vue de futurs projets, et d’ailleurs nombre de livres sont nés dans ces cahiers, celui sur la dérive situationniste, sur les atmosphères, sur l’acosmisme. J’ai toujours rempli des cahiers entiers de réflexions diverses et ce afin qu’elles ne se dispersent pas, puis ne disparaissent. Le journal philosophique permettait à cette époque de les rassembler, de les classer même. Il y avait là pour moi un exercice quotidien de clarification de la pensée. Mais peu à peu, cet objet est devenu presque trop important. Il réclamait comme un animal affamé tous les soirs de longues heures de méditation au détriment d’autres occupations intellectuelles, ou non. Aussi ai-je mis un terme à cette pratique vers 2007. Bien des années après, j’ai appris qu’Enzo Paci avait tenu en Italie dans les années cinquante un Journal phénoménologique. Au-delà de cette coïncidence, mon travail porte également sur le monde quotidien et les moyens de contrecarrer l’invisibilisation dont il est souvent la victime, quand ce n’est pas la stigmatisation comme domaine terne, banal et contraignant. Or, la forme du journal participe de l’intérêt nouveau que les hommes modernes portent à leur vie quotidienne, aux mille et un détails insignifiants qui la remplit, aux choses changeantes, aux routines persistantes. On le voit chez Maine de Biran, comme chez Stendhal son lecteur. L’idée de faire un compte-rendu de la journée prend donc un nouveau sens dans le monde moderne de la sollicitation permanente. C’est une sorte de bilan spirituel du soir, de réflexion plus ou moins profonde, plus ou moins sincère, comme une auto-confession sans absolution qui précède l’annihilation totale dans le sommeil et joue le rôle d’une ultime mise au point jusqu’au lendemain. Pris dans ce maelstrom d’événements minuscules et de sensations fugaces, l’individualité liquide de la modernité cherche sans doute par là un moyen compensatoire de fixation du caduc. C’est revenir à soi, non pour y trouver un fondement, mais pour faire retour vers ce qui s’est passé, qui vous a traversé l’esprit et le corps. Un mouvement rétrograde qui n’est autre que celui du quotidien comme aller-et-retour dans le monde et vers soi.
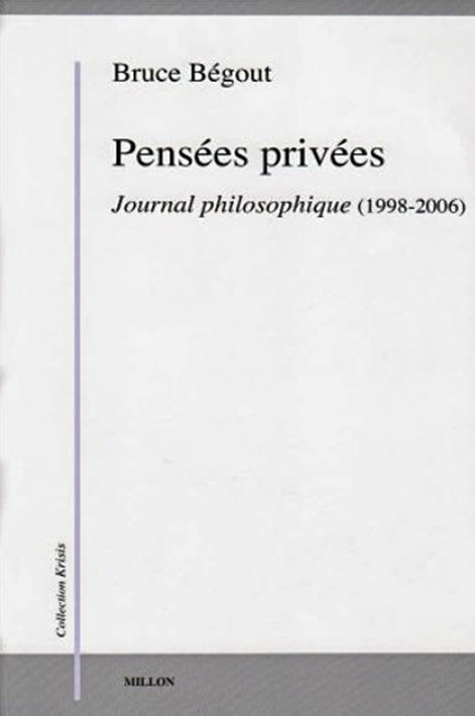
5 – Dans ces Pensées privées, il y a un motif obsessionnel qui est le motif du sujet. Tu fais souvent le reproche à la phénoménologie française de liquider trop facilement la question du sujet, soit en se centrant sur celle de l’altérité (Emmanuel Levinas), soit sur celle du monde (Maurice Merleau-Ponty), soit dans une articulation de la phénoménologie à l’éthique (Paul Ricœur), voire au catholicisme (Michel Henry, Jean-Luc Marion). Tu sembles en rupture non seulement avec cette phénoménologie qui a connu un « tournant théologique », pour reprendre les termes d’un ouvrage de Dominique Janicaud, mais aussi avec celles de Jean-Paul Sartre (que tu évoques très peu) et de Merleau-Ponty, centrées sur une compréhension de l’être-au-monde (qui exclut tout recours à une transcendance de type idéaliste ou métaphysique). Ton inclination pour la phénoménologie allemande est-elle exclusivement liée à la question du sujet ?
J’avoue, en effet, que l’un des grands thèmes de la philosophie du 20e siècle, décliné sous différentes versions, des plus intéressantes aux plus caricaturales, à savoir celui de la dissolution du sujet, m’a toujours laissé dubitatif. On ne compte plus les livres et les articles qui répètent comme une vérité évidente que le « moi » n’existe pas, et que nous ne sommes qu’une collection éparse de vécus, et finalement, le jouet d’une structure sous-jacente qui fonctionne pour nous, et à notre place. S’il s’agit de dire que la subjectivité concrète ne correspond pas à l’idée d’un sujet maître de soi et lucide, tout le monde est me semble-t-il d’accord. Il va de soi qu’un sujet n’est pas un centre de fonctionnement omniscient et omnipotent, une puissance et une transparence à soi totales. Mais est-ce à dire que ce sujet n’est plus rien, une coquille vide, un flatus vocis ? Bien sûr que non ! Ainsi la critique de la subjectivité légitime – sous certains aspects – doit conduire à une philosophie renouvelée de la subjectivité et non à la substitution pure et simple du sujet par des processus anonymes : langage, processus sans sujet, etc. Les luttes modernes pour l’émancipation ne se font-elles pas entre autres au nom d’une subjectivité vécue, fragile, souffrante et aimante ? Si l’on procède à la disqualification de la subjectivité dans sa capacité affective et motrice, alors on détruit la condition même de la vie et de la vie sociale et politique, et donc la condition de son émancipation au nom d’une vie plus pleinement vécue dans la justice et la reconnaissance. D’ailleurs bien souvent, la philosophie asubjective, comme on pourrait dire avec Patočka, se fait une telle vision schématique du sujet qu’elle transforme en un épouvantail, en gros le cogito cartésien, ou le sujet transcendantal husserlien censé régner sur tout d’une main de fer, qu’il ne lui est pas difficile d’abattre en quelques mots cet idole, comme on le voit encore récemment dans un des derniers livres de Clément Rosset, Loin de moi. Mais c’est une idole de papier qu’elle détruit ainsi, et non la subjectivité concrète. L’idée que nous ne serions pas des sujets, à savoir une structure de rapport à soi inaliénable, une sorte de réflexivité originelle sans réflexion objectivante, de présence à soi indéfectible, souvent pour notre propre malheur, mais soit des éléments passagers d’une structure, soit des bribes multiples sans unité, ne me paraît pas très convaincante. Je n’ai jamais ressenti, pour ma part, cette dimension anonyme à l’œuvre dans mon existence ou l’éclipse temporaire de mon moi, à savoir de rien d’autre que la polarisation de toutes les expériences. Je crois que la souffrance même de notre condition vient justement de ne pas pouvoir être autre, de ne pas pouvoir être cette multiplicité d’états sans lien, de ne pas pouvoir être un « ça » anonyme et structurant. Cela ne signifie pas que je suis à chaque fois un centre transcendantal d’unification et d’aperception pure comme le pense Kant. Car ici, l’unité est posée comme une unification objectivante. Cela signifie, comme l’a vu clairement Michel Henry, que je suis une auto-affection continuelle et immarcescible, une présence sensible et affective à moi-même, avant le processus de représentation objectivant de soi dans la réflexion prise comme dédoublement. C’est cette présence réflexive, mais non réfléchie qui m’intéresse comme structure transcendantale de toute expérience. Une présence irrelative, indécomposable, qui se tient avant toute conscience de soi, toute réflexion, et qui se vit en-deçà de la pensée. Toutefois, cette présence à soi reconnue, il faut savoir également la mettre à sa juste place. Ce se-sentir immédiat est primordial, mais il n’occupe pas non plus le centre de nos vies. L’intentionnalité comme « l’ambiancialité » nous décentrent continuellement de cette présence à soi, et nous ouvrent à l’altérité de l’objet ou du milieu ambiant. Bien que je sois toujours moi-même, à moi-même, et même dans toute relation à l’autre, ce rapport à soi étant présent dans tout rapport à ce qui n’est pas soi, sauf qu’il n’est pas du même type de rapport, le rapport à soi n’étant pas justement un rapport, mais une présence réflexive non réfléchie, tandis que le rapport à l’autre implique une objectivation et donc une dualité, cette présence à soi n’est pas tout, et le plus souvent, elle passe même inaperçue dans nos diverses expériences tournées vers le monde, prises dans ce que Heidegger nommait un mouvement de réflexion au sens spéculaire.

6 – Tu es parfois, dans ces Pensées privées, très sévère avec ce que l’on a coutume de désigner dans le monde anglo-saxon de French Theory, et plus précisément, avec le post-structuralisme de la différence, une pensée qui selon toi est bien souvent la complice de ce qu’elle prétend dénoncer. À tes yeux, le néocapitalisme s’accommode très bien des flux, du culte de la différence, des identités flottantes et par sa flexibilité, est même capable de tout intégrer. Tu as, par exemple, des propos durs sur les discours des minorités (p. 95), dans lesquels tu vois « un déni du politique ». La pulvérisation de la société en micro identités et communautés fermées est, bien sûr, une aubaine pour le capitalisme qui, dans ces conditions, n’est jamais analysé en tant que « totalité structurante », et se nourrit de ces contestations partielles. La French Theory a été un véritable vivier pour le monde universitaire anglo-saxon, celui des Cultural Studies qui tend au morcellement des objets de la critique (gender studies, lesbian and gay studies subaltern – ou postcolonial – studies, animal studies, nuclear studies, etc.). À cette tradition française et nord-américaine, tu aimes opposer la tradition allemande, et notamment celle de la Kulturindustrie. En quoi cette dernière est, selon toi, plus pertinente pour édifier une véritable critique du capitalisme postmoderne ? Par ailleurs, dans le contexte de Nuit Debout est apparue – au sein de ce que l’on a coutume d’appeler le « mouvement social » – l’idée de « convergence des luttes » , celle de luttes venant d’horizons différents, mais proches. Y vois-tu une issue politique dans le combat à mener contre toutes les formes de domination ? Enfin, et au-delà de ton champ de recherches, quel tableau dresserais-tu de la philosophie française aujourd’hui ?
C’est une question complexe, et je ne suis plus sûr d’être aujourd’hui entièrement d’accord avec ce que je pouvais écrire, au hasard d’une réflexion nocturne faite au milieu des années 2000. J’ai été tout d’abord un jeune philosophe fortement influencé par Derrida, fasciné même par ses textes, par son style, par son érudition. Lorsque j’ai intégré l’ENS, la première chose que j’ai faite est de me rendre en salle Dussane pour assister à son séminaire. Je voulais voir et entendre le maître. Et là, je ne sais pas pourquoi, j’ai été déçu, énervé même, par l’homme, par le contexte, par le public. Devant un parterre de fans, dont certaines faisant du tricot, le grand penseur cabotinait, faisait des jeux de mots, n’avançait pas dans ses développements. Sur mon, fauteuil, assistant à ce qui était un spectacle, j’étais presque révolté. Aussi, après deux ou trois séances du même acabit, j’ai décidé de ne plus retourner à ce séminaire (le thème était « Donner la mort »). C’est idiot, puéril, épidermique, je le reconnais, et surtout injuste. J’ai continué néanmoins à lire Derrida et à admirer ses textes, notamment son Marx, j’ai même coordonné un numéro de la revue Alter consacré à son rapport à la phénoménologie, mais, à cette époque, lorsque j’étais encore étudiant, j’étais en demande et en attente d’autre chose, quelque chose de plus substantiel, structurant pour moi, jeune provincial venant de la classe non lettrée et peu à l’aise avec ce monde intellectuel que je ne connaissais pas vraiment. C’est comme si mon statut personnel et social ne me permettait pas de prendre du plaisir à ce jeu d’idées qu’à l’époque je ressentais comme brillant et superficiel. Cependant, le travail de la déconstruction, de ce que Husserl et Heidegger nommaient déjà l’Abbau, est absolument essentiel et relève d’une exigence à la fois théorique et éthique. Nous nous devons de soumettre les grands signifiants de l’histoire de la pensée à un travail archéologique à l’envers, à savoir en partant du résultat construit, afin de montrer leur construction et les présupposés qui ont présidé à celle-ci. Le travail de Schürmann lui-même s’inscrit dans cette tradition, et la déconstruction comme réflexion critique-généalogique est la condition sine qua non d’une philosophie qui se veut post-métaphysique et non fondationnaliste. À ce titre, elle doit être poursuivie et approfondie. Quant à la remarque sur les minorités, c’est venu d’un constat que beaucoup faisaient à gauche à cette époque, à savoir celui d’un abandon réel et symbolique parmi les représentants de la gauche, notamment de la part du Parti socialiste, des classes populaires, de leurs soucis, de leurs demandes, de leur mode de vie, au profit d’un discours uniquement tourné vers la reconnaissance des revendications d’identité et de statut, non directement sociales. Il n’est pas dans mon intention d’opposer les deux, bien au contraire, car je crois que les mécanismes de la domination socio-économique sont proches et quasi identiques dans les deux cas, ne serait-ce que parce que, bien souvent, les minorités, notamment celles issues de l’immigration, occupent le bas de l’échelle sociale et ont d’une certaine façon remplacé le prolétariat industriel dans le rôle de la classe dangereuse, même si, du point de vue social et économique, la majorité elle-même de la population française n’est pas vraiment mieux lotie et subit la même humiliation. Je crois qu’à cette époque-là, et peut-être même de nos jours, une certaine lutte pour la reconnaissance a oublié ou masqué la lutte pour l’émancipation en laissant de côté la contestation du capitalisme et de sa cage de fer. L’émancipation ne peut, à mon sens, consister uniquement dans le fait de donner un statut d’égalité et de droits égaux dans une société profondément inégalitaire. Non que cette demande d’égalité de droits soit illégitime du point de vue politique, bien sûr que non, elle est bien une condition nécessaire et loin d’être acquise encore de nos jours, lorsque l’on songe à l’inégalité de traitement que subissent les minorités dans l’accès au logement et au travail, mais elle n’est pas une condition suffisante et finale, surtout si elle se borne à faire de l’état présent, foncièrement injuste, l’idéal auquel doivent nécessairement s’adapter tous les individus. Autrement dit, l’émancipation définitive des dominés, et donc des minorités qui sont souvent les plus dominées parmi les dominés, n’adviendra qu’avec le changement radical de société et ne peut se limiter aux partages des mêmes aberrations économiques, écologiques et culturelles du capitalisme. Bref, qu’une représentante d’un collectif représentant les droits des minorités s’habille en Gucci et représente la marque, pensant ainsi sans doute œuvrer à leur émancipation, ne me paraît pas être l’horizon final du combat politique… Mais, je dois être sans doute vieux jeu et bloqué dans des modes de réflexion et d’action obsolètes. Par exemple, ceux qui relèvent en effet de la théorie critique et de la critique anticapitaliste de la culture dans lesquelles j’ai été formé. Je ne vois pas bien en quoi réclamer des droits dans une société injuste et vouloir avoir le même statut que ceux qui vivent de cette injustice constituent un progrès social ! La lutte sociale ne peut exclure l’horizon d’un changement de société, et donc ne peut se réduire à des demandes de simple intégration dans une société figée et inique. Par bien des aspects, les revendications identitaires contemporaines abandonnent la perspective d’une révolution sociale au profit d’une adaptation à un système dont on ne remet pas en cause le bien-fondé. Mais bon, le vrai combat de l’époque – à mon avis – se trouve plutôt dans la lutte contre la dérive autoritaire des états libéraux et la diffusion des idées d’extrême droite. Même si je ne goûte pas forcément certaines formes (pas toutes non plus !) que prennent de nos jours certaines luttes pour la reconnaissance ou l’émancipation, et par là-même certains hochets qu’une certaine gauche agite devant ses yeux fascinés en y voyant le comble de la vérité et de la justice, je ne veux pas employer mon énergie critique dans cette direction. L’opposition à la droitisation de la société est bien plus urgente et nécessaire. C’est là un combat culturel de tous les jours. Il n’y a qu’à voir la situation française en 2022, et par une propagande constante, la mainmise grandissante des idées autoritaires, racistes, antisociales, qui non seulement affichent sans vergogne leur mépris des minorités, des migrants, des musulmans, mais tuent dans l’œuf toute critique de l’autorité, du marché, de la finance, des GAFA et des NTIC. Convergence des luttes ? Oui, bien entendu, mais il reste à établir une base commune et acceptable par tous. À mes yeux, celle-ci repose et ne peut reposer que sur la contestation continuelle et sans concession du capitalisme, de ses représentants, de ses lois, de sa logique, mais aussi de sa vision du monde, de ses présupposés anthropologiques, de sa capacité à modeler les esprits et les désirs, etc. Il en va de la libération du plus grand nombre face à la captation éhontée des richesses par quelques-uns (je n’ose même pas rappeler ici les chiffres), de l’émancipation des humiliés et de la sauvegarde de la terre libérée de l’exploitation agro-industrielle. Il faut que la gauche marche sur ses deux pieds, la lutte sociétale des droits et la lutte sociale de la fin de l’exploitation économique.
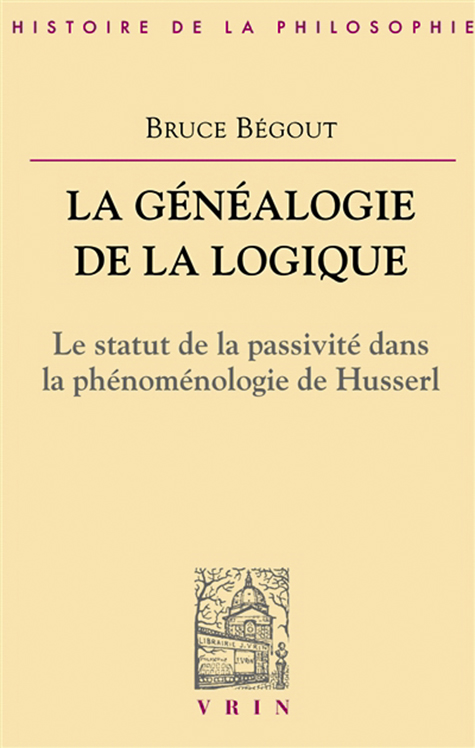
7 – Tu cultives une distance polie avec la philosophie analytique. Quelle est ta position à son égard ? Comment appréhendes-tu « le moment viennois » ?
Disons que, pour diverses raisons, je n’ai jamais été conduit à lire, et surtout à travailler sérieusement les auteurs de cette tradition. À part Frege et Carnap, sur lesquels j’ai écrit des articles, toujours en lien avec Husserl, cette tradition de pensée, avec toute sa diversité et sa richesse, me demeure quelque peu étrangère, notamment l’œuvre de Wittgenstein que j’ai parcourue bien évidemment, mais sans jamais ressentir le désir ni le besoin de la lire avec la grande attention qu’elle mérite. Je ne saurais expliquer cet état de fait. Manque de temps ? D’envie ? De circonstances favorables ? Il y a un peu de tout cela. Mais, c’est aussi une question de problèmes, et de manière de les formuler. Je suis manifestement plus à l’aise avec la phénoménologie et la théorie critique, c’est-à-dire avec leur type de discours et d’argumentation, c’est comme si je respirais le même air que celui qui enveloppe ces textes. Avec la philosophie analytique, même avec la deuxième et la troisième générations (Cavell par exemple), j’ai l’impression de ne pas saisir quels sont les enjeux philosophiques fondamentaux, de me retrouver presque devant une langue étrangère. Bref, j’ai l’impression que leurs questions ne sont pas les miennes, que leurs façons de les poser ne sont pas les miennes, que leurs moyens de les traiter ne sont pas les miens. Mais, je ne dis pas cela pour me disculper, bien au contraire, je suis conscient qu’il y a là, chez moi, un manque et même une faute. Néanmoins, pour ma défense, je ne suis pas persuadé que l’effort que me coûterait à présent l’étude sérieuse et suivie dans le temps de ces œuvres immenses et complexes (Wittgenstein, Schlick, Quine, etc.) serait récompensé à la mesure de son intensité en m’apportant aussitôt un éclairage essentiel sur le type de questions que je me pose. Je sais par exemple que, concernant mes recherches sur les ambiances, je dois aller lire les Investigations philosophiques de Wittgenstein et creuser dans cette voie-là, mais à chaque fois, je trouve un prétexte pour ne pas le faire…

8 – Poursuivons avec les essais, puis la fiction. Tu as dit un jour que tu avais écrit Zéropolis lors de ton séjour aux États-Unis dans le cadre de ton post-doctorat, pour te détendre de tes travaux universitaires, selon un mode récréatif. Peux-tu, tout simplement, rappeler dans quel contexte tu es venu à publier cet ouvrage ? Quelles ont été ses impulsions ? Comment, à l’époque de sa rédaction, l’articulais-tu avec le reste de tes travaux ?
J’ai fait de nombreux séjours au cours des années 90 aux États-Unis. Au moment même où je rédigeais ma thèse de doctorat sur Husserl, j’avais entrepris l’écriture d’un livre de philosophie urbaine et critique, dans l’esprit de Benjamin, Adorno et Kracauer, sur Los Angeles. J’avais accumulé notes, observations, lectures et réflexions, et écrit deux cents bonnes pages. Mais, au même moment, Mike Davies publiait City of Quartz. Je me suis tout de suite dit que cela ne valait pas la peine de publier mon propre livre sur Los Angeles, moi, le jeune philosophe français inconnu. J’avais peur de la comparaison avec ce livre magnifique qui, en un sens, avait ausculté la ville californienne avec un incomparable regard pénétrant. J’ai donc mis ce manuscrit de côté, manuscrit que ne sera publié tel quel, sans retouches, qu’en 2014, sous l’aimable proposition de Jérôme Schmidt des éditions Inculte qui en connaissait l’existence. Toutefois, il y avait dans le projet du livre de Los Angeles, dont la structure graphique devait épouser celle géographique du réseau des highways, deux appendices : l’un sur la ville de Las Vegas, l’autre sur le motel américain. Ne voulant pas abandonner totalement le livre sur la ville américaine, ce sont ces deux appendices que j’ai repris et travaillés, et qui ont donné lieu à deux livres chez Allia, Zéropolis (2002) et Lieu commun (2003). À dire vrai, à cette époque, je ne voyais pas bien le lien avec mes travaux universitaires, si ce n’est une vague attention à la phénoménalité sauvage des lieux que j’explorais et analysais. C’était plutôt la théorie critique qui m’aidait et m’aide encore à me repérer dans la suburbia américaine, moins les Recherches Logiques de Husserl. Ce n’est que quelques années après, en travaillant sur le monde de la vie et la quotidienneté, que j’ai compris les rapports qui existaient entre ces deux aspects de mon travail en apparence séparés. Le monde de la vie, depuis la révolution industrielle et capitaliste de la modernité, avait subi une transformation profonde, et je ne pouvais simplement l’appréhender selon ses structures a priori dans une démarche non historique et non critique. Il fallait montrer la genèse socio-transcendantale de ce monde et ses modifications sous le coup de la mécanisation et bureaucratisation de l’existence moderne. Les livres sur les villes et l’espace urbain qui se sont succédé depuis, jusqu’au dernier sur la disparition des ruines, tentent d’ajouter à l’approche phénoménologique, soucieuse de dégager des invariants eidétiques des divers espaces qu’elle analyse, une genèse empirique, sociale et historique de ces mêmes lieux, montrer en quoi ils sont soumis à des forces qui les modifient et qui modifient, en outre, notre relation à eux. J’ai orienté la phénoménologie que j’ai apprise à l’école de Husserl et de Heidegger dans le sens d’une archéologie critique des Temps modernes, d’un abandon du fantasme fondationnel, gnoséologique comme science rigoureuse, ou ontologique comme théorie de l’être vrai, pour le sauvetage des singularités menacées par le dispositif planétaire du Capital écocide et anthropocide. Même le travail, en apparence non historique, sur les ambiances est mu par cette volonté d’émanciper les expériences et les situations du principe de prestation.
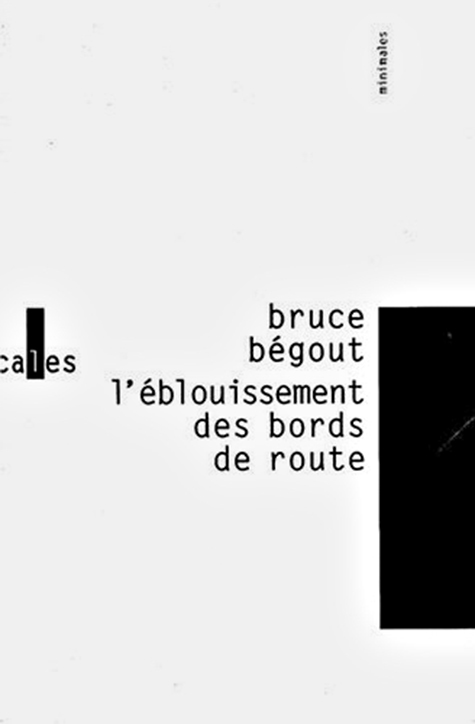
9 – L’Éblouissement des bords de route (Verticales, 2004) se situe à la jonction de la théorie et de la fiction. Le livre se découpe en chapitres qui se présentent tantôt comme des poèmes en prose, tantôt comme des minis essais à l’intérieur desquels s’amorcent des bribes de fiction. Cette manière de brouiller les frontières était-elle pour toi une façon de t’inscrire dans la tradition américaine de la narrative non-fiction ? Comment qualifier de tels textes ? Micro-fictions ? Exofictions, au sens que Philippe Vasset a donné à ce mot ? Fictions théoriques ?
Le plus souvent, ce que je fais n’est pas vraiment motivé par un plan précis. Je me laisse guider par des exigences vagues, des pressentiments obscurs, en un mot l’instinct. Ce sont donc des impulsions et des impressions prélogiques qui déterminent au départ mon travail et l’obligent à s’orienter dans une certaine direction. Certes, ces intuitions renvoient souvent à un même univers, à une même ambiance générale, celle du monde moderne traversé par les injonctions du dispositif technique, automatique et autonome. Chaque livre tente d’une certaine façon d’arpenter ce monde livré au principe de prestation, d’efficacité et de calcul, mais par ses biais propres. Les lectures, les influences, les références jouent sans doute un rôle important. J’écris aussi sous l’ombre de grands penseurs et prosateurs qui ont formé mon regard et ma sensibilité : Nietzsche, Benjamin, Calvino, Anders, Adorno, Broch, Barthes, Bloch, Musil, etc. Dans ce livre en particulier, faux journal de voyage, et essai en prose narrative, je me mets en scène au sein de cette suburbia américaine, traquant les moments de flottement au sein d’un système urbain bien huilé, ces moments où justement le principe de prestation fonctionnaliste échoue, déraille, s’effondre et où une sorte d’inquiétante étrangeté sourd du monde technicisé et mécanisé. Oui, il y a en effet la tentative de défaire les frontières trop fermes entre fiction et réflexion, et d’ailleurs, parfois un texte qui est écrit pour intégrer un essai théorique se retrouve en fin de compte, dans une fiction, et inversement. C’est le contexte qui décide le plus souvent de son attribution. Il y a dans Le ParK (Allia, 2010) d’authentiques moments réflexifs, et dans Le Concept d’ambiance : essai d’éco-phénoménologie, des descriptions de situations qui pourraient figurer dans un récit. Lorsque le texte intègre un genre, alors il se moule en lui, et en retour, le martyrise, puisqu’il lui impose un style et un contenu qui ne lui conviennent pas au départ. En fait, je bricole avec les moyens du bord, et je vois si l’effet produit est probant ou non. C’est une manière aussi de toucher d’autres lecteurs en les obligeant à déplacer leurs horizons d’attente et leurs catégories d’interprétation. Mes livres empruntent souvent plusieurs registres. Ce sont des « chevaux de Troie » textuels. On croit lire un essai architectural sur le motel américain et l’on est plongé au cœur de la pensée heideggérienne du Gestell. Je m’amuse beaucoup en faisant cela, sachant très bien que, parfois, l’effet peut tomber à l’eau, et que le rapprochement hybride peut lui-même ne pas fonctionner. Au fond, j’utilise trois registres différents : la fiction, l’essai et le traité. Une même thématique et une même thèse peuvent circuler entre ces trois genres et se développer en fonction du contexte. C’est très variable, même si, au fond, je pense que je suis d’abord – et avant tout – un philosophe, à savoir un être qui, tout en étant épris par le savoir (philo-sophia), doute de sa capacité à l’atteindre, et interroge cette continuelle déception.
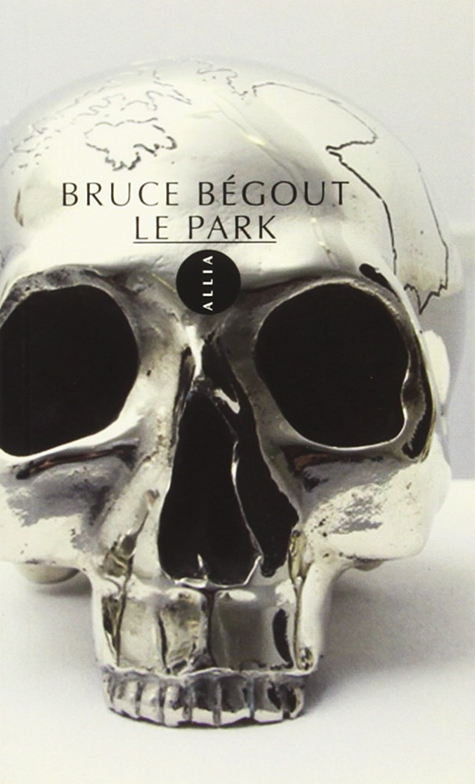
10 – On peut dire que tu fais partie de ces rares auteurs français qui connaissent les États-Unis. Lorsque nous disons cela, nous entendons que tu connais intrinsèquement la culture américaine, que ce pays que tu as traversé t’a lui-même traversé : il y a dans Zéropolis – tout comme dans Lieu commun, un ressenti et un vécu personnels, profonds, sincères, à la manière même dont Jean Baudrillard a pu écrire son Amérique, et non pas ce discours pseudo savant ou d’apparat que l’on perçoit chez nombre d’auteurs français se vantant d’expériences américaines qui s’avèrent être toutes, généralement, que des truismes touristico-branchouilles. Qu’est-ce qui t’a amené aux États-Unis ? Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire sur ce pays ? Que représente-t-il à tes yeux ? Quels sont – aujourd’hui encore – tes liens avec lui, sa culture, sa politique, son imaginaire et… sa littérature ?
Disons qu’après la société française, c’était celle que je connaissais le mieux. Déjà adolescent, j’avais été, comme beaucoup, fasciné par la culture de masse et la contre-culture, le cinéma du nouvel Hollywood, l’art contemporain, le sens de la liberté et de l’espace. Si la Beat Generation lisait Rimbaud et Verlaine, je lisais pour ma part Jack Kerouac, John Rechy et William Burroughs (auquel, d’ailleurs, j’ai consacré en 2014 un long poème narratif : Phantastika). Qui plus est, travaillant sur la ville, je constatais que le modèle d’organisation spatial venu des États-Unis était dominant dans le monde entier, domination physique et symbolique. C’était donc, pour moi, une évidence d’analyser ce monde de la vie suburbain et d’y dévoiler ce qui en faisait une force formatrice de notre présent, et ce à travers le rapport à la marchandise, la voiture, l’enseigne, la fragilité des bâtiments, le symbole, le zoning, les gated communities, etc. Pour diverses raisons, je me suis peu à peu détaché de cette fascination, peut-être même dès 2001 et l’invraisemblable réaction nationaliste de ce pays aux attentats du 11-Septembre, même dans les milieux démocrates et radicaux. D’ailleurs, mes travaux sur la ville et la culture américaine appartiennent à une histoire philosophique et critique du 20e siècle, et ne prétendent pas faire de ce monde-là la clé de notre avenir. D’une certaine façon, c’est déjà un vieux monde, un résidu du passé. Mes liens avec cet univers sont donc à présent très distendus, et c’est vers l’Asie que mes regards et mes intérêts se portent, en particulier vers le Japon, où j’ai séjourné à plusieurs reprises dans la seconde partie des années 2010. J’étais néanmoins présent aux États-Unis lors de premiers jours du mandat de Trump, et j’avais l’impression d’assister en direct au déclin inexorable de ce pays dirigé par un idiot, gangrené par la pauvreté et la bêtise, mu par une pulsion de mort répétitive, un vrai séjour crépusculaire à Los Angeles et New York en janvier 2017. Je crois que la beauté de quelques levers de soleil dans le désert de l’Utah ne peut plus racheter, à mes yeux, la nullité croissante de cette société paralysée dans des représentations caricaturales de la réalité, et propageant une vision du monde écocide, banale et stupide.
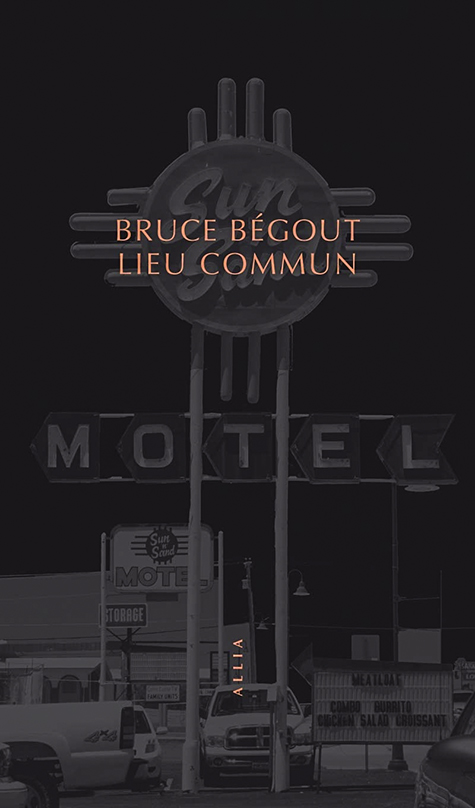
11 – Ton essai consacré à Las Vegas, Zéropolis participe, à sa manière, d’une sorte de « mythologie » dans le sens barthésien. Tu as, en effet, mis en perspective cette « non-ville » comme elle n’avait encore jamais été dévoilée. En ce sens d’ailleurs, ton ouvrage compte parmi ces essais urbanistiques fondamentaux que sont, par exemple, City of Quartz de Mike Davis ou La Ville évanescente de Frank Lloyd Wright. Comme tu le dis dans ton ouvrage, Las Vegas est « l’expérience des limites dans les limites de l’expérience », la « ville-spectacle » absolue dont le modèle – cette « végassisation » fatale – a pu gagner le reste du monde. Pour toi, qu’en est-il encore aujourd’hui ? La crise a-t-elle atteint le modèle et l’esprit de cette « urbanité psychotrope » ? Que représentent-ils encore dans l’imaginaire collectif à l’heure des « méga-town » asiatiques ou orientales du type Chongqing, Singapour, Dubaï, Palm Islands, ou encore de Neom, la mégalopole du futur à 500 milliards de dollars dont rêve l’Arabie saoudite ?
Je crois que, malheureusement, si j’en juge par ce qui se construit à Dubaï ou à Shanghai, que ce modèle de l’urbanisme factice et divertissant a encore de beaux jours devant lui, et que ce qui a été expérimenté à Las Vegas après la Seconde Guerre mondiale vaut encore et possède une grande force de persuasion à l’échelle mondiale. La nouveauté réside sans doute dans la synthèse inédite, mais non paradoxale, entre cet urbanisme ludico-spectaculaire, celui de « l’effet whaouh ! », et le monde numérique des réseaux sociaux et des GAFA. L’écran qui recouvrait déjà les murs des casinos végasiens vaut désormais pour lui-même, et absorbe le sens du réel et des rapports sociaux médiatisés par des images et des pouces bleus. Au parc d’attraction s’est donc ajouté le compte Instagram ou Tik-Tok, accentuant encore plus la dématérialisation des lieux et des expériences au profit d’un simulacre généralisé. Ce que Las Vegas avait en outre proposé, à savoir non pas uniquement le spectacle total, mais la participation immersive, l’accent mis sur le vécu, l’affect et l’ambiance, s’est de même renforcé de manière rapide dans une scénographie universelle des formes de vie. Mais, à chaque fois, soulignons-le dans une société de contrôle total, au sein de dispositifs sécuritaires et canalisateurs qui bannissent la possibilité d’une réelle transgression que seule, à dire vrai, la révolte peut apporter en reconnectant les corps, les imaginaires et les situations. Il faut bien donner une porte de sortie au surplus gigantesque de la production capitaliste. Ces villes en pleine expansion que vous citez donnent à voir dans les bâtiments les plus extravagants le caractère volatile et liquide de la valeur, son refus de s’attacher à des corps et à des substances, à un monde même, créant ainsi des enclaves irréelles où la seule réalité demeure celle des chiffres.

12 – Tu analyses dans Suburbia : autour des villes (Inculte, 2013), les métamorphoses du tissu urbain dans son étalement polycentrique, fait de banlieues réticulaires, de pavillons, de grands ensembles, de zones commerciales et de zones de production tertiaire. Le titre de la dernière partie – « Los Angeles, capitale du 20e siècle », clin d’œil à Walter Benjamin – en concentre tous les enjeux : omniprésence de l’automobile et du divertissement (cinéma, parcs), extension urbaine à l’infini, no go zone, gated communities, ségrégation sociale. N’est-ce pas finalement une manière d’être, comme l’animal, parfaitement ajusté au monde, et n’y a-t-il donc pas là le symptôme du triomphe du quotidien ?
Au fond, ce qui m’intéresse dans ces espaces relève avant tout d’un problème anthropologique. Si l’être est pur devenir, à savoir inconstant et fluide, et que toutes nos tentatives de fixer ce devenir sous la forme de catégories stables relèvent, comme l’indique Nietzsche d’un mensonge, alors l’espace contemporain, celui qui naît avec la société industrielle et capitaliste, propose de manière absolument inédite dans l’histoire humaine d’exhiber sans fard cette précarité ontologique, et de construire à partir d’elle un environnement fragile, précaire, évanescent, le Junkspace de Rem Koolhaas, qui ne soit ni un cosmos ni un milieu stable, mais au contraire, un flux constant aux particularités passagères. Or l’homme, tout en faisant l’expérience de l’être chaotique de la situation originelle, a manifestement besoin, pour sa propre survie, de s’en éloigner, de la conjurer, par exemple en construisant un univers proche, stable, solide et familier. Bref, en tournant le dos à l’Apeiron d’Anaximandre pour trouver des repères, fixer des limites, imposer au sans-fond des contours vivables et protecteurs. Ce qui est donc pour moi le plus surprenant dans l’espace suburbain contemporain est qu’il bafoue ce besoin anthropologique ancestral de l’abri et de l’habitation, à savoir du séjour dans un oikos délimité, durable et familier, en jetant les hommes sans ménagement dans un flux de sensations, informations, situations, en constante accélération. C’est ce choc anthropologique que la ville américaine, précipité chimique de la dissolution de la ville éternelle dans le suburbain obsolescent, manifeste. Elle oppose aux besoins anthropologiques de la stabilisation, la nécessité violente de la circulation, même si, de manière hypocrite, elle recrée par en-dessous pour les nantis de nouvelles barrières spatiales et de nouveaux repères stables, dans la sécession urbaine, la rente foncière et la possession démesurée de biens grandioses. D’où une quotidienneté contemporaine continuellement sur la brèche : une quotidienneté qui doit tout de même œuvrer à l’ajustement de l’homme et du milieu et qui, soumise à ces forces dissolvantes de la vitesse, de l’éphémère et du flexible, s’expose à la déstabilisation totale. Ce flottement est notamment remarquable dans le rapport à l’autre. En effet, dans les espaces suburbains aux repères flottants, par exemple une banlieue commerciale étendue sur un espace peu lisible et en constante transformation, la présence de l’autre devient énigmatique : intrus, étranger, adversaire. L’homme suburbain ne peut se sentir qu’étranger au monde, une sorte de néognostique avec voiture climatisée et smartphone. C’est ce que j’ai voulu notamment montrer dans l’essai sur Los Angeles qui interroge essentiellement cette relation problématique à autrui, relation sceptique, tendue et catastrophique. La culture matérielle actuelle est sincère du point de vue ontologique et mensongère du point de vue anthropologique, elle argue du devenir, à savoir du temps et de la négativité de ce qui ne dure pas, pour renforcer la déstabilisation capitaliste du monde. Elle croit, par sa valorisation de la précarisation, rendre compte de l’être même, alors qu’elle assoie la puissance du dispositif techno-économique de la circulation.
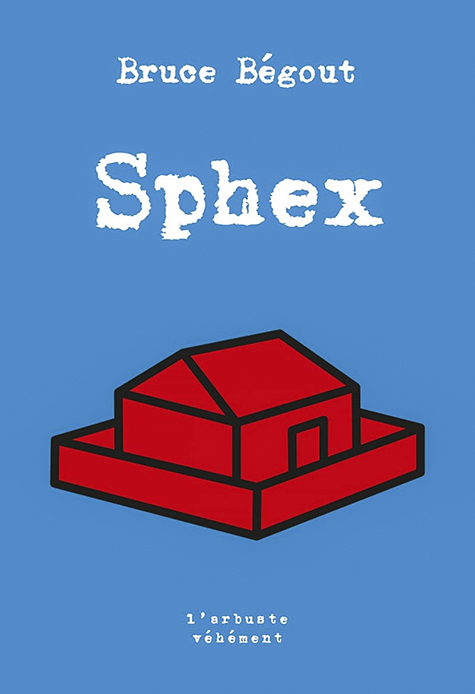
13 – Par tes recueils de nouvelles, Sphex : Fantaisies malsaines (L’Arbre vengeur, 2009) et L’Accumulation primitive de la noirceur (Allia, 2014), tu privilégies la forme brève comme dans tes essais, ou comme nous l’avons dit, dans L’Éblouissement des bords de route, avec ses micros-récits. Ton roman, Le ParK, lui aussi se caractérise par sa forme condensée et ramassée. Quels rapports entretiens-tu avec la forme courte ? Qu’est-ce qui t’attire dans cet usage – très français dans sa tradition, mais aussi très allemand – du « petit », du fragment ?
Là encore, je pense que mes lectures ont joué un grand rôle dans ce choix du court, du petit, du fragmentaire. Tous les auteurs que je lisais à l’adolescence étaient des maîtres de la forme éclatée : Blanchot, Jabès, Benjamin, Barthes, Nietzsche, Bloch, Cioran, Canetti, etc. Mais dans ce choix, entrent également deux autres facteurs : tout d’abord un facteur pragmatique, le manque de temps pour me lancer dans des œuvres aux dimensions plus ambitieuses, en tout cas quantitativement parlant. Le roman total n’est pas fait pour moi, pour mon style de vie en tout cas. Le travail universitaire est très prenant, notamment en sa partie administrative, et mener ainsi une double vie de philosophe et d’écrivain est assez exigeant, en particulier dans l’organisation temporelle toute simple de la journée. L’adoption de la forme courte s’est donc aussi imposée d’elle-même pour des raisons pratiques. En quelques jours, une nouvelle, un chapitre, un récit, peut être écrit, dans les interstices temporels du métier, qui sont rares et précieux, à savoir le plus souvent tard le soir. À ce facteur purement matériel, il faut ajouter un élément plus fondamental qui tient à la nature même du monde dans lequel nous vivons. Il m’est impossible de proposer un regard total et englobant sur cette réalité. Les grands sujets ne sont pas pour moi, et je soupçonne même en eux un mensonge absolu, une manière de ne pas poser les vrais problèmes de notre temps qui demeurent souterrains. D’où mon goût pour les thèmes marginaux, secondaires, périphériques où le vrai s’est réfugié. Je suis de plus persuadé, comme l’a noté très justement Adorno dans Minima Moralia, que l’ambition de vouloir saisir de nos jours, dans sa totalité, le système de production matérielle et idéelle actuel relève du donquichottisme intellectuel. On ne peut plus dire la vérité du tout, et si le concept de vérité a encore une quelconque pertinence, il ne peut la trouver que dans ce renoncement. Dans un univers où tout est scénarisé, arrangé, médiatisé, le fragment représente la forme morale de l’écriture. Il oppose, à la totalisation mensongère des éclats épars de réalité, de vérité, des moments contingents qui échappent à la mise en scène générale. En outre, le fragment comme forme convient parfaitement aux sujets marginaux dont je m’occupe. De même que le thème de mes travaux appartient souvent aux marges, marges de la philosophie et de la ville, à ce qui n’intéresse pas les autres et ne fait pas l’objet d’une valorisation médiatique comme thèmes à la mode, de même le fragment s’adapte parfaitement à ces thèmes et situations marginales qui constituent pour l’essentiel le contenu de mes étranges livres.
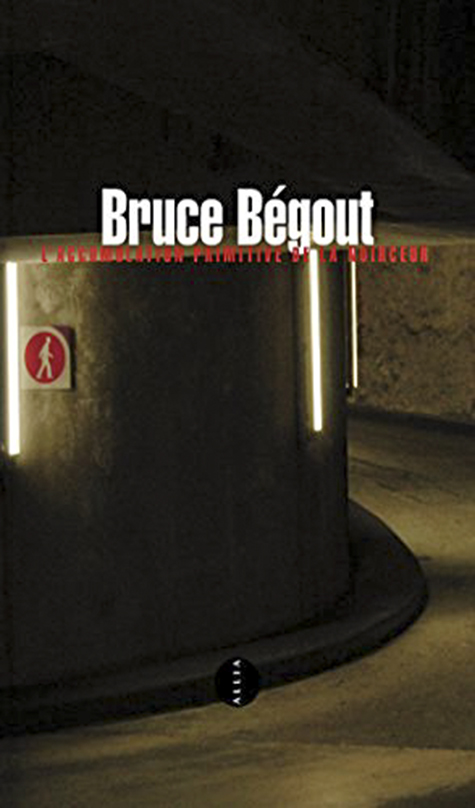
14 – Revenons sur la partie fictionnelle de ton œuvre constituée de recueils de nouvelles – Sphex et L’Accumulation primitive de la noirceur – et de romans – Le ParK, On ne dormira jamais (Allia, 2017), et Le Sauvetage (Fayard, 2018) – et qui, à eux cinq, posent l’empreinte, sinon la marque de fabrique « Bégout » : une autopsie de l’espace extérieur et intérieur des sentiments humains, la confrontation entre la lumière et la « noirceur » pour reprendre ce terme d’un de tes titres, c’est-à-dire la traversée – quasi expiatrice – de la cruauté, des décors dévastés, des cimetières, une morgue, de la terreur, de la guerre, de la paranoïa, de la solitude, de la mort, des ténèbres… Mais d’où te viennent ce ton, cette vision du monde ? Comment te les expliques-tu ? Qu’est-ce qui t’as poussé à t’en saisir, et à ce qu’ils t’inspirent ? S’inscrivent-ils dans une « lignée » intellectuelle et artistique particulière à laquelle on pourrait, d’ailleurs, rattacher l’humour noir qui peut en émaner parfois ?
Oui, mes récits puisent sans s’en cacher dans un imaginaire gothique, fantastique, noir. C’est le tragique sous le quotidien, ou plus exactement dans le quotidien, tapi en son cœur, qui constitue l’axe de mon travail littéraire. Mais un tragique actuel, celui de l’être humain superflu de l’hypermodernité aux prises avec les dispositifs techniques, économiques et médiatiques, l’homme plongé dans le monde tentaculaire de la Machine, du Marché et du Spectacle, et qui, face à ce Léviathan, s’adapte, résiste ou se rend. Et à chaque fois, cette vision incarnée dans des lieux caractéristiques, porteurs d’une vision forte et tranchée (Las Vegas, le motel, le parc d’attraction, la morgue, l’usine abandonnée, l’aéroport, etc.), un imaginaire spatial, local, géographique qui me permet de faire des lieux de vrais personnages et des personnages des représentants des lieux. C’est sans doute Ballard qui m’a appris cela, l’inscription du récit dans une topologie mi quotidienne mi fantastique. Alors, oui, le monde que je dépeins, et ces tristes sires qui survivent tant bien que mal en lui, est noir, apocalyptique parfois, mais, il faut dire que notre propre réalité, économique, écologique et géopolitique n’est pas des plus reluisantes non plus. Je mets le doigt où ça fait mal et invente des situations absurdes où l’horreur sous-jacente à notre réalité faussement idyllique de la société libérale et de marché sourd violemment sans prévenir. Toutefois, il n’y a pas vraiment de désespoir dans ce que j’écris car, même si la plupart des récits finissent mal, ils montrent néanmoins par où le bât blesse et donc exposent en creux des portes de sortie que, certes les personnages n’empruntent pas vraiment (ils ont plutôt tendance à se cogner aux murs ou à les décorer et donc se satisfaire de leur souricière dorée), mais que le lecteur peut, lui, reconnaître et vers lesquelles il peut se diriger. Il y a sans doute quelque chose d’expressionniste dans les lieux, les thèmes, les personnages et le type d’écriture que je mets en œuvre, quelque chose de sombre, mais aussi d’exagéré, de provocateur et de comique dans sa démesure même. Si on lit à voix haute les textes de Sphex, une irrépressible envie de rire apparaît. Je l’ai vérifié lors de séances de lecture publique. Et encore, au cours des représentations théâtrales d’On ne dormira jamais. Un rire consolateur sans doute, voire prophylactique, pour ne pas tomber malade et s’effondrer de chagrin. J’adorerais, par ailleurs, écrire un récit sobre et mesuré, dans un style japonisant, clair, simple, limpide, mais à chaque fois, une certaine emphase méphistophélique fait sa réapparition. Je me suis convaincu avec le temps qu’il ne fallait pas tenter de corriger ces défauts, il faut au contraire les mettre en avant, les cultiver et les accentuer même, car ce sont eux qui me définissent.

15 – Des fictions comme L’Accumulation primitive de la noirceur et On ne dormira jamais, baignent dans une atmosphère gothique. Tu as pu qualifier toi-même le ton de certaines de tes œuvres, sinon de toutes, de « post gothique ». Annie Le Brun, dans son essai Les Châteaux de la subversion a proposé une analyse pénétrante de la littérature gothique et noire, qui apparaît à la fin du siècle des Lumières, dont elle serait la réversion ténébreuse. Elle a, par exemple, montré l’importance dans ces romans de l’enfermement, des lieux clos (châteaux, couvents, etc.) : « C’est dans l’ancien espace de la soumission que se conquiert la liberté et ce, au prix de la plus grande violence, de l’affirmation d’une noirceur que l’individu voit surgir du plus profond de lui-même », écrit-elle. Cette récurrence du motif de la clôture est aussi la métaphore d’un enfermement dans un espace mental. Est-ce que, à leur manière, les fictions gothiques que tu écris peuvent s’inscrire dans cette filiation du roman gothique, genre indéfini et hybride s’il en est ?
Oui, pour moi l’univers noir de ce type de littérature exprime l’inconscient de l’époque et ce qu’elle cherche à refouler, autrement dit la mauvaise conscience du rationalisme occidental qui ne supporte pas de voir en face sa face sombre, à savoir la réduction de la diversité du réel au schéma répétitif du principe de raison. Il en va de même pour ce que j’ai nommé le post-gothique, à savoir le gothique de notre temps où les châteaux et les cryptes, les vampires et les monstres ont été remplacés par les distributeurs automatiques de pizzas, les parkings à étages, les magasins de hard-discount et les managers plongés dans leur I-Phone. Bref, par le monde produit par l’industrialisation et le capitalisme contemporains. La révolution moderniste a bien évidemment conduit à l’égalité des droits, a promu l’accès à l’éducation et à la santé pour tous, a engendré l’amélioration des conditions de vie (même si, sur ce chapitre, il y aurait beaucoup à dire sur le plan de la santé physiologique et mentale, du cadre de vie, du respect du monde animal, etc.), a favorisé une certaine liberté publique, mais au prix également de la mainmise sur le vivant et sur les vivants d’une cage de fer en continuelle expansion. Est donc gothique, non le renvoi au passé obscur et à la barbarie des temps reculés, mais l’expression actuelle de la noirceur du dispositif mondial de nivellement et d’appauvrissement de l’expérience par la technique, le marché et les médias de masse. La clôture et l’obscurité forment ainsi des images récurrentes de notre monde qui se referme et s’embrunit, et ce n’est pas un hasard si ce type d’atmosphères se retrouve très souvent dans mes fictions. En un sens, ces fictions s’inscrivent bien dans cette tradition du roman noir et gothique et l’adapte au monde des échanges mondialisés, des centres commerciaux, de la téléréalité et des influenceuses. Il poursuit la mise au jour des vérités cachées sous terre et tous mes personnages sont en quelque sorte les héritiers de l’anti-héros cynique et désabusé des Carnets du sous-sol de Dostoïevski. Ce que j’écris s’apparente à la rencontre imprévue de Lovecraft et d’Adorno, de l’épouvantable révélation du rien et de la critique de la culture de masse. Car, au fond, les deux sont aux prises avec le même univers de l’errance planétaire et de la monoforme, avec les mêmes forces acosmiques qui l’étreignent, et ils l’expriment par des chemins différents, mais qui convergent dans un refus de la catastrophe.

16 – Nous aimerions davantage disséquer – c’est le cas de le dire 😉 – On ne dormira jamais. Le roman décrit la transformation d’un institut médico-légal, dénommé L’Hôtel, en boîte de nuit. Cette transformation ne se réalise, en fait, qu’à la suite d’un tournage pornographique dans les lieux, tournage qui pousse le directeur de l’établissement à cette transformation. L’Hôtel devient alors le KluB où une clientèle huppée, blasée de la dope et les partouzes, vient s’y trémousser auprès de cadavres. L’atmosphère y est pesante et la sensation d’enfermement puissante. Est-ce une métaphore de notre propre enfermement dans ce monde parvenu au bout de tout, et dont on sent un peu plus, chaque jour qui passe, cette atmosphère étouffante, annonciatrice de cet anéantissement que, tout à la fois, nous produisons et redoutons ?
Comme souvent, ce travail est né d’une intuition passagère, que j’ai saisie au vol avant qu’elle ne disparaisse pour de bon et que j’ai creusée peu à peu jusqu’à en faire un roman, peut-être le roman le plus ambitieux que j’ai écrit. La plupart de mes travaux de fiction naissent ainsi : il y a au départ une idée, une impression, un paysage, puis j’analyse cette donnée de départ assez vague, et en l’exploitant sous toutes ses faces, je la pousse jusqu’à ses ultimes conséquences, sans grand souci de réalisme. Je me soucie assez peu du lecteur, j’écris ce que j’aimerais lire. Et ce faisant, je ne me donne aucune limite, de bon goût, d’attendus divers, de respect de certaines règles du genre et d’attentes du lectorat. Là encore, c’est ma situation d’outsider qui me permet cette liberté, cette folie même. Je me lance bille en tête, et fais rarement des arrêts en vue de prendre du recul, de faire un bilan, d’émettre un jugement critique sur mon travail. Je fais ce que j’ai à faire, je poursuis des obsessions qui me sont propres et m’y consacrent entièrement, sans vraiment tenir compte des jugements des autres. Autant je suis, dans la vie réelle, une personne ouverte au dialogue et aimant les échanges, autant, lorsque j’écris, je me referme dans mon idios kosmos privé. Ainsi, chaque livre implique une immersion totale dans une idée, un paysage, une situation, dont on ne sort et dont je ne sors qu’à la fin. Dans le cas d’On ne dormira jamais, cela m’est venu en lisant le petit roman de Mario Bellatin, Salon de beauté. À la lecture, je me suis demandé ce qui pouvait inverser le dispositif du génial écrivain mexicain, à savoir ici la description de la vie d’un salon de coiffure transformé en un mouroir pour de jeunes hommes atteints du sida et incurables. L’image d’une morgue transformée en boîte de nuit s’est tout de suite imposée à mon esprit. J’avais ainsi ma situation de base, il ne restait plus qu’à inventer des personnages, des événements, un dénouement. Je voulais également écrire une suite au ParK, et c’est la raison pour laquelle le KluB a été créé comme un parangon du parc-camp de distraction-soumission. L’inversion des fonctions, des rôles et des genres, dirige l’esprit de cet espace souterrain et conduit tous les personnages à subir des métamorphoses inédites, jusqu’à la transformation finale. Par ailleurs, pour ajouter au climat crépusculaire de ce monde en vase clos, une pandémie inconnue se déclare au-dehors et décime la population mondiale. Or, plus les gens meurent, plus ils ont envie de faire la fête. C’est le principe de la peste et de l’orgie. À partir du moment où le mal peut frapper tout le monde sans prévenir, les gens soumis ainsi au risque de la mort violente et soudaine veulent jouir une dernière fois et abandonnent par conséquent tout sens de la mesure. Aussi le KluB répond-il à un besoin extatique de dépense que la pandémie crée. Et lorsque celle-ci disparaît tout aussi mystérieusement qu’elle est apparue, un tueur anonyme entre en scène, continue le travail de dépeuplement et se met à assassiner les survivants, pour prolonger en quelque sorte l’état d’urgence vitale et l’excitation qu’il entraîne. Et pour faire également contraste avec ce monde souterrain et baroque de la thanatophilie, la morgue nommée Hôtel puis KluB accueille un élevage de lapins nains, ajoutant à la noirceur de la pandémie et des danses macabres, le monde du mignon et du gnangnan dominant les réseaux sociaux et la communication mondiale. Bref, le livre est construit comme un kaléidoscope où chaque face qui tourne révèle un nouvel aspect de la réalité, où tout change et se transforme au sein d’un espace lui-même multiple et sans fin, comme les couloirs de la morgue, puisque coexistent en lui un institut médico-légal, une boîte de nuit et un élevage de cuniculture. Le lieu clos et marginal permet ainsi d’abriter, au sein d’une architecture autonome, un laboratoire d’expérience sur les rapports de la vie et de la mort, de l’homme et de l’animal, du masculin et du féminin, du grave et du léger, du funéraire et du festif, etc. On peut y voir une image condensée de certains travers de notre époque, de la sécession sociale et spatiale des ultra-riches, de la confusion des esprits qui mêlent l’horrible et le mignon, de la perte des repères dans une circulation accélérée des identités jetables, c’était surtout pour moi une descente aux enfers, où un Orphée sans Eurydice se pétrifiait lui-même à chaque pas qu’il faisait vers les bas-fonds de l’époque. C’est glauque, poisseux, dérangeant, bavard, loufoque, clinquant et vulgaire, et surtout profondément désespéré, même si le personnage principal s’en sort à la fin dans une ultime transformation qui, à la différence des autres, s’assume comme telle.

17 – Tu suggères, dans ce roman, une abolition effroyable entre ce qui sépare la vie et la mort, donnant évidemment l’avantage à la mort, à la différence des transhumanistes qui, eux, visent par le développement scientifique, l’émergence de la vie éternelle. Que penses-tu du transhumanisme de ce point de vue ? Ton roman se pose-t-il comme une riposte implicite à leur aspiration délirante ? Estimerais-tu, justement, que plus une minorité a la velléité de vivre éternellement, plus elle est en fait en état de décomposition avancée, du moins mentalement ? Mais aussi : plus une minorité est blasée de ce qui fait la vie quotidienne d’un être humain, c’est-à-dire de ces petits bonheurs de la vie, plus la majorité sombre elle-même dans la haine de soi et des autres, dans l’abrutissement virtuel, dans la décomposition physique et intellectuelle ?
Je crois surtout que ce roman cherche à montrer ce que les hommes et les femmes, dans des situations extrêmes de désespoir, où l’ennui, la bêtise et la violence sociale dominant l’horizon ne semblant pas pouvoir être dépassés, feront de leur pauvre existence. Cherchant à fuir ce monde redevenu barbare, ils expérimenteront alors n’importe quoi (c’était déjà le thème de Zéropolis), et ils le font déjà, pour voir où cela les mène : drogues, jeûnes, religions, modes de vie, expériences affectives et designs ambianciels. Or, il n’y a là rien de bien nouveau. Étant donné son caractère ouvert et non-fixé, l’être humain est celui qui fait des essais, expérimente sur soi et sur les autres des formes de vie possibles, teste, échoue et recommence. Une certaine plasticité le caractérise et rien ne le prédétermine fondamentalement à être ceci ou cela. Il est ouvert au monde et à lui-même. Le divertissement, la violence, le dérèglement, tout cela peut l’aider donc à élargir le cadre d’expérience imposé par la société marchande-spectaculaire qui, comme à Las Vegas, semble trop restreint et contrôlé. Malheureusement, ces expérimentations sont, le plus souvent, elles-mêmes contrôlées, calibrées, canalisées, pour donner lieu à des pseudo-transgressions sexuelles, sociales, festives. D’une certaine façon, le transhumanisme a toujours été présent dans notre histoire, dès le néolithique même, et il n’est nul besoin de fantasmer sur les modifications génétiques et cybernétiques des hommes pour se rendre compte que ces derniers depuis longtemps ont fait de leur corps et de leur esprit des champs d’expérimentation pour tester in vivo les limites de leur condition. Le KluB comme le ParK sont des lieux marginaux et pourtant centraux où ces essais sur soi-même sont rendus possibles et même encouragés. Ce sont des laboratoires anthropologiques.

18 – Il y a dans tes œuvres de fiction une dimension également dystopique de speculative fiction qui n’est pas sans rappeler, comme tu l’as souligné, un certain esprit ballardien. Le ParK nous semble particulièrement emblématique de ton univers et présente – à travers un bout de terre au large de Bornéo d’une superficie de 624 kilomètres carrés – la description d’une structure de loisirs du type hyper Club Med’, associant une réserve animale à un parc d’attraction, un camp de concentration à une technopole, une foire aux plaisirs à un cantonnement de réfugiés, un cimetière à un Kindergarten, un jardin zoologique à une maison de retraite, un arboretum à une prison, le tout raccordé, rattaché, relié, c’est-à-dire fonctionnant non pas de manière autonome les uns à côté des autres, mais associés ensemble, combinés, intriqués… Déjà dans L’Éblouissement des bords de route, il existait chez toi cette volonté baroque de juxtaposer des stations-service à des restoroutes, des chambres de motel à des parkings, ou encore à ces centres commerciaux qui fascinaient tant Ballard. À quel point a-t-il été pour toi un modèle du genre ? Quels sont les autres écrivains dont tu te réclamerais et qui appartiendraient également à la speculative fiction, ou bien à d’autres genres ? Nous pensons bien évidemment à George Orwell.
En effet, je ne le nie pas. Mes fictions appartiennent au genre de l’anticipation, à savoir à une modification de la réalité présente dans un sens inconnu, et souvent perturbateur et outrancier, mais qui demeure crédible, et ce en dépit de son caractère fantastique ou terrible. Le ParK est sans doute emblématique de ce procédé. Depuis la sortie du roman en 2010, des amis s’amusent à m’envoyer des coupures de presse qui relatent, dans le monde réel, le même type d’expérimentation délirante sur l’homme, ses peurs et ses désirs, que celle qui se pratique dans mon enclave imaginaire. Ancien camp de concentration transformé en parc de loisir, exposition sur la torture, exhibition ludico-spectaculaire de la soumission sociale, etc. Parfois, je n’ai pas à inventer, à tordre le réel dans un certain sens et à le transpercer des flèches de l’invraisemblable, ce réel s’avère plus délirant que mes propres inventions, et les rend même terriblement modestes, sages et raisonnables. Il suffit de tendre l’oreille, de scruter certains pans cachés de la société actuelle, pour en extraire des nouvelles post-gothiques toutes faites. Le monde contemporain, modelé par la technoscience et les médias de masse, ne manque pas d’inventer des situations absurdes, comme dernièrement ce robot domestique qui, en guise de défi, recommandait à une fillette de mettre ses doigts dans une prise de courant. Ballard lui-même n’aurait pu inventer cette saynète que notre réalité déjà fantastique et fantasmatique a produite. Certains auteurs ont joué bien évidemment un grand rôle dans mon éducation littéraire, ceux que vous citez et d’autres, comme Sade, Gabrielle Wittkop, Octave Mirbeau, Alfred Kubin, mais je lis des choses très différentes et admire des écrivains dont le style et le monde ont peu de choses à voir avec les miens : Thomas Bernhard, Henry James, António Lobo Antunes, Roberto Bolaño, Cormac McCarthy, etc. Quant à Orwell, c’est plus l’essayiste qui m’intéresse que le romancier. J’ai bien évidemment lu et apprécié ses fictions, ainsi que son récit autobiographique Dans la dèche à Paris et Londres, mais ce qui m’a marqué, c’est sa qualité d’analyse sociale et de réflexion politique sur le vif, au cœur même de l’action et de l’histoire, dans les asiles de nuit, les mines, la guerre d’Espagne.

19 – Tu lis George Orwell depuis longtemps et tu lui as consacré un magnifique essai: De la décence ordinaire (Allia, 2008). Explique-nous l’intérêt appuyé que tu nourris pour cet auteur, les raisons de celui-ci, et surtout ce qui fait lien entre Husserl et Orwell si tel est le cas. Pourquoi Orwell est-il toujours aussi prophétique aujourd’hui alors même que la réalité semble dépasser ses prophéties à l’heure où d’autres œuvres nous promettent bien pire que ses romans – 1984 et La Ferme des animaux – dont nous avons pourtant toujours du mal à nous remettre lorsque nous les lisons. Explique-nous l’incroyable force de ses textes, et comment l’œuvre en général de cet auteur a pu influencer ta propre œuvre.
Ayant lu de manière intense les situationnistes depuis le temps de mon adolescence, j’avais connaissance de la publication des écrits d’Orwell à L’Encyclopédie des nuisances. Comme souvent, lorsqu’un auteur m’intéresse, je me mets à lire toute son œuvre et à ne rien laisser au hasard, dans une approche presque systématique et totalisatrice qui effraie parfois mes proches. Lorsque j’ai publié La Découverte du quotidien, je voulais prolonger cette réflexion par l’analyse philosophique d’une éthicité propre au monde ordinaire et à la vie quotidienne, éthicité ordinaire esquissée chez des gens comme Thoreau ou Emerson. C’est alors que je me suis souvenu de l’œuvre d’Orwell et de la place qu’occupait en son sein l’idée de common decency. Mon essai reflète à la fois l’intérêt que je porte à cette idée d’une décence des pratiques ordinaires de la vie et à la vision critique d’Orwell vis-à-vis du monde moderne tenté par le totalitarisme bureaucratique de la machination généralisée des actes et des paroles, par sa technicisation et sa médiatisation sans issue. Mon essai tente de montrer les apports et les limites de cette notion de décence commune et ordinaire des gens simples et de leurs modes de vie étrangers au pouvoir, à sa conquête et à son maintien. Au-delà même de ce concept, ce que j’admire chez Orwell c’est la clarté de ses idées et de ses engagements, une forme de lucidité rare chez les intellectuels du 20e siècle, lucidité qui lui a permis d’être à chaque fois du bon côté, et lors de moments historiques, de ne pas se tromper de camp. Et puis, je me sens proche également de ses goûts, de ses écœurements, de son amour un peu naïf des cultures populaires, des lieux et des moments ordinaires de la vie, de sa situation de marginal au sein du monde culturel et intellectuel. Avec Pascal et Montaigne, il constitue une lecture de chevet, une sorte de somme humaniste et socialiste dans laquelle je me plonge souvent pour jouir de sa prose limpide et de son esprit vif et tranchant.

20 – Venons-en à ton dernier roman : Le Sauvetage. Avec ce livre, nous sortons de la dystopie prospective pour entrer dans une sorte d’uchronie rétroactive si nous pouvons le dire de cette façon, puisque les événements que tu relates ont réellement eu lieu, sinon que tu imagines la manière probable par lesquels ils se sont déroulés : nous sommes en 1938 et le personnage principal – jeune père franciscain et étudiant en philosophie à l’Université de Louvain – se rend en Allemagne nazie consulter des inédits de Husserl, philosophe d’origine juive, décédé au cours de l’année. Mais accéder aux archives du philosophe n’est pas une simple affaire : sa veuve vit à l’écart, isolée par les mesures antisémites du régime, et la crise de Munich gronde comme l’orage. Lorsqu’il rencontre enfin la femme de Husserl, le personnage découvre plus de quarante mille pages de manuscrits, une masse énorme qu’il décide de sauver de la destruction probable en les faisant sortir du pays. Mais la Gestapo veille… Qu’est-ce qui t’a poussé à écrire ce roman ? Comment, toi-même, à travers tes recherches sur Husserl, as-tu été impliqué dans l’histoire de ses archives ? Quelle est leur importance pour la recherche actuellement ? Ce roman était-il, pour toi, une manière d’en « finir » avec le sujet Husserl ?
J’ai consacré plus de trente ans de ma vie à l’analyse de l’œuvre de Husserl, et il n’y a pas une semaine où je ne travaille tel ou tel passage de ses écrits. Je connaissais, bien évidemment, le récit de Herman Leo Van Breda qui relate son sauvetage rocambolesque des archives. Ce roman est une forme d’hommage, à la fois à l’audace du jeune père Van Breda, sans lequel il n’y aurait pas eu d’archives, et donc sans lequel je n’aurais pas pu faire ma thèse de doctorat, notamment à partir des manuscrits inédits, et bien entendu à la dignité morale de Husserl qui, jamais, ne céda dans le contexte que l’on connaît à la haine et à la faiblesse. Déjà, à l’époque de mes études de phénoménologie, au début des années 90, je voulais écrire un roman sur ce fait historique. Ce n’est que trente ans plus tard que j’ai pu le faire. C’était comme régler une dette, avec Husserl, la phénoménologie et le 20e siècle. Mais ce n’est certainement pas un adieu à Husserl, loin de là ! On ne peut jamais se détacher d’une œuvre aussi immense, complexe et riche, qui réserve, à mesure que des textes inédits sont publiés, des surprises, qui oblige à des reprises et des changements de position. Ce dialogue ne cessera donc jamais, et cette générativité philosophique se poursuivra bien après la mort des uns et des autres.
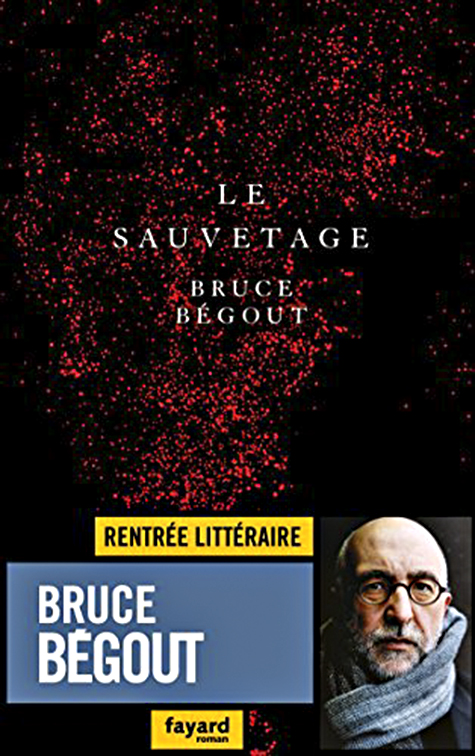
21 – C’est la première fois que tu utilises un moment historique pour en écrire une fiction. Peux-tu revenir pour nous sur le déroulé de la rédaction de ce roman, ce que tu souhaitais dire, expliquer, révéler. En quoi dirais-tu que ce roman est finalement une suite logique à tout ce que tu as pu écrire jusqu’à aujourd’hui ? L’extrême précision de ton écriture, presque chirurgicale, le soin de ton style réaffirmé par l’exigence de ta langue, témoigne-t-il d’un besoin de poser toi-même les valises, et de faire de ce roman, un geste d’écriture absolue en ces temps de production d’œuvres superficielles, sinon superfétatoires ? Ce roman est-il une sorte de testament philosophique et littéraire d’une certaine modernité agonisante ?
Oui, j’avais l’impression d’avoir fini un cycle, un cycle post-gothique, avec deux romans et deux recueils de nouvelles, publiés entre 2009 et 2017. Je voulais mettre en chantier une nouvelle phase, sans doute plus liée à l’histoire réelle de la modernité, celle de la colonisation, de l’expansion du capitalisme et du totalitarisme, de la mécanisation de la vie. Mais en vérité, si l’on regarde bien ce que j’ai fait dans Le Sauvetage, cela prolonge directement les récits noirs et fantastiques. D’une part, je me suis emparé de ce fait historique, mais sans le traiter sur le mode de la chronique journalistique et du récit haletant, comme d’autres auteurs français récents s’occupant de cette période historique ont pu le faire, de manière un peu paresseuse à mon goût. Plutôt en le soumettant là encore à ma méthode d’exagération baroque, loufoque et carnavalesque (ce que certains critiques m’ont reproché), en créant un théâtre d’ombres grotesques. D’autre part, ce que ce récit raconte ce n’est rien d’autre que l’explosion des pathologies de la modernité, l’antisémitisme, le racisme scientifique, la propagande et l’extermination mécanique des idées, des livres et des hommes. D’une certaine façon, ce roman prolonge la vision crépusculaire des écrits post-gothiques et un même climat de farce macabre hante ce récit, notamment avec l’apparition du gestapiste Lehmann, pauvre type sorti tout droit de L’Œuf du serpent de Bergman ou d’une pièce de Fassbinder. J’ai choisi, pour ce faire, une écriture précise, ciselée en effet, mais qui se laisse souvent aller à la pure provocation, au grand-guignolesque, en mélangeant les références, en jouant avec les anachronismes, en introduisant la culture de masse la plus vulgaire, celle des Krimi, dans l’histoire du Troisième Reich. Je ne voulais pas écrire un roman en costumes, un roman historique et poignant, un roman réaliste et moralisateur, même si bien évidemment, le choix du sujet et son traitement expriment ma position morale. Pas la peine d’en rajouter dans les leçons d’éditorialiste sur le sauvetage de la culture. Le titre, le thème, le ton du roman disaient tout cela pour celui ou celle qui savait lire entre les lignes…
22 – Ton projet d’essai – La Grande fatigue : Aphorismes pour la fin des temps – porte sur la question du nihilisme occidental. Cette question qui a beaucoup préoccupé les penseurs russes, italiens ou allemands (beaucoup moins les français, curieusement) est-elle seulement à tes yeux circonscrite à l’Europe et aux États-Unis ? N’assiste-t-on pas au contraire à une forme de planétarisation du nihilisme, du monde occidental jusque l’Asie en passant par le Moyen-Orient ? Par ailleurs, les quelques aphorismes que tu as publiés (Inculte, n° 15, 2008) laissent parfois entendre que tu articules la question du nihilisme passif avec celle du quotidien et de son confort. Tu rejoins, par là, certaines analyses du Peter Sloterdijk des Sphères. Pourquoi un Français – un Bordelais, qui plus est ! – s’intéresse-t-il à cette question ? Peux-tu en dire un peu plus sur ce projet ?
J’hésite encore à publier ce travail, pour lequel j’avais obtenu la bourse Cioran en 2016, ce long recueil d’aphorismes et de textes courts sur le nihilisme. Lorsque j’ai commencé ce travail, c’était au début des années 2000. Depuis, d’autres facteurs sont entrés en jeu, notamment la crise climatique et géopolitique, et je ne suis plus sûr que les constats que je faisais dans ce recueil sur le nihilisme actuel et les essais de dépassement gnostiques et messianiques soient encore pertinents. Cependant, je fais souvent un séminaire de recherches à Bordeaux sur le nihilisme, sur son histoire depuis la querelle entre Jacobi et Fichte jusqu’aux analyses de Nietzsche, Heidegger et Bloch, en passant par Baudelaire et Dostoïevski. C’est vrai qu’à part Kojève, et peut-être dans une moindre mesure Castoriadis, ce n’est pas un thème qui a vraiment intéressé les philosophes français, lesquels y voient sans doute une question trop littéraire, polémique, subjective, indigne au fond de la problématisation théorique et scientifique. En France, le nihilisme c’est l’objet chéri des littéraires : Baudelaire, Rabbe, Céline, Bernanos, Blanchot, Cioran, et plus près de nous Houellebecq. Non des philosophes sérieux. Pourtant, c’est une question fondamentale de notre temps, de notre rapport aux valeurs et à leur absence, de notre manière de nous représenter le monde comme rempli ou vidé de sens. Qu’il soit passif, la dépression, ou actif, la destruction, le nihilisme est l’esprit de notre temps, celui au sein duquel toutes les productions matérielles et symboliques baignent et ne peuvent s’en extraire.

23 – Pour reprendre le mot d’ordre fondateur de Husserl, à savoir le retour aux choses mêmes, revenons à la phénoménologie pour conclure cet entretien avec la publication de ton essai : Le Concept d’ambiance : essai d’éco-phénoménologie. De quoi est-il le nom ? Qu’est-ce l’ambiance en phénoménologie à l’ère de la Covid 19 ?
Ce n’est qu’en 2011, lors d’un séminaire que je faisais sur l’expérience nocturne et la quotidienneté empêchée, que ce terme s’est imposé à moi. En fait, cette notion hantait déjà tout mon travail, mon travail philosophique sur la tonalité affective de la quotidienneté, à savoir la familiarité, et mon travail littéraire sur les villes et les atmosphères urbaines, celles de Las Vegas, des motels et de la suburbia mondiale. Mais il n’était pas thématisé pour lui-même. Très vite, j’ai compris que cette notion était fondamentale pour moi, pour ma phénoménologie anarchique du monde de la vie et des singularités qui ne se laissent jamais saisir dans des dispositifs hégémoniques. Car l’ambiance est la dimension fondamentale de notre présence au monde, dimension qui précède l’attitude théorique et pratique, qui nous plonge au cœur d’une appartenance affective au monde. Je devais clarifier impérativement le sens de ce phénomène et j’ai alors entrepris un long chemin fait d’études, de lectures et d’analyses, entre 2011 et 2019, moment où j’ai achevé la rédaction du Concept d’ambiance. L’analyse phénoménologique des ambiances vise à montrer que, sous la distinction des sujets et des objets, existe un champ d’expérience immanent auquel nous participons affectivement. L’ambiance serait alors la manifestation de cette présence antérieure à la séparation du moi et du monde, et donc antérieure à l’individuation, une plongée dans le fond de l’être ou plus exactement de l’entre. Moi qui m’étais promis de tourner le dos à la phénoménologie fondamentale pour explorer les phénomènes singuliers et réfractaires, je suis en quelque sorte obligé, par la chose même, de présupposer cette homogénéité de l’expérience. Ce faisant, cette recherche, au départ régionale, sur un domaine de réalité spécifique, les ambiances et les atmosphères, s’intègre à tout un champ de recherches actuel sur la phénoménologie de la nature, du monde, d’un fond ontologique précédant toute division et l’engendrant. Derrière l’apparente banalité des ambiances se manifeste une autre conception de l’homme, de son inscription originelle dans le monde, de son appartenance à ce fond homogène et indifférencié. Quelle que soit l’ambiance envisagée, par exemple celle des villes désertes lors des différents confinements, ce dont nous faisons l’expérience, c’est de cette unité préalable du monde, de cette participation sympathique à ce qui nous entoure et nous affecte. Il y a là, je crois, un nouveau départ pour une ontologie de l’entre, du fond, du champ, irréductible à celle des états mentaux et des choses. C’est ce même fond, pluriel et préhumain, que Proust cherche à décrire, que Barnett Newman peint, que Luigi Nono explore musicalement.

24 – Dans ton nouveau livre, Obsolescence des ruines, essai philosophique sur les gravats, tu prends à contrepied toute une tradition dans ton interprétation du motif de la ruine. La conscience de la ruine est une idée qui apparaît tardivement en Europe, à l’époque des Lumières (Hubert Robert, Diderot), elle a fasciné la période romantique et inspiré de nombreux écrivains et penseurs. L’image que l’on a traditionnellement d’elle est celle d’une perception mélancolique, voire cosmique (chez quelqu’un comme Simmel, par exemple). Or, tu retournes cette image en mettant à nu la tension dialectique de la ruine : en rappelant que sa fascination est concomitante de la naissance de l’archéologie, tu montres bien que toute ruine à l’inverse fait signe vers le futur ; certes, la ruine est le témoin de la dégradation, de la morsure du temps, d’un passé révolu et nous renvoie à notre caducité, mais simultanément, elle inverse la flèche du temps, elle est trace et donc persistance et survivance. Or, c’est justement ce mouvement contradictoire propre à l’ambiguïté des Lumières – et c’est la thèse centrale de cet essai -, qui n’est plus possible selon toi à l’âge postmoderne, âge obsédé par le présentisme (pour parler comme François Hartog) et l’effacement de ses propres traces, se diluant dans les flux immatériels de la marchandise et du travail abstrait. Nous sommes entrés dans un monde sans traces, un monde oxymorique fait de ruines éphémères, livré indéfiniment aux cycles du capital. Comme l’a rappelé Jean-Yves Jouannais lors de sa dernière conférence à L’Encyclopédie des guerres, la ruine est un trou, un trou de mémoire. Or, notre monde est de plus en plus amnésique, sans mémoire, celui d’un présent perpétuel, qui se consume dans « l’annulation du futur » (Mark Fisher). Tu en conclus, de ton côté, à une philosophie de l’histoire funeste, celle d’une ruine de la ruine. Cela appelle une question : est-ce que l’on ne peut dire qu’au cœur de ces ruines éphémères gît une forme d’extase, une « extase dans l’aliénation » pour reprendre une formule de Ian Sinclair à propos de Ballard ? Cette extase n’aurait-elle pas quelques liens avec ce que Derrida appela en son temps l’hantologie, mais telle que Mark Fisher (encore lui), quelqu’un plus proche de nous, l’a explorée dans ses écrits (sur Joy Division, David Peace ou The Caretaker, par exemple) ?
Oui, c’est un nouveau champ qui s’ouvre ici. Même si mon travail peut donner l’impression d’un éclatement, se dispersant en plusieurs thèmes (la ville, le quotidien, l’ambiance, le choc de la modernité, le phénomène singulier, l’errance, etc.), c’est toujours une seule et même question qui me taraude. Derrière l’éclectisme apparent se tient une unité profonde, une même intuition clandestine qui, à travers tous ces forages dans diverses directions, maintient ensemble les galeries ainsi ouvertes et forme un réseau cohérent. Dans mes différents travaux sur la ville et la suburbia, j’avais souvent remarqué le caractère fragile des constructions contemporaines. Ce même état de précarité sociale et ontologique transpirait de partout, dans les hangars décorés, les zones pavillonnaires, les centres commerciaux. On aurait dit un monde prêt à tomber en lambeaux à la moindre secousse. Un monde qui, loin de masquer l’inquiétude originelle de notre être au monde, l’exhibait sans détour. C’était même un leitmotiv du livre sur Los Angeles, cette ville prête à chaque instant à s’effondrer et à disparaître comme un mirage, provoquant une sensation sceptique saisissante dans notre relation à la réalité extérieure, mais surtout dans notre rapport avec les autres. Cela fait donc depuis longtemps que ce thème de la vulnérabilité de l’architecture vernaculaire m’obsédait. À partir d’une conférence donnée en 2014 sur les « ruines à l’envers » de Robert Smithson j’ai développé toutes les conséquences sociales, anthropologiques et philosophiques de cette production de la fragilité architecturale, de l’obsolescence programmée des bâtiments. J’ai reconstitué la montée progressive de ce sentiment de la ruine instantanée dès le 18e siècle, puis son élargissement jusqu’à la prise de conscience de l’extrême précarité de l’espace urbain actuel (Hannah Arendt, Günther Anders, Marshall Berman) dont l’espérance de vie est réduite, étant deux fois plus courte que celle d’un homme. J’ai également consacré de longues analyses à l’urbex, que j’interprète comme une réaction à cette précarisation accélérée de l’architecture et la volonté de préserver, d’arpenter et d’archiver les dernières ruines, celle de la phase industrielle de la modernité. Car si les urbexeurs se tournent vers les usines, les gares et les hôpitaux construits entre 1850 et 1950, c’est parce qu’ils constatent que le bâti actuel est incapable de durer et se transforme en gravats au moindre abandon. Il n’y a là rien à explorer, à gravir, à photographier, que des monceaux de déchets sans intérêt. J’ai mis le projecteur sur Walt Whitman, les surréalistes, le Suicide club de San Francisco, les travaux littéraires d’Iain Sinclair et de Philippe Vasset. Enfin, la dernière partie tente de repenser la philosophie de l’histoire à l’ère du catastrophisme ambiant en réaffirmant, contre le messianisme, l’opium des intellectuels aux âges obscurs et défaitistes qui attendent toujours un miracle, l’idée de progrès et d’une téléologie graduelle vers le bien. C’est dans cette partie que la question de l’effondrement du futur ou plutôt de notre relation au futur est posée, à travers l’idée d’un monde ruiné, mais sans ruines, d’une obsolescence programmée de nos vies. Nous sommes les derniers témoins d’un monde qui disparaît et nous nous hâtons comme des touristes du désastre pour contempler les derniers paysages et lieux de ce monde avant qu’ils ne s’évanouissent. Nous flottons dans cette atmosphère des derniers temps, toujours propice à la résurgence de la conscience prophétique et apocalyptique. L’absence de ruines futures nous hante comme la promesse étrange d’une perte de mémoire et d’une vie amnésique irrémédiables. Mais derrière cette réflexion sur les ruines ou plus exactement leur disparition à venir, qui ne sera compensée par rien, si ce n’est la prolifération des nouveaux bibelots numériques (images, messages, infox, etc. ), – c’est étrange de constater d’ailleurs comment, de nos jours, les intérieurs des maisons et des immeubles sont de plus en plus dépouillés, et comment, en revanche, les consciences sont remplis de pacotilles mentales, de kitsch fantasmatique, de napperons et verroteries virtuels dans le metaverse – c’est le rapport entre le devenir et notre manière de nous y installer qui m’intrigue. L’homme peut-il accepter de vivre dans l’instable ? Peut-il renoncer à aménager un séjour dans le monde solide, durable, transmissible ? Doit-il se convertir, de tout son être, à l’accélération du temps, à la mutation des corps et à l’évanescence des objets, des choses et des bâtiments ? Même si l’idée de durée et de solidité est un mensonge ontologique qui nous cache le devenir fluent sous la forme rassurante d’un être stable, le mensonge est aussi utile, nécessaire, vital même, c’est ce que nous a appris Nietzsche qui connaissait plus que tout autre penseur la valeur de l’illusion, et sa nécessité anthropologique et sociale.
Texte © Bruce Bégout, Xavier Boissel & Caroline Hoctan – Illustrations © DR
(Lectoure, hiver 2018-printemps 2022)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
