Je reprends ici le titre de Miklos Szentkuthy, En marge de Casanova, œuvre un peu foutraque, mais attachante, composée de notes sur sa lecture singulière de Casanova. Szentkuthy cherche à mettre du désordre dans les mémoires très rythmées de Casanova, ce qui a pour effet de rendre plus déjanté et mystique le parcours du Vénitien. N’écrivant pas dans sa langue maternelle, Casanova compose ses mémoires avec application, il doit suivre une composition strictement chronologique. Or la « fragilité » de sa langue rend Casanova assez sympathique et vulnérable. Mon héros, Alvise, est aussi la victime inconsciente de son mauvais anglais. Malgré ses efforts, il sait qu’il est venu trop tard à New York pour être véritablement assimilé. Surtout si on l’oppose à Spencer, son colocataire, doté d’un anglais britannique irréprochable. Dans la scène du « pharaon » à la fin de mon roman, je déguise mon héros en Casanova. Casanova faisait un mètre quatre-vingt-dix (géant pour l’époque), et en écrivant, je pensais à l’impact physique du géant au visage grêlé sur les autres Vénitiens. Justement, ce physique particulier le rend vulnérable et repérable. Force et faiblesse.
À l’origine, je voulais donner pour titre La Nuit est jeune à mon roman (Herodios, 2020). Pourquoi ? Parce que c’est un exemple de mauvais titre qui peut devenir bon. Le livre est écrit en français, mais il est censé être écrit en italien. Le décalage entre les langues, la mauvaise compréhension entre les êtres à cause de la pauvreté de leur langue est un moteur de la narration. La Nuit est jeune fonctionne parfaitement en anglais (le musicien Cole Porter a inventé l’expression), mais en français ou en Italien, « ça fait bizarre ». Le malentendu entre Alvise et les femmes anglophones (Meg et Claire) altère ses sentiments, parfois en bien. Le malentendu commence par la langue. Et sans dévoiler l’intrigue, il est évident que le début de la relation « sans mot » (puisque dans l’absence) d’Alvise et l’inconnue se poursuit bien plus tard grâce aux mots, et même à la forme des lettres, mais je veux pas trop dévoiler l’intrigue…
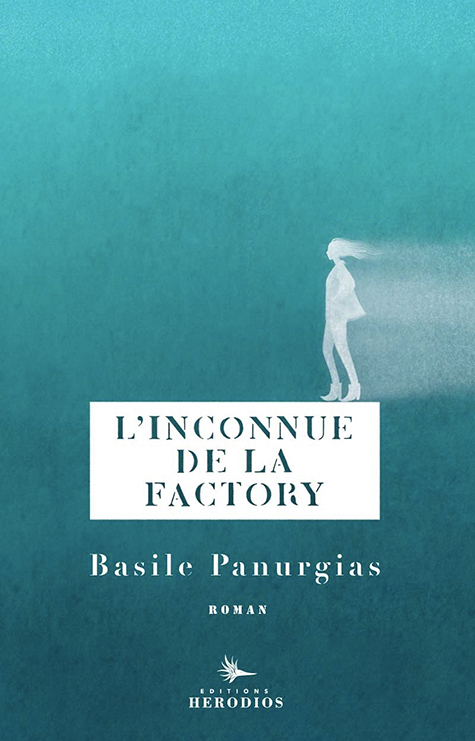
New York et Venise sont deux villes que je connais bien. J’ai vécu longtemps dans la première et me suis rendu de nombreuses fois dans la seconde. Elles ont plus ou moins la même superficie (je parle de Manhattan pour New York, puisque j’évoque le New York des années 90 où les cinq boroughs ne sont pas encore « légitimés »…). Elles sont cosmopolites, chrétiennes et juives (au présent ou au passé), une création artistique spectaculaire les a traversées. De nos jours, le tourisme se nourrit de leurs beaux restes. Elles ont concentré les richesses du monde à deux époques différentes, et il n’est pas faux de dire que New York est au monde ce qu’était Venise au 16e siècle. À l’origine, Manhattan et Venise étaient deux îles dont on a rajouté un cordon ombilical pour les rattacher au continent (remblayage entre le Bronx et Manhattan, construction du chemin de fer pour Venise). Ceci est important à mes yeux, car c’est un rattachement contrarié. Plus récemment, et plus discrètement, un nouveau cordon ombilical a été ajouté, sous la forme de l’apparition du portable, puis de l’Internet. Être en bateau à Venise avec un portable est une expérience qui dénature complètement l’expérience maritime. À l’inverse, vivre avec un téléphone filaire aux communications hors de prix préservait l’insularité de New York. Jusqu’à la fin des années 90, je séjournais plusieurs mois de suite sur une île grecque, recevant des nouvelles du monde extérieur par mon courrier qui arrivait en poste restante ; c’est certainement un écho de ce sentiment que je voulais reproduire pour Alvise. Si Manhattan avait été ouvert, je n’aurais pas pu rencontrer facilement des artistes tels que Bret Easton Ellis ou Roy Liechtenstein, lesquels pouvaient converser avec un « nobody » qui n’allait pas exploiter ce moment sur Instagram ou ailleurs. Il ne s’agit pas de discours de groupie, dans East Village Blues, Chantal Thomas elle aussi n’en revient pas de croiser Allen Ginsberg qui s’adresse à elle avec simplicité, alors qu’en France, le passage de témoin dans le monde des lettres s’effectuait exclusivement par réseau familial ou milieu social. Le lecteur peut être surpris qu’Alvise s’intègre aussi facilement, et j’ai repoussé d’une dizaine de pages la scène de la colocation pour qu’un lecteur français puisse accepter l’intégration spectaculaire du Vénitien, même si ayant vécu à New York, j’ai été adopté en deux semaines. Si j’insiste sur cet élément insulaire, c’est que la singularité culturelle constitue le sel de l’identité, et il faut bien l’admettre, de la nostalgie. La télécommunication rapide a créé des merveilles, comme un renforcement de l’information, et des horreurs, comme un renforcement de la désinformation. Oui, simultanément. Dans L’Inconnue de la Factory, je parle du premier stade où New York et Venise « s’ouvrent » au surtourisme, convaincus de la force de leur identité elles pensent, à tort, résister à la « santonisation ». Mes personnages sont donc plongés dans cette société qui perd ses repères. Il est toujours confortable de ne voir New York que par la rupture du « 11-Septembre ». Or ce symbole médiatique d’une perte d’innocence de la ville ne doit pas cacher la mise au pas d’un New York anarchiste et bouillonnant qui précède l’élection de Rudolf Giuliani, (elle-même provoquée par la venue à New York de la classe moyenne des banlieues blanches à Manhattan), tout comme il est facile de ne voir que la mort de Venise à l’aune des Aqua Alte et des passages de paquebots géants, sans voir que le coup de grâce avait déjà eu lieu en 1956, quand la municipalité interdit de faire évoluer le modèle de gondole unique et figea à jamais la cité lacustre.

Alvise, mon héros essaye de provoquer la confrontation entre les deux villes grâce à son désir de vendre une fórcola (support de rame de gondole) à New York. Silvana, sa colocataire vénézuélienne elle, essaye de s’intégrer à New York, et voit en Alvise un danger pour l’assimilation des étrangers. Peut-être que la source de leur haine vient de là. En même temps, Alvise commet l’acte ultime anti-new-yorkais, résoudre un litige en appelant à l’étranger, en l’occurrence téléphoner à Caracas pour que le père de Silvana paye les arriérés de loyer de sa fille. Ainsi il « sort » de l’île, et doit être puni pour cette trahison. Quand j’habitais à New York, je me souviens que ma disparition pendant l’été en Europe était très mal perçue. De manière pre-metoo en me mettait en garde : « New York est une femme, si tu n’es pas toujours présent pour elle, elle ira voir ailleurs ». Je ne comprenais pas très bien la nature de ces reproches, les mettant sur le fait que les douze jours de vacances de l’Américain forcément suscitaient de l’envie. En réalité, New York était un automate, parfaitement huilé, autosuffisant et séduisant, objet qui ne souffrait pas les éléments perturbateurs, les enfants, les assistés, les vieux, et dans mon cas les Européens peu fidèles à la logique d’immigration définitive. Les Européens justement ont longtemps été ignorés dans la littérature contemporaine américaine. Soit ils sont dégénérés, comme le journaliste anglais inspiré par le brillant Anthony Haden-Guest dans Le Bûcher des Vanités, soit l’étranger est la part sombre du héros, l’iranien Alagash dans Journal d’un oiseau de nuit ((Ce titre tartignole était révélateur de l’amateurisme sympathique des défricheurs de la littérature américaine de l’époque. Depuis, grâce ou à cause de l’omniprésence de l’anglais le titre Bright lights big city n’est plus traduit.)) de Jay McInerney, soit totalement absents (tout Bret Easton Ellis, Updike, Shriver, etc.). Pourtant, les centres de New York et de Los Angeles étaient envahis par les Européens, lesquels étaient devenus essentiels dans le fonctionnement de ces villes (pas d’Hollywood sans Schwarzenegger, pas de soirées new-yorkaises sans le français Marc Biron et l’anglais Mark Baker). L’étranger n’est valorisé que lorsqu’il est entièrement assimilé (Schwarzenegger encore, et le lutteur français André le géant, parmi ceux qui refusaient d’être interviewés dans leur langue maternelle). De l’autre côté de l’Atlantique, les romanciers populaires qui adorent les États-Unis ne leur donneront jamais des noms latinos ou mêmes italiens, mais toujours WASPS, comme Travis Dawn pour Joël Dicker ou Sam Galloway pour Guillaume Musso, seule trouve grâce à mes yeux Catherine Pancol qui nous narre les aventures de la famille Cortès dans Muchacha…Mon Alvise italien représente donc un problème. Et il essaye d’introduire des valeurs purement européennes (l’esthétique des vitrines et des lettres) à New York. Ce n’est pas par hasard que dans les années 70, l’image de New York a été confiée au graphiste italien Massimo Vigneli, qu’Alvise vénère.

Le livre est au passé simple et non, comme la plupart des romans actuels, au passé composé ou présent de narration. Je veux justement souligner la nostalgie de New York. Non, ce n’est pas un mot vilain, la nostalgie bien vécue est un sentiment très agréable. Il devient morbide quand il régit et bloque le présent. New York au passé simple est aussi doux que le noir et blanc anachronique de Manhattan de Woody Allen. Pour Woody Allen, son New York du passé est celui de son enfance, et des films noir et blancs. Pour moi, il s’agit plutôt du New York très agressif des années 80, le passé simple essayant de le figer, comme les silhouettes convulsées des dessins emblématiques de l’époque Men in the cities par Robert Longo. Sur ce sujet, à l’époque, j’avais eu la chance d’acheter un Men in the cities, il s’agit en fait plutôt d’un « women » puisque c’était le portrait de Cindy Sherman par Robert Longo, lequel était alors son petit ami. Je l’ai gardé quelques années, puis un jour, j’ai décidé de le vendre. Pourquoi ? Je n’avais plus d’argent, mais aussi parce qu’un ami qui avait l’œil, m’avait dit qu’il était faible, ce que je savais secrètement. Il avait entièrement raison. J’avais du coup fait une erreur de goût. L’intérêt dans cette histoire est que j’ai recyclé dans mon roman cette histoire, en choisissant une sculpture de l’artiste Kcho. La littérature et un meilleur investissement que l’acquisition d’oeuvres d’art…Kcho est un artiste cubain, devenu parlementaire castriste. À l’époque, en 1991, il s’était inspiré des « balseros » pour son art. Les balseros étaient ses familles qui fuyaient vers la Floride sur des petites embarcations. Je les avais vues à Cojimar, célèbre pour sa maison de Hemingway, j’avais été témoin de ces débuts de traversées, où certains trouvèrent la mort. Kcho était un artiste de la cubanité brute, alors qu’aux États-Unis, ce genre d’art ne trouvait d’écho que dans l’ironie portée sur lui (Ashley Bickerton et Tom Sachs viennent à l’esprit), en fait un art encore impérialiste sous des couverts de générosité. J’ai choisi volontairement un artiste peu connu, mais avec un vrai marché pour ne pas polluer l’intrigue.

Quand la Fenice a brûlé au début des années quatre-vingt-dix, probablement par la mafia, les restaurateurs ont récréé la nouvelle Fenice d’après les photogrammes du film Senso de Visconti. New York est une ville qui est déjà un cinéma en soi, et c’est peut-être pour cette raison qu’elle produit des films médiocres, malgré sa photogénie. Dans The Tourist, le talentueux Florian Henckel von Donnersmarck ne peut s’empêcher de nous emmener dans des clichés de la lagune. Et David Lean dans Vacances à Venise a eu aussi un mal de chien à se battre contre les symboles de Venise. Dans mon roman, je recrée la pension inventée par David Lean pour le film Vacances à Venise (Summertime en VO). Tout est faux dans cette pension parce que tout est faux de toute manière dans toutes les pensions qui veulent faire vrai. Le faux du faux est vrai, surtout à Venise… Venise est théâtrale depuis toujours, c’est une création humaine pure. C’est sa force, un hymne à l’homme bâtisseur, et son échec, l’homme l’a bâtie sans penser que la nature autour d’elle changerait. Mon idée de transformer Alvise en guide des monuments des années 50 est la clef de cette nostalgie décalée. Tout comme la municipalité à empêcher de faire évoluer la forme des gondoles après 1956, l’interdiction de constructions contemporaines (malgré quelques tentatives, comme celle de Frank Lloyd Wright en 1951 sur le Grand Canal) a signé l’arrêt de mort d’une Venise évoluant avec son temps. Pas si vite certains diront, les nouvelles technologies permettent d’appréhender l’architecture différemment (voir Éléments de Venise par Rem Koolhaas), et du coup une vue de drone qui survole les toits fait évoluer Venise. C’est dans cet esprit que j’ai introduit la scène du drone dans laquelle Alvise, réfugié sur son altana se masturbe en paix face à l’immensité du ciel nuageux.
Voici donc quelques réflexions en marge de mon roman dont je souhaite que la lecture en provoque d’autres…
Texte & Photographies © Basile Panurgias – Illustration © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
Légendes :
2e ill. : Le Roxy était une boite géante qui a lancé les années 80.
3e ill. : Le photographe mondain Patrick McMullan commande un verre au bar du Nel’s. (Il faut voir un parallèle avec « Le bar des folies bergères » de Manet).
4e ill. : Loft dans le Wesbeth vers 1990. Communauté d’artistes où Diane Arbus a sauté du dernier étage…
