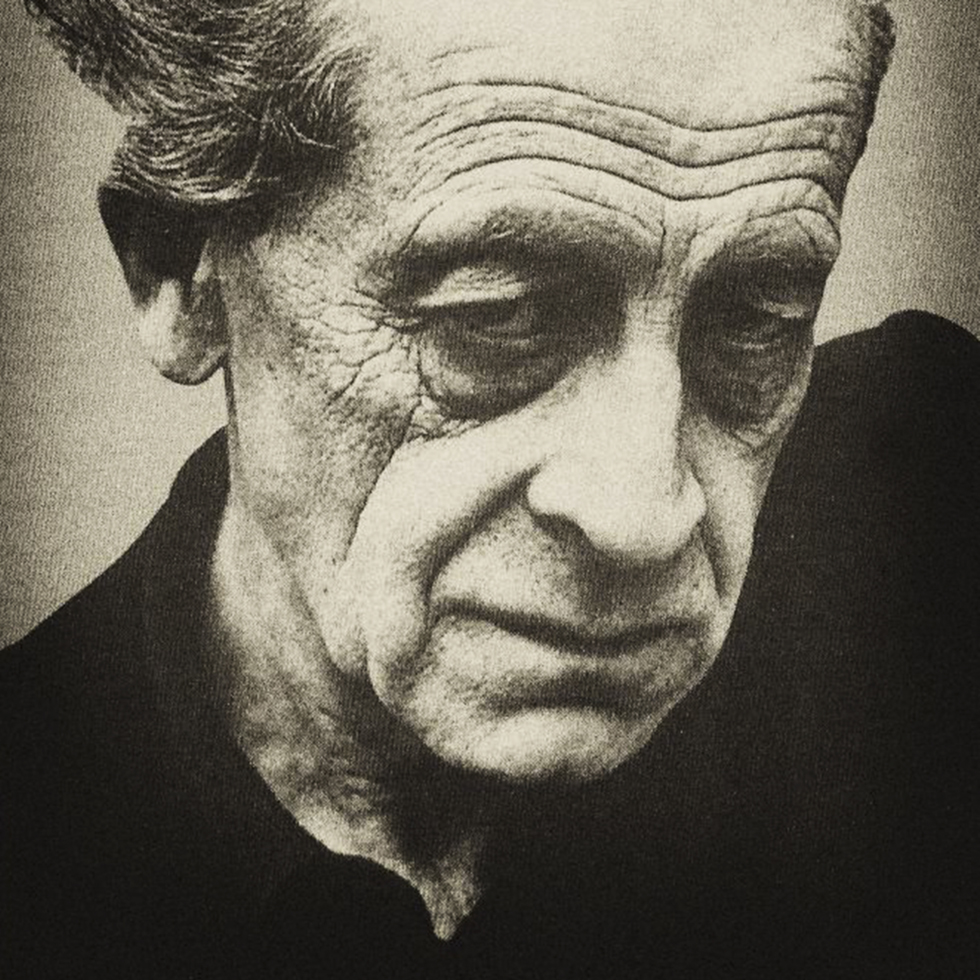CATHERINE PERRET s’entretient avec HÉLÈNE CLEMENTE à l’occasion de la publication de son essai, L’ENSEIGNEMENT DE LA TORTURE : RÉFLEXIONS SUR JEAN AMÉRY (Le Seuil, 2013) :
1 – Pourriez-vous nous situer l’écriture de L’Enseignement de la torture : réflexions sur Jean Améry dans le contexte de vos recherches, sur l’art, l’esthétique, la culture ? Comment la lecture du texte de Jean Améry vous permet-elle de revenir sur les racines du malaise de nos sociétés contemporaines ?
Mes recherches se poursuivent sous un angle ouvert entre théorie critique, l’anthropologie psychanalytique et l’histoire des arts modernes et contemporains. L’étude de la transformation du concept et des pratiques de l’art aux 20e et 21e siècle m’a amenée à poser et à reposer les questions posées par Freud dans la réponse qu’il adresse en 1936 à Einstein, lorsqu’ils s’interrogent mutuellement sur « Pourquoi la guerre ? » et que Freud s’interroge sur son propre pacifisme. Débarrassant ce pacifisme de toute justification morale, ou politique, il l’analyse en termes pulsionnels, en termes simultanément normatifs et vitaux. Il écrit alors : « Il y a des fondements organiques à nos changements d’idéaux éthiques et esthétiques ». Freud indique ainsi que si nous voulons résister aux pulsions d’autodestruction qui menacent la civilisation, c’est-à-dire le processus social d’hominisation sans lequel aucun homme (aucune femme) ne survivrait à sa condition d’animal prématuré, il est nécessaire de travailler à de nouvelles formes de compositions pulsionnelles. Cela ne peut s’opérer que par d’autres élaborations de la mémoire individuelle, par la construction de modalités de transmission inédites, par l’invention d’une nouvelle vie avec les morts. Ce travail passe par la culture. Qu’une autre expérience du corps, de ce que nous appelons « mon corps », et par conséquent d’autres désirs politiques, puissent naître de ces nouvelles formes mémorielles est un espoir raisonnable. Ce postulat m’a conduit à l’esthétique en tant qu’elle a à voir avec l’éthique, aux idéaux, et aux processus d’idéalisation induits par les injonctions de l’empire de la consommation contemporaine : à l’esthétique envisagée non plus du point de vue de l’art mais de la valeur ou du fétiche ; aux problèmes liés à ce que Walter Benjamin appelle « l’esthétisation de la politique ». Ces modalités d’esthétisation contemporaines de la vie font barrage et écho aux traumas individuels et collectifs provoqués par le processus d’autodestruction de l’humanité par elle-même qui débute avec la Première Guerre mondiale. De même que celui ou celle qui a subi un trauma s’éprouve hors de sa peau, désaffecté et comme anesthésié par le choc subi et forclos, de même l’esthétique des sociétés contemporaines se caractérise par une manière de désensibilisation, de désapprentissage des sensations (révélé par l’addiction à la sensation) et plus profondément encore par une sorte d’inhibition de la perception. Ainsi envisagée, la consommation ne peut plus être seulement comprise comme un « plus-de-jouir », mimique de la production de « plus-value » prélevée à même la jouissance du consommateur. Elle produit dans la vie quotidienne le même effet d’irréalisation que les méthodes de « soft-torture » qui se « bornent » à interdire l’exercice de la perception en immergeant la victime dans un univers strictement insensible. Ces effets de la soft-torture, et plus profondément leurs enjeux politiques, l’essai de Jean Améry (Par-delà le crime et le châtiment : Essai pour surmonter l’insurmontable), la reconstruction qu’il y propose de son expérience de la torture, en 1943, dans la forteresse de Breendonk (Belgique) alors aux mains des nazis, l’éclairent avec une acuité inégalée.
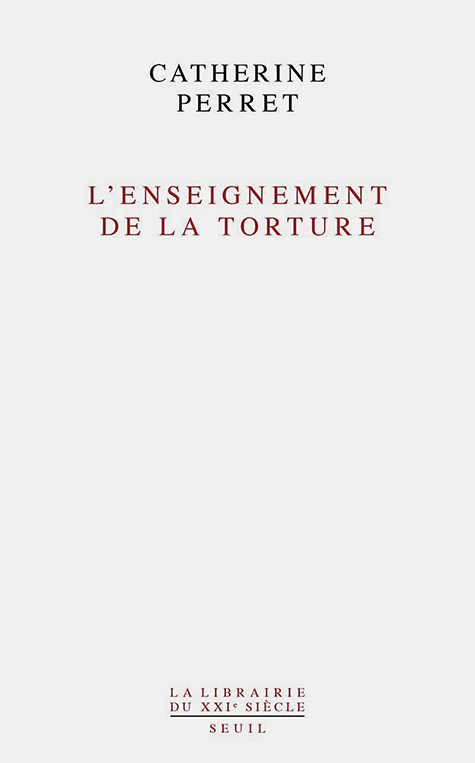
2 – Quels sont, pour vous, les enjeux d’une historicisation de la torture ? En quoi la torture n’est-elle pas une « méthode » au service d’un appareil politique mais constitue un véritable rituel politique ? Que cherche t-il à atteindre en nous ?
La torture fut abolie en Europe au 18e siècle. Elle le fut en France notamment en 1788 par Louis XVI. Dans des sociétés en voie de sécularisation, l’ordalie n’avait plus aucun sens et la torture avait démontré son efficacité très relative quant à la fiabilité de l’information soutirée. Sa progressive ré institutionnalisation aux 20e et 21e siècle, sous couvert de juridictions militaires, émane d’états impérialistes (la France coloniale, les États-Unis sous le régime instauré par Georges Bush Jr) ou de dictatures nationales (l’époque stalinienne, les pays latino-américains). C’est un phénomène qui obéit à des raisons politiques et non pragmatiques, comme certaines discussions sur la guerre « juste » contre le terrorisme ont pu le laisser supposer. Pour approcher ce phénomène, il est nécessaire de revenir au régime qui a fait de la torture un rituel explicitement fondateur, le nazisme, et de reconnaître l’éclairage que ce régime projette sur l’ensemble de la civilisation chrétienne occidentale moderne jusqu’à aujourd’hui. La torture nazie que j’analyse dans L’Enseignement de la torture à partir de mes réflexions sur l’oeuvre de Jean Améry révèle les fondements culturels de cette pratique : la manière dont elle prétend faire société. Jenseits Schuld und Sühne, le recueil d’essais dans lequel Jean Améry présente, en 1966, son propre essai sur la torture montre que la torture a fait expérience et sens pour lui, a posteriori, dans les épreuves traversées à Auschwitz par l’intellectuel juif autrichien qu’il était alors, et au fur et à mesure que l’histoire de l’Allemagne et de l’Europe reprend son cours sous le nom de « reconstruction ». L’exil dont personne ne parle, la naissance de l’antisionisme d’extrême gauche, l’impunité d’une administration allemande très superficiellement dénazifiée, réactivent ce que fut l’expérience de la torture, « le sentiment d’être devenu à ce point étranger au monde qu’aucune communication ultérieure avec les hommes ne pourra jamais le compenser » : « J’étais un homme qui ne pouvait plus dire nous et qui pour cette raison disait je par habitude… je n’étais plus un Moi et je ne vivais plus dans un Nous ». J’ai voulu montrer, dans mon livre, que cette solitude n’est pas l’effet mais le but visé par la torture nazie. Qu’elle éclaire le sens moderne de la torture : produire un corps solitaire, « purifié » de la solidarité qui définit la condition humaine. Si la légitimation de la torture est en ce sens la mise en oeuvre d’une philosophie politique, sa pratique relève du rituel. Elle vise à façonner le lien social sur la base du « corps » individuel d’un sujet supposément autonome. Le retour de la torture « après » le nazisme confronte ainsi à la manière dont se définissent respectivement l’individu, la personne, et le sujet. J’ai écrit ce livre pour problématiser la réduction de la personne à l’individu, en rabattant leur identité sur la catégorie abstraite de sujet, ainsi que l’individualisme qui en découle et qui ne laisse au sujet social agressé par l’économisme dominant d’autre alternative que de se « blinder », en s’anesthésiant.
3 – Pourriez-vous revenir en quelques lignes sur les enjeux d’une définition de la torture, les frontières qu’elle trace entre ce qui constitue ou non un acte de torture et envers qui ?
En 2006, s’autorisant de la lutte « globale » contre la terreur, le Congrès américain adopte le « Military Commission Act ». Également dite « Torture Law », cette loi limite la torture à une douleur infligée « d’une intensité équivalente à celle dont s’accompagne une blessure physique grave, de l’ordre de la défaillance organique », autrement dit à un traitement physique éprouvé comme mortel. Deux ans plus tard, Georges Bush fait éclater ce cadre juridique et l’élargit en autorisant le waterboarding, une torture qui en simulant la noyade et l’épreuve de la mort. Il est d’ailleurs suivi, en 2010, par le Gouvernement canadien, toujours dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Outrepassant la définition de la torture comme « traitement cruel, inhumain et dégradant » posée par la Convention de Genève en 1949, et limitant la torture à l’intensité de la douleur infligée, le pouvoir américain opère subrepticement un double déplacement. Il reconfigure à la fois l’entité « individu » à partir de l’évaluation quantifiable de la douleur et, partant, réduit à l’expérience de « ma vie » face à « ma mort » le lien supposé unir les atomes sociaux ainsi normés : il pose les bases du contrat social indépendamment du lien vital qu’il élabore. Étendant la sphère biopolitique à l’expérience, à travers la simulation de l’expérience, ce pouvoir et ceux qui s’en inspirent proposent, à partir de l’exceptionnalité supposée de la torture infligée au terroriste, un modèle inédit du « nous ». Pour saisir les enjeux philosophiques et esthétiques de ce design nouveau de l’humain, il convient de se tourner du côté de l’expérience réelle de ceux qui, torturés et aujourd’hui « médiatiquement » torturés, au vu et au su de « tous », laissent à pressentir que la sphère vitale ne coïncide pas avec le cadre de la vie dite individuelle, pas davantage qu’aux bornes de consciences insensibilisés par le soft power des images. Face au constat qu’il est possible de perdre la vie sans pour autant mourir, et qu’à cette vie distincte de la survie, les catégories morales de cruauté, d’inhumanité et de dégradation offrent un abri peu sûr, il s’agit, effectivement, de redéfinir la torture. Cette redéfinition doit procéder, à mon sens, d’une analyse renouvelée de la solidarité d’espèce qui réinscrirait l’humain au défaut de l’Homme. Cela suppose une confrontation rigoureuse avec les idéaux qui ont érigé, dans notre culture, le mythe d’un sujet a priori autonome et émancipé tout en, dans une autre prise en compte de ce qui nous donne corps ensemble, fait du corps en acte de chaque « un » la seule expression possible de ce « nous ».
Entretien © Catherine Perret & Hélène Clemente – Illustrations © DR
(Paris, avril 2014)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.