JEAN-CHRISTIAN BOURCART s’entretient avec ISABELLE ROZENBAUM à l’occasion de la publication de son récit, SINON LA MORT TE GAGNAIT (Le Point du Jour – Centre d’Art Éditeur, 2008), et de son travail photographique sur la ville de Camden (USA) :
1 – Jean-Christian, tu écris dans Sinon la mort te gagnait, que tu as toujours eu des « problèmes de mémoire, courte ou longue ». Tu expliques que c’est sans doute une des raisons qui t’a conduit vers la photographie, mais aussi vers l’écriture. En quoi photographier ou écrire t’aident-ils précisément à te souvenir ?
Par la trace matérielle qu’ils laissent et qui me permet de mes remémorer les instants ou les gens. Photo ou écriture ont pour moi la même fonction en fin de compte. Concernant la plupart des textes qui constituent Sinon la mort te gagnait, ils ont été écrits aux moments qu’ils relatent. C’est donc un recueil de photos et de textes anciens de moments vécus et non pas une reconstruction par le souvenir que j’aurais pu en avoir et qui n’aurait jamais pu donner ce résultat puisque, précisément, je n’ai aucune mémoire… Je ne peux me souvenir que parce que des traces matérielles étaient conservées.
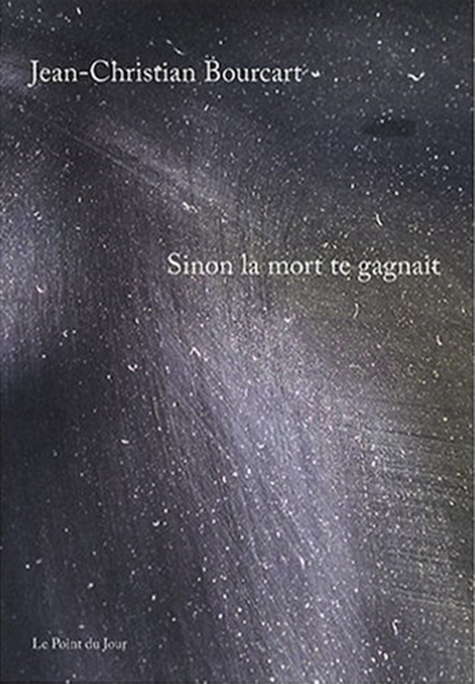
2 – Plus que de séries, on pourrait parler de cycles dans tes photos, on y découvre une confrontation au temps, soit à cause de l’urgence du travail, comme dans Forbidden City, soit d’une certaine lenteur, comme dans Camden, où tu reviens à intervalles plus ou moins longs sur les lieux de tes photos qui deviennent de véritables tournages. Quel rapport entretiens-tu au temps et à sa traduction en photographie, en film et en écrit ?
Malgré l’urgence qui en ressort, Forbidden City a été réalisé sur deux ans. Je m’y consacrais en effet de temps en temps. Je crée ainsi toujours un peu sur le même rythme : j’ai ma vie, mon travail et ensuite, il y a des petites périodes de temps possibles pour me consacrer à cet « ailleurs ». De la sorte, ce sont des périodes condensées et très espacées. La photographie comme l’écriture ou la vidéo offrent cette possibilité de revisiter un lieu dans des temps espacés sans que cela se voie. C’est presque magique…
3 – La photographie semble apparaître chez toi plus que comme un simple moyen d’expression, mais bien comme un moyen thérapeutique qui t’aide à vivre. Est-ce la raison qui fait que l’on sent dans ton travail une certaine urgence comme s’il fallait aller le plus vite possible avant que la mort ne te gagne précisément ? Comment vis-tu cette urgence ?
Je ne sais pas si je me soigne ou si j’assouvis des pulsions scopophiliques. Nos pulsions nous aident-elles à vivre ? La photographie, à la base, est un truc de voyeur. Ce qui m’intéresse d’un projet à un autre, c’est de faire varier cette position de voyeur et de comprendre comment ça peut impliquer à chaque fois différemment le spectateur. Mais, ce n’est pas tant le fait que je sois voyeur qui me motive que celui d’être exhibitionniste par rapport au spectateur. Il y a ainsi une sorte de dialectique triangulaire entre moi qui photographie des personnes, ces mêmes personnes qui sont photographiées et les autres qui regardent les photographies. Enfin, ce sont des trucs classiques de la photographie mais, chez moi, disons que c’est quelque chose de plus spécifique dans le sens où j’assume la position de celui qui regarde ce qu’il n’est pas supposé regarder et de donner à voir ce qui n’est pas supposé être vu. Parfois, ma présence comme « voyeur » est très évidente comme dans Traffic. Parfois, elle est cachée comme dans Forbidden City où je circule comme une ombre.

4 – Dans Videhole, tu nous montres des images pornographiques en intercalant, de temps à autres, des images de crânes. Quels rapports entretiennent le sexe et la mort dans cette vidéo ?
C’est évidemment le hole sexuel mais aussi le trouble de la vision, la limite de la perception. Cette vidéo a donc été faite d’accumulation d’images pornographiques montées à grande vitesse. Ce sont des images trouvées sur le Web mais pas seulement. Il y a aussi des publicités Coca-Cola et mon propre œil à plusieurs reprises. Cette vidéo a été réalisée pour être projetée sur grand écran avec un son très fort. C’est une sorte de vidéo hallucinogène. L’énergie sexuelle exubérante est une sorte de lutte perdue contre l’angoisse de la mort. Cela me paraît évident de les lier : la pornographie en tant qu’exubérance de la libido est l’autre face de l’instinct de mort.
5 – Dans la vidéo Bardo, tu passes – également à grande vitesse – des portraits et autoportraits de toi comme si tu repassais le fil de ta vie au moment de ta mort. Alors même que tu as échappé à la mort plusieurs fois, tu sembles ne cesser d’y penser au point d’avoir écrit ton dernier livre comme des sortes de « Mémoires ». Tu es déçu d’être encore en vie ?
Non, pas du tout mais je peux considérer la mort comme étant quelque chose de pas si flippant. J’ai un copain médecin en soins palliatifs qui me disait que les paysans et les gens proches de la nature mourraient de façon plus paisible que les citadins, juste parce qu’ils ont intégré la mort comme un prolongement naturel de leur vie. D’ailleurs, c’est amusant, je viens de réaliser que c’est la seule personne qui a acquis ce film (il est aussi collectionneur…).

6 – Tu es parti en Bosnie en 1993 en pleine guerre tourner avec une équipe un film de fiction, Elvis. Tu souhaitais raconter « une histoire si proche du réel qu’un frisson de vérité devait l’animer ». Les risques devaient être énormes, non ?
Non, ils n’étaient pas énormes. Ils étaient infimes par rapport aux Bosniaques qui vivaient un cauchemar meurtrier depuis déjà deux ans dans une trappe qui était gardée par l’ONU. Nous, on était presque comme des touristes. On pouvait s’en aller quand on en avait assez.
7 – Combien de temps à l’avance te prépares-tu dans le cas de la réalisation de projets comme Forbidden City, Madones infertiles, Elvis ou aujourd’hui pour Camden ? Quels sont les problèmes qui se posent à toi ? Qu’est-ce que tu n’arrives jamais à résoudre ou à réussir ?
Je suis plus conscient de ce qui se joue entre éthique et esthétique. Je deale avec ces questions-là. Dans les bordels, je ne m’inquiétais pas de la manière dont je représentais les gens. À Camden, c’est différent. Cet endroit est stigmatisé par sa pauvreté. Je me suis donc posé la question de quoi montrer et de comment le montrer. Eugene Richards, qui a fait un travail marquant dans les années 80 sur une banlieue de Philadelphie lorsqu’il y a eu la vague de crack, en a publié en 1994 un livre impressionnant, Cocaïne true, cocaïne blue. Son travail est classique, en noir et blanc, avec des photos grand angle mais c’est très « spectaculaire ». Il a fait ça pour faire prendre conscience et dénoncer la situation que vivaient ces gens-là mais, en fin de compte, ce travail a aussi été utilisé pour justifier le durcissement des lois antidrogue. Eugene Richards s’est révolté contre cette récupération. Mais à la fois, son style dramatique pouvait aboutir à ça. En même temps, mon travail s’inscrit souvent dans la provocation et le choc visuel. Je devais donc saisir une sorte d’efficacité spécifique et subtile. Je me trouvais ainsi dans toutes ces ambiguïtés-là et je ne savais pas comment les dénouer. Je me suis dit alors que la solution était peut-être dans le « faire », que le sujet s’imposerait de lui-même. Maintenant que le travail est exposé à Arles, on va voir comment les gens réagissent et si j’ai trouvé une façon de « faire » qui, à la fois, raconte une réalité passablement dramatique mais sans pathos et sans misérabilisme. Mon style, ici, c’est presque de la photo d’amateur, parfois très banale, sans effet. C’est comme si j’avais dû désapprendre des pratiques photographiques plus manipulatrices. Le processus de mise en forme a pris plus de temps que la récolte du matériau brut elle-même. Je savais qu’il fallait être fin et ce n’est pas forcément ma spécialité… Choisir un endroit considéré comme « le plus dangereux » du pays, c’est forcément de la provoc ! Et ça renvoie aux pratiques des photoreporters, héros des temps modernes, qui sautent d’une révolution à un tremblement de terre. Ainsi, je pourrai facilement passer pour un fouille-merde qui se la joue. Ce que je suis aussi… Il y a toutes les raisons pour douter de mes motivations. La seule chance de rédemption, c’est ce qui est montré, la forme même du travail : quatre-vingt photos de différents formats sont exposées avec des textes extraits de mon journal là-bas ainsi qu’une vidéo de vingt minutes diffusée sur trois écrans. C’est donc l’occasion de passer un peu de temps avec ces gens… Si le public reste et regarde toute l’exposition, j’aurai réussi mon pari d’arriver à retenir l’attention sans devoir utiliser la corde du sensationnalisme ou du spectaculaire. Et puis, pour la suite, tout est ouvert… Collateral, qui a été un travail impulsif que je n’ai pas montré sinon sur mon site, a reçu 14.000 connections en un mois parce qu’un blog très populaire l’avait mentionné. Aujourd’hui, dans le monde de prolifération médiatique dans lequel nous vivons, c’est comme si on lançait des bouteilles à la mer : ces bouteilles ont des chances de se démultiplier et de suivre leur propre chemin. Ce sont des déclinaisons. Il n’y a pas une seule facette. Selon les supports, ça se transforme. C’est précisément ma vision du réel : quelque chose de kaléidoscopique. On peut regarder de tous les côtés, il y a toujours à voir. C’est comme si on était (et oui, à D-Fiction, vous y participez !) en train de fabriquer un hologramme de Camden qui aurait une ressemblance à l’original mais qui ne serait évidemment pas l’original. De toute façon, l’original de Camden n’existe pas. Il n’existerait que si l’on parvenait à réunir ensemble tout ce que les humains savent de et sur Camden.

8 – Tu es passé par différentes activités et métiers avant de t’engager définitivement dans la photographie en effectuant notamment des photos pour des mariages et des reportages pour la presse. Qu’est-ce qui t’a fait sentir que la photographie était ta voie ?
À vrai dire, je me suis orienté moi-même… J’ai choisi une voie technique pensant que j’allais faire plaisir à mon père alors que ce qui m’intéressait, c’était la philo. Il faudrait donc parler davantage de la tension à me situer dans le monde des adultes et notamment de mon père que d’un échec en tant que tel. Quant au choix de faire de la photo, c’est parce que ça m’est apparu comme une activité magique, cette histoire du noir avec la lumière rouge. C’était lié aussi à l’érotisme, à la sensualité. Et puis, pouvoir arrêter l’instant, c’était étrange et puissant. La génération baba-cool, c’est-à-dire les copains de ma grande sœur faisaient de la photo. Ils faisaient des nus de leurs copines. Ils avaient leur propre labo. Cela m’a inspiré.
9 – Penses-tu que ta formation d’autodidacte y soit pour quelque chose dans le choix de tes sujets ? À quel point, ton parcours a-t-il influencé ta manière de photographier ?
Tout ça, c’est un peu mystérieux. J’aime bien ce que dit Marcel Duchamp : l’artiste ne sait pas ce qu’il fait. Je crois que le meilleur de notre créativité, c’est ce qui nous échappe. Ce que j’ai remarqué, c’est que pour qu’un sujet m’accroche, ça se joue à trois niveaux : l’intime, le privé et le public ou encore : le psychologique, l’artistique et le politique.
10 – Tu as une démarche d’auteur et, en parallèle, tu réponds à des commandes institutionnelles ou privées. Est-ce facile de concilier les deux ? Cela te pose-t-il des problèmes parfois lorsque tu passes d’une démarche à l’autre ?
Parfois, c’est un peu la schizophrénie… Mais le travail professionnel, en ce moment, ne me prend pas trop de temps (vive la crise !). Et quand je suis dans le professionnel, le travail personnel est de côté. Et puis, je suis excellent pour sauter du coq à l’âne. J’arrive à me déconnecter assez vite d’un sujet pour passer à l’autre ou bien, même, à faire plusieurs choses en même temps. Là où il faut faire attention, quand il y a beaucoup de travail professionnel, c’est au risque de vision déformée. Il est difficile de perdre les habitudes de cadres dont on n’a pas toujours conscience. Depuis longtemps, je me force à me « déstyliser » afin de parvenir à quelque chose de plus simple, de plus direct, de plus réel et qui me permette une certaine naïveté, une sincérité. À Camden, le plus simple pour moi, était d’avoir un petit sac et un boîtier numérique.

11 – En plus de la photographie, tu t’es tourné ces dernières années vers la vidéo. En quoi ce médium te plaît-il ? Qu’est-ce qu’il permet de faire que ne permet pas la photo ? Que complète-t-il dans ta démarche de photographe ?
C’est intéressant par rapport à Camden puisque, dans ce travail, il y a les deux médiums. Avec la vidéo, les gens sont tout à coup plus présents, plus vivants, plus humains. Ce ne sont pas juste des images. Ils expliquent leur vie, leurs problèmes. Ils nous interpellent. Ils sont davantage incarnés parce qu’il y a leur voix, parce qu’ils peuvent rire ou pleurer. Ils sont plus touchés, plus touchants. On s’aperçoit ainsi que ce ne sont pas de gros cons qui n’auraient rien à raconter. La vidéo, c’est d’un niveau plus complexe, mais c’est aussi plus réaliste. Ce qu’offre la photographie est plus de l’ordre du symbolique.
12 – Tes photographies ont souvent en commun une dimension presque anti-photographique qui les fait ressembler à des extraits de film. Il n’y a pas vraiment de pose, tu photographies en quelque sorte le mouvement en mouvement. En revanche, plusieurs de tes films sont comme des suites de photographies. Peux-tu nous parler de cet échange de médium ?
Normalement, il y a une continuité. Il n’y a pas vraiment de raison que ces deux médiums soient séparés. On sait que le cinéma est constitué de photos à une certaine vitesse. Tout dépend combien de temps on s’arrête sur chaque image. Et quand on regarde une exposition, on se fait également un film : on choisit la vitesse du défilement et on bouche les trous nous-mêmes. Il y a en effet toujours des trous entre les images qu’on nous propose et on les remplit de choses qui nous appartiennent. Dans la vidéo, je travaille aussi beaucoup le son ce que ne permettent pas les photos… La photographie est un art muet. Et d’ailleurs, je pense souvent que les photographes ne peuvent pas parler. Ce n’est pas toujours vrai mais j’ai cette impression que faire de la photographie, c’est un moyen d’exprimer ce qu’on n’arrive pas à dire avec des mots.

13 – Tu pousses assez loin l’association des différents médiums que tu utilises. Dans Collateral, par exemple, tu as projeté avec un vidéo projecteur des images de la guerre en Irak que tu as trouvées sur Internet sur les murs d’habitation d’américains – et même à l’intérieur de celles-ci ou sur des voitures. Ensuite, tu as photographié ces projections pour en faire des images à part entière. Ce travail s’est donc fait en plusieurs étapes et les photos qui le représentent sont finalement, on peut dire, le résultat d’installations, au sens plastique du terme. Comment t’est venue l’idée d’un tel travail et pourquoi ?
J’étais en vacances dans l’État de New York et il y avait plein de voitures avec des stickers « Support Our Troups » et ça m’a énervé. J’ai d’abord voulu prendre des photos de victimes en Irak – des gosses notamment à tués sous les bombes et en faire des stickers pour aller les coller la nuit à côté des stickers officiels. L’idée me plaisait beaucoup de penser que quelqu’un puisse reprendre sa voiture le matin avec un tel autocollant qui représente un enfant déchiqueté. J’imaginais le mal avec lequel la personne essayerait de gratter cet autocollant pour le faire disparaître alors même qu’elle laisserait l’autre à côté. Mais, je ne l’ai pas fait. Pas assez de courage. Dès que l’on touche à la bagnole d’un américain, on risque de se prendre un coup de fusil. Et puis, j’avais déjà eu quelques emmerdes avec les Fédéraux. Pour autant, à l’instar de Camden lorsque j’ai tapé sur le Web « ville la plus dangereuse », j’ai tapé « enfants morts Irak », histoire de voir ce qui me serait proposé. Il y a toujours un moment dans mes idées où je me dois de passer un cap, que ce soit à Sarajevo lorsque j’ai poussé la porte de la morgue, que ce soit dans les bordels ou les clubs échangistes à Francfort ou à New York, etc. Là, il a fallu que je tape sur mon clavier « enfants morts Irak ». J’ai dû travailler à partir de fichiers de très basse définition. Il y a donc eu un processus de régénération de ces documents : d’abord, imprimer au mieux les documents, ensuite, les photographier en diapo et, enfin, les agrandir de manière gigantesque en les projetant sur les maisons. Il y a une sorte d’alchimie de prendre un petit truc de rien du tout avec une qualité d’information minimum pour en faire quelque chose de monumental.

14 – Comme toute création, l’image n’a d’existence qu’à partir du moment où elle est produite et vue, c’est-à-dire en fonction de ses modes de production et de diffusion. Comment articules-tu ces différents médiums que tu utilises (vidéo, photo, écriture) avec les modes de diffusion qui sont les tiens pour les faire connaître (galeries, institutions, presse, éditions, Internet, etc.) ?
Je ne m’occupe pas trop de savoir où et comment mon travail sera montré. Une fois fini, le projet commence sa vie publique par lui-même. Je l’accompagne en saisissant les opportunités qui se présentent. Une fois que j’ai bouclé un projet, je passe à autre chose. Je suis un « commenceur » mais pas un « finisseur ». J’essaie de plus en plus de faire attention au sens donné au travail par la façon de le présenter. Mais souvent, les personnes avec qui je travaille ont une meilleure vision que moi de ce qui doit être fait. Mais le détournement ne me gêne pas. En fait, je ne me fais aucune illusion. J’ai suffisamment travaillé dans la presse et dans la communication pour savoir comment on formate une ‘histoire’ en fonction d’un support. Les interprétations du réel sont multiples, infinies. Ce qui me semble intéressant, c’est de décortiquer un petit peu les phénomènes de représentation, quels qu’ils soient. Je me confronte autant avec le ‘comment ça marche ?’ qu’avec le contenu lui-même.
15 – Les images que tu montres dans Collateral, Forbidden City, Madones infertiles ou Camden incarnent-elles un art engagé ou un art transgressif permettant, par la suite, une prise de conscience qui engagerait le spectateur socialement d’une manière ou d’une autre ? Quelle différence opères-tu entre la transgression et l’engagement dans ta démarche artistique ?
Je crois que je suis plus engagé en tant que personne humaine qu’en tant qu’artiste. Je ne me considère pas comme un « artiste ». Je n’ai pas besoin de cette étiquette. Je préfère celle de « travailleur culturel ». Si je peux apparaître parfois comme artiste, c’est plutôt dans la manière dont je mène ma vie. La seule chose que je sais, c’est que du bon art a toujours un élément transgressif. Ce qui m’intéresse, c’est de faire des propositions/provocations et d’avoir des gens comme vous, à D-Fiction, qui arrivent avec des tas de questions et que l’on puisse réfléchir ensemble. Je me sens plutôt comme un passeur qui va dans des endroits spécifiques et qui en ramène des traces, des indices que je donne à voir. Mon premier engagement est de l’ordre de pouvoir mener la vie que je veux de façon assez égoïste. Mais, à la fois, je suis bouddhiste et je m’engage régulièrement à faire passer les autres avant moi…

16 – Toutes les populations auxquelles tu t’intéresses semblent prises dans un faisceau de préjugés effarants créés par les sciences humaines comme la sociologie et l’anthropologie. Ces disciplines ont réduit les habitants des mondes populaires à n’être que des cobayes de théories fumeuses où rien de vivant ne se passe. Comment la photographie – et la tienne en particulier – permet-elle de saisir justement ce caractère inaliénable de la personnalité d’un « pauvre », d’une « pute », d’un « client » ?
Si on arrive à montrer des instants « vrais » de vie comme j’espère l’avoir fait dans la vidéo sur Camden, on comprend bien que ce sont des gens qui sont comme nous. En ce sens, c’est pourquoi ils nous touchent tant. C’est sans doute parce que je n’y suis pas allé bardé de connaissances et de théories sociologiques, historiques, économiques, etc., que j’ai pu rester dans une position d’ouverture, de compréhension et de réceptivité à ce qui allait se présenter. En gros, c’est la position de flâneur qui m’a permis de ne pas avoir de préjugés ou d’idées préconçues sur ce que j’allais trouver. À la fois, je crois que la photographie a cette capacité fascinante à toujours nous en raconter plus que ce que nous voulons y voir. Les études scientifiques des corps en mouvement de Muybridge ont eu une influence fantastique sur la peinture du 20e siècle, des Futuristes jusqu’à Francis Bacon. Dans une perspective plus politique, on peut se questionner à quel point la science – les sciences sociales dans ce cas – est au service du pouvoir et incarne des outils de domination. Mais, j’ose espérer qu’il y a toujours quelque chose qui ne peut se laisser manipuler ou quantifier par la science des hommes. C’est ma matière de base, ce qui échappe.
17 – Un peu comme les « genres » sociaux, la photographie est souvent classée par genre : reportage, photographie plasticienne, etc. La plupart de tes travaux échappent à ce type de cloisonnement, par exemple Forbidden City est à la fois esthétique et documentaire. Parle-nous de ces brouillages du discours esthétique et de quelle manière celui-ci rejoint le brouillage des discours sociaux ?
Je suis dans le réel. Je vais quelque part et je vois ce qui s’y passe. Ensuite, la retranscription est toujours une sorte de fictionalisation. En même temps, je suis en train de préparer le tournage d’une fiction qui à beaucoup à voir avec le monde des neurosciences. Ce qui m’intéresse, c’est ce qu’il y a « entre » les genres photographiques ou catégories esthétiques. Il y a beaucoup d’espace « entre » : « entre », c’est déjà un au-delà.
18 – Peux-tu nous expliquer comment ton travail permet une analyse profonde (presque dans le sens d’une psychanalyse) de cette société ?
Je suis effectivement intéressé par les marges et les aspects de la société qui sont moins visibles, par ce qui est caché, clos, souterrain, trop fugace pour une perception normale. Ce sont des sujets qui touchent intrinsèquement ce que je suis, ce que j’ai vécu. Et puis, j’ai fait quinze ans de psychothérapie, ça doit bien influencer ma perception du monde. Mais, je ne pense pas faire trop d’analyses. Je suis plutôt du côté de l’analogie, de l’évocation que de la logique.

19 – Les mondes dans lesquels tu t’immisces sont essentiellement des mondes violents, dangereux, dont la représentation est généralement interdite, redoutée ou, dans le cas de ton travail entre Canal Street et Broadway, fugace car impossible à retenir à cause de la rapidité de la circulation précisément. Qu’espères-tu en te confrontant à cette violence, à cet interdit ou à cette rapidité ? Que représentent-ils pour toi ? Prendre une photo n’est-il pas non plus lui-même un acte violent ?
Je suis particulièrement intéressé par ce qui se cache derrière le masque social. Je vais voir sous le tapis, derrière le décor parce qu’il y a là une « vérité » qui retient mon attention. C’est un peu comme les pelures d’oignons : la couche des apparences sociales, le visage que l’on veut bien se donner, les habits sous lesquels on se présente et puis, il y a la sphère privée et, plus à l’intérieur encore, ce qui est de l’ordre de l’intime. D’autre part, je crois qu’il y a une grande violence faite aux individus par le sociétal. Mais on n’y peut pas grand-chose. C’est le prix à payer pour les aspects positifs qui viennent avec le fait de vivre en société. L’humain est un animal dompté. J’essaie de le montrer aussi. C’est là où il peut y avoir violence, à arracher des images à la conformité. La conformité se défend.
20 – Pourquoi montrer l’horreur du monde sous des apparences de « beauté » afin que la dénonciation qui en est faite puisse opérer ? Faire preuve d’une certaine séduction esthétique pour montrer l’injustice ou l’insoutenable ne déforme-t-elle pas l’intention, voire le message ? L’ambivalence des images, entre le beau et l’horreur, permet-elle mieux de regarder en face la réalité ?
Qui disait que l’horreur est le dernier stade du sublime ? Je n’ai pas de réponse. Elles sont au cœur de la problématique de la représentation. Je vous renvoie à Hegel, Sade, Artaud, Bataille, etc. Dès qu’il y a représentation, il y a une opération de séduction, non ? Et puis, sous certaines conditions, on est séduit par l’horreur. Mais avant cela, il y a le monde réel, présenté, qui n’a pas besoin de nos images pour être horrible et sublime. À un niveau plus personnel – et comme beaucoup de gens – j’ai envie d’être aimé et je cherche à ce que mon travail puisse retenir le regard « aimant » d’autrui afin de pouvoir entrer en communication avec lui. Ainsi, je ne dis pas : « Là, devant, c’est le monde tel qu’il est ». Je dis : « Ce que vous voyez là est une de mes modalités de relation au monde. Est-ce qu’on peut échanger à partir de ça ? Êtes-vous intéressé par ce regard ? ».

21 – Dans Sinon la mort te gagnait, tu as franchi le pas de l’écriture et ton livre se révèle être celui d’un véritable écrivain. Du premier au dernier mot de l’ouvrage, nous sommes plongés dans le récit de ton existence et de ton parcours à travers une écriture minimaliste et puissante tout à la fois qui retient le lecteur qui en ressort abasourdi, presque exsangue. Qu’est-ce qui t’a amené à l’écriture ? T’exprimer par ce médium te permet-t-il d’aller plus loin qu’avec l’image ? Pourquoi ?
Merci pour les compliments mais je n’ai pas de prétention d’écrivain. Ce n’est pas parce que j’ai écrit un livre que je me positionne dans le champ de la littérature. C’est justement ce type de cloisonnement que je refuse. C’est un peu comme les gens qui veulent jouer la comédie. Soit on prend quelqu’un qui n’a aucun intérêt à ça et il sera parfait parce qu’il n’y a pas d’enjeu pour lui. Soit, on prend de très bons acteurs. Entre les deux, en revanche, c’est terrible. Je peux donc écrire parce que je n’écris pas comme un écrivain qui essaie d’écrire. Et, peut-être, les gens sont-ils touchés parce qu’il y a une sorte de vérité qui apparaît. En fait, c’est une compilation de textes écris à des moments de ma vie parce que j’en avais besoin. Ensuite, c’est plus un travail avec les éditeurs du Point du Jour. Il est apparu que ça pouvait tenir mais ça aurait pu ne pas tenir du tout. Je n’en savais rien jusqu’à ce que l’on conçoive l’ouvrage. Je suis une sorte d’aventurier : j’aime juste faire des choses que je ne sais pas faire, sinon, je m’emmerde. Mais après, je n’ai pas de prétentions précises. Je n’ai donc pas vraiment de recul par rapport à ce que je fais. Ça rejoint un peu ce que disait Marcel Duchamp : « L’artiste ne sait pas ce qu’il fait ». Donc, j’essaie de conserver une sorte d’instinct. Sinon la mort te gagnait, je l’ai porté pendant des années. Je porte toujours les choses très longtemps. Quand j’ai commencé à en parler aux éditeurs, je n’avais qu’un tas de pages éparses. Depuis le début des années 90, j’avais ce sentiment qu’il y avait quelque chose à raconter. Ça a pris tout ce temps. Si on prend encore cette analogie de la pelure d’oignon, et bien voilà, c’est une pelure d’enlevée. Et puis, c’était une confrontation à moi-même, à cette intimité que je traque chez les autres et que j’ai voulu examiner chez moi également. Les gens que je parviens à toucher avec ce livre, ce sont ceux qui ont à voir avec ces mêmes douleurs. Donc, ce que je raconte là n’est plus à moi mais c’est ce que nous avons en commun.
22 – De nos jours, plus personne ne fait le lien entre une image de film hollywoodien, un jeu vidéo ou un reportage en direct. Pourquoi d’après toi ? Qui est responsable d’une telle situation ? Sommes-nous devenus « aveugles » ?
On construit le journal TV, le jeu vidéo, la fiction du soir, ou le roman à succès suivant des critères extrêmement bien définis qui formatent et conforment notre appréhension de la vie qui nous entoure. Mais jamais personne, au bout du compte, ne s’y exprime vraiment. Les gens, ce qu’ils ont à raconter, ça ne se passe pas là. À la fois, c’est tout de même étonnant de voir qu’il y tant de monde dans les musées. Cela veut dire que ce n’est pas perdu mais il y a une véritable lutte qui s’est instaurée et ce combat contre l’uniformisation de la conscience collective me semble valable.

23 – Si nous nous concentrons sur ton travail à Camden, en quoi tes photos sont-elles plus proches de la réalité que de la fiction ? Si elles possèdent une part de fiction, laquelle est-ce ?
La réalité, ça n’existe pas. C’est une construction culturelle, sociologique et physiologique. Le réel, ce sont nos yeux, nos oreilles, nos sens, notre cerveau, etc. Si nous enlevons les sens, que devient alors le réel ? Si nous gardons nos sens, mais ôtons notre faculté de conceptualisation, que reste-il aussi ? D’ailleurs, qu’est-ce que la fiction ? La dualité, pour moi, ce n’est pas entre « réel » et « fiction ». C’est vraiment entre « réel » et « illusion ». Notre réelle expérience de la réalité, c’est une illusion…
Entretien © Jean-Christian Bourcart & Isabelle Rozenbaum – Photographies © J.-C. Bourcart – Vidéo © Isabelle Rozenbaum – Illustrations © DR
(Brooklyn, juin-déc 2009)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.