
PATRICE JEAN s’entretient avec nous à l’occasion de la publication de son roman, LA POURSUITE DE L’IDÉAL (Gallimard, 2021) :
1 – Patrice, vous publiez La Poursuite de l’idéal, un véritable bildungsroman qui met en scène, sur quelques 500 pages, les années de formation et le parcours professionnel de Cyrille Bertrand. La vingtaine, originaire de Dourdan, ce jeune homme est le fils d’un plombier et d’une prof d’espagnol. Il vient d’achever ses études supérieures à Paris (licencié en Lettres et diplômé de gestion). Et bien qu’il ne possède pas de fortune personnelle, il a l’ambition d’une « vie de poésie, d’aventure et de luxe » à la manière d’un Valery Larbaud. Or, comme tout un chacun issu de la classe moyenne « laborieuse », il connaît plutôt le chômage, les déboires, les galères, et ne trouve à être « employé » que dans le service contentieux de Salons&Cuisines et aux rayons d’un CarrefourMarket. Exposez-nous vos objectifs et les enjeux de ce sixième roman qui fait suite à deux précédents (L’Homme surnuméraire et Tour d’ivoire), dont le sujet portait également sur la place de la littérature dans la société contemporaine ainsi que sur sa relative déchéance et décomposition sociale. Pourquoi vouloir traiter encore de ce sujet, particulièrement sous l’angle de la poésie – genre s’il en est généralement perçu comme élitiste, hermétique, voire passéiste et ennuyeux ? En quoi la poésie vous paraît-elle être une forme et un genre significatifs pour illustrer l’état de la littérature dans le monde actuel ? Vous paraît-elle aussi importante pour l’écrivain que la maîtrise de la perspective pour le peintre, du solfège pour le musicien, ou du grec pour le philosophe ? D’après vous, la poésie est-elle une connaissance préalable de la langue, à savoir une « culture » incontournable pour qui se targuerait de vouloir faire « vœu » d’écriture aujourd’hui ?
Aucune idée préalable ne préside à l’écriture d’un roman (du moins pour moi). Le roman naît d’une sorte d’excitation, mêlant des personnages, des souvenirs, une vision. Mon unique objectif, au départ, est de créer un « beau roman ». C’est à la fois très et très peu ambitieux. Cette fois, j’ai eu l’idée d’écrire un roman d’apprentissage, en songeant à Stendhal ou Flaubert. C’était amusant de reprendre une forme déjà toute prête. Un bildungsroman, aujourd’hui, ne peut pas ressembler, par définition, à ceux qu’on écrivait au 19e siècle. En prêtant au personnage principal l’ambition d’être un poète reconnu, vivant de son art, je le place dans une situation d’inconfort très grand. Le déséquilibre est à l’origine de tous mes romans, un déséquilibre intérieur, un mal-être. Mais ce malaise dépasse le personnage : la poésie, aujourd’hui, n’a plus de place dans la société, ou une place marginale, en cela elle préfigure peut-être l’avenir de la littérature (au sens plein du terme), c’est pourquoi il est plus intéressant que Cyrille veuille devenir poète plutôt que romancier. Un romancier peut encore imaginer qu’il rencontrera le succès et vivra de sa plume. Un poète, jamais. Je pense qu’il est illusoire (au moins très difficile) de se consacrer à la littérature sans se poser la question de la place qu’elle occupe dans la société, de sa survie. Auparavant (jusque dans les années soixante ou soixante-dix ?), les écrivains s’affirmaient en s’opposant à leurs prédécesseurs, en ralliant l’avant-garde littéraire (ou en la raillant), dans une course (dérisoire) à la pureté, à la provocation, au mieux-que-les-autres. Qui ne voit que la course est terminée ? Aujourd’hui, il faut s’interroger, je crois, sur la possibilité même d’une littérature menacée par le divertissement universel, par d’autres formes de récit (les séries, par exemple) et par les sciences sociales (qui prétendent en dire plus que le roman sur les hommes). Certes, on peut se boucher les oreilles, se mettre des œillères, et écrire en se moquant orgueilleusement des dangers. Je n’ai pas cette superbe. En outre, écrire sans se préoccuper de cette triste situation équivaudrait à écrire un roman contemporain sans SMS mais des lettres, sans automobile mais des fiacres, sans télévision, sans internet, etc. Ce serait écrire un roman kitsch. Si le roman, contrairement à la poésie, a encore une place sur les présentoirs, c’est qu’il accroche le lecteur par l’histoire. Or la poésie ne raconte pas d’histoires, ou alors des bouts d’histoires, des moments, des impressions. La poésie, en ce sens, est une forme pure de la littérature. Le social (autrement dit la vie collective) est moins son affaire que celle du roman. Plus proche aussi de la musique, elle n’offre pas la satisfaction du sens. Ce sens, les lecteurs aiment le chercher dans les essais (qu’il soient historiques, économiques, sociologiques, etc.), parfois dans les romans. De nombreux lecteurs veulent des idées prêtes à servir pour frimer dans des copies, des dîners en ville ou sur Facebook. Mais je ne pense pas que la pratique de la poésie soit un préalable à quiconque aimerait construire une œuvre littéraire. Il suffit de citer des écrivains comme Flaubert, Proust ou Céline qui, à ma connaissance, n’ont pas commencé leur carrière par la poésie, pour conclure que cette dernière n’est pas « incontournable ». En revanche, je considère qu’un romancier qui ne connaîtrait pas les grands poètes se priverait d’une source originaire.
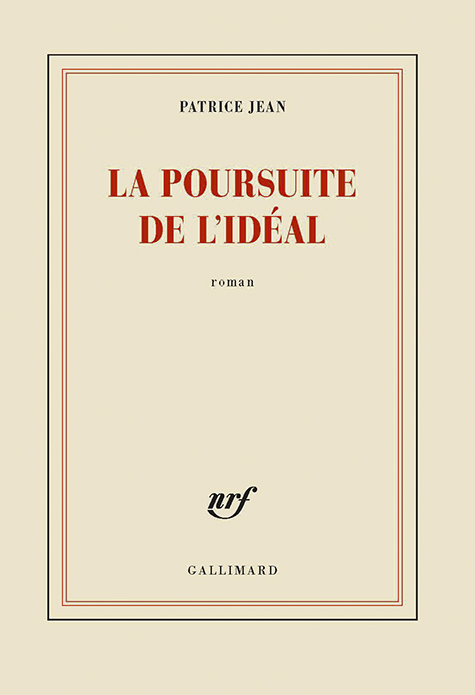
2 – Cyrille Bertrand – « notre héros », comme vous le surnommez – genre de Fabrice Del Dongo Sorel revu au déterminisme du 21e siècle, finira toutefois par se faire un peu d’entregent et parviendra à s’insérer dans le milieu « culturel » où, aux côtés d’un attaché au ministère de la Culture, il se lancera dans l’aventure d’un musée de la littérature, avant de parvenir à vivre de son écriture comme… scénariste d’une série télévisée au succès mondial ! Ayant donc finalement réussi médiatiquement comme matériellement, il n’en sera pas moins rongé par les tourments de cette nouvelle situation qui l’éloigne davantage encore de son rêve : celui de vivre en esthète et de devenir un poète digne de ce nom. On sent bien que vous avez voulu pousser à l’extrême l’antinomie entre littérature et télévision, c’est-à-dire entre art et entertainment, mais aussi entre pensée et bien-pensance, entre engagement et compromission, entre critique et marketing, entre liberté et politically correctness, entre individualité et conformité, entre être et avoir… Ainsi, ce que vous décrivez de la société contemporaine est sans appel tant du point de vue de ses utopies déchues que du point de vue de son système coercitif, voire même – dans nos démocraties dites « libérales » – de son omnipotence capitalistique. Bref, c’est No Future à tous les étages et pour tout le monde ou presque : la famille, le gauchisme culturel, le progrès, les thèses de doctorat, la liberté d’expression, l’école, le consumérisme, les bobos, la Normandie, les minorités, les anglo-saxons, les Chinois, etc. Mais n’est-ce pas, finalement, une vision si pessimiste et si systématiquement stylisée qu’elle risque de perdre son objet ? Ne serait-ce pas mieux de dépasser cette réalité triviale de la société (qui a toujours fonctionné de tous temps ainsi), pour capter plutôt ce réel propre à chacun, et notamment propre à la littérature et à ce qu’elle permet de dépasser quand on se projette dans l’œuvre à écrire, peu importe le système en cours, les polémiques du moment, les événements, l’actualité, etc. qui, au regard de l’espace et du temps, n’existent pas ? L’essentiel n’est-il par « ailleurs » finalement ?
Voulez-vous dire que ma critique, à force d’être critique, n’aurait plus d’objet ? Il me semble que Cyrille, justement, cherche à « capter » ce réel « propre à chacun », un réel qui soit en dehors de la trivialité. Je conteste, par ailleurs, votre lecture sur deux points : d’abord, le No Future. La Poursuite de l’idéal fait l’éloge de la littérature, de la poésie, de la nuit, de l’amitié, de l’amour (malgré les échecs), de la musique, du christianisme, de la solitude, de l’Italie, de Naples, de Stendhal, de la fidélité, de la mauvaise humeur, de la paternité, et même des selfies. Sans être un roman de l’approbation, ce n’est pas un roman nihiliste. Deuxième point : je ne vois pas ce que serait « l’ailleurs ». Tous les grands romans parlent du présent. L’Éducation sentimentale de la génération de 1848 (et de la Révolution), La Recherche de la Première Guerre mondiale et de l’affaire Dreyfus. Encore une fois, un roman qui ne parlerait pas du présent court le risque du kitsch. Évidemment, il y a Kafka pour me contredire. Ou bien Éric Chevillard. Leur génie les porte dans cet « ailleurs », et je conçois qu’on préfère Kafka à Flaubert. Le roman, par un côté, est lié à l’éphémère de l’actualité ; de l’autre côté, à l’immuable de la condition humaine. Et pour citer le poète des Fleurs du mal : « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable ». Quant à proposer un « nouvel horizon aux lecteurs », j’y vois une ambition plus religieuse, ou politique, que littéraire.
3 – « Ne pas échouer, se dit-il, qu’est-ce que c’est ? Si des images de mendiants, dans le métro, dans les rues, sous des couvertures, lui donnent une peinture concrète de la défaite, il se demande à partir de quel métier, de quel salaire, de quelle fortune et de quelle vie, tout bonnement, on outrepasse l’échec » : cette question est obsédante chez votre personnage, mais qu’est-ce que vous imaginez vous-même de cette réussite ? Ce que l’on définit comme étant la « réussite » ou l’ « échec » d’une activité comme d’une œuvre soumise aux seules lois du marché est-il au fond encore pertinent au moment où la planète est à l’arrêt et que l’on sait combien ce système ne fonctionne absolument pas, sinon à coup de colonisations (peu importe de la part de qui), de spoliations, de dominations et de destructions ? Ne nous illusions-nous pas sur ce que sont la réussite et l’échec quand, toujours en littérature, on voit ce que sont réellement les « œuvres » considérées comme réussies et qui ne sont généralement reconnues ainsi que par corruptions médiatique et capitalistique avant tout ? Si l’on en reste à la littérature française exclusivement, il suffit de se replonger dans n’importe quel roman encensé par la presse et mise en avant sur les étals – à peu près de n’importe quelle époque jusqu’à aujourd’hui – pour avoir tout de suite envie d’aller faire autre chose, ou bien précisément de lire tout sauf de la littérature… française (à quelques exceptions près). Comment expliquez-vous ce sentiment, ce ressenti, cet ennui profond que procure notre littérature contemporaine qui – entre fictions autocentrées, consensuelles, formatées, où toute « langue » a été évacuée et fictions sociétales hypocrites, gnangnans, victimaires, où toute véritable question « philosophique » est absente – ne cesse de nous prouver que nous pouvons lui préférer sans regrets n’importe quelle autre littérature, même chinoise (par exemple l’œuvre profondément dérangeante de Liu Cixin), ou encore italienne (par exemple les romans corrosifs de Luther Blissett, dit encore « Wu Ming »), et évidemment anglo-saxonne, encore et toujours… Finalement, comment avoir toujours des écrivains importants, une littérature dynamique et des œuvres novatrices si le pays reste chloroformé dans le patrimonial jusqu’au cou, et s’il se sclérose dès que la vie le chagrine ou lui donne à voir autrement le monde ? En fait, comment avoir encore le souhait de devenir « poète » si on ne réinvente pas intégralement la poésie et si l’on ne cherche pas à découvrir, à comprendre et à accompagner ce dont est porteur le monde actuel et qui n’est pas que négatif et moche ?
La question de l’échec et de la réussite tourmente le personnage parce qu’il a vingt-trois ans au début du roman : à cet âge, il est normal de s’interroger sur les voies à emprunter. Il ne faut pas oublier que Cyrille n’est pas l’auteur, lequel a trente ans de plus que son personnage. Je me suis souvenu de ces questions qui m’obsédaient, plus jeune, au moment de choisir un chemin. Il me semble, au contraire, que le « système » fonctionne très bien (même si, en ce moment, il est à l’arrêt, ou au ralenti), et même qu’il fonctionne trop bien. Cyrille va prendre conscience que la réussite d’une vie n’est pas (ou pas forcément) dans la réussite matérielle ni dans la reconnaissance. C’est un point primordial pour moi. On a souvent reproché à mes personnages d’être des « perdants », en m’opposant, implicitement, des réussites qui, à mes yeux, n’en sont pas. Cyrille choisit un chemin escarpé qui ne mène peut-être nulle part, mais qui, au moins, n’abolit pas la conscience d’exister, ni ne l’aliène aux bêtises du jour (lesquelles comprennent, justement, ces œuvres que vous dites « reconnues par corruption médiatique et capitalistique »). – Je ne partage pas, vous le savez, votre point de vue négatif à propos de la littérature française contemporaine. Certes, on encense souvent de mauvais livres, les librairies sont pleines de romans ineptes, mais existent aussi des livres très réussis, d’une grande exigence esthétique. Quand j’entre chez un libraire, je me dis que je pourrais ressortir avec, sous le bras, une dizaine d’ouvrages d’auteurs français ; et je suis certain de passer à côté de grands romans par ignorance, par frivolité. Je ne vais pas me livrer au petit jeu des noms, ce serait amusant mais stérile. Les critiques sur la littérature contemporaine ont toujours existé. Thomas Hobbes, dans le Léviathan, avait déjà pointé les motifs de ce rejet : « La compétition dans la poursuite des éloges incline à révérer l’antiquité : car on rivalise avec les vivants, non avec les morts ; à ceux-ci, on attribue plus que leur dû, afin de pouvoir mieux obscurcir la gloire de ceux-là » (De l’homme, chapitre XI). J’ajouterai que le critique, dans le même état d’esprit, encensera les écrivains d’autres pays, lesquels ne participent pas de la même « compétition » que les écrivains français. Certains lecteurs passent leur vie à se moquer des écrivains du présent, en faisant l’éloge de ceux du passé. Ils seraient mieux inspirés de découvrir ce qu’il y a de grand dans leur époque, dans leur pays : le nihilisme n’est pas, vous le voyez, de mon côté, ni l’idée qu’il n’y aurait que du « négatif et du moche » en notre triste temps. Si le pays est chloroformé dans le passé, ce n’est pas mon fait : je pourrais citer une vingtaine d’écrivains contemporains passionnant. À mon sens, l’unique noblesse de la critique tient à sa capacité de distinguer dans la masse des publications celles qui sortent du lot. Tout dénigrer ou tout encenser sont deux attitudes égales en ce qu’elles refusent de discriminer. Célébrer Tolstoï ou Faulkner est à la portée de n’importe qui. Dire que toute la littérature française ne vaut rien est d’une facilité déconcertante. La difficulté commence lorsqu’il faut juger vraiment, sans tout rejeter, ni se réfugier dans les gloires déjà reconnues. La question du jugement est essentielle : la culture industrielle promeut ce qui réussit, ce qui rapporte de l’argent, de sorte que les éditeurs et les critiques finiront par confondre un roman qui se vend avec un grand livre : la valeur d’échange primera la valeur esthétique. Les critères d’appréciation ne sont plus décidés par des amateurs et des lettrés, mais par le chiffre d’affaire. Aucun livre d’Yves Bonnefoy, m’a-t-on dit, n’a dépassé les cinq mille exemplaires. Les merveilleux recueils de Jean-Pierre Georges n’ont peut-être pas plus de deux cents lecteurs. Et pourtant ce sont eux, à l’aune littéraire, qui comptent. Une société qui n’attend plus rien de ses grands écrivains condamnent ceux-ci à disparaître, de la même façon que les disquaires se sont évanouis avec le triomphe du numérique (et un peu avant des CD). S’il reste des lecteurs, de vrais lecteurs, des amoureux, des fervents amateurs de la littérature, s’il en reste en nombre, alors elle ne périra pas, elle survivra ; sinon, comme les anciens dieux, Neptune, Junon, Mercure ou Vesta, elle ne sera plus l’objet d’aucun culte, les hommes de l’avenir en parleront comme d’une curiosité révolue et semi-barbare.
4 – Expliquez-nous quelle est votre propre position en tant qu’écrivain dans un monde semblable – à défaut d’identique – à celui de votre personnage, et étonnez-nous donc par quelques confessions croustillantes et autres déclarations fracassantes sur votre situation d’écrivain tout de même publié et reconnu qui peut élaborer l’œuvre qu’il entend comme il l’entend. Et ne nous dites pas que vous êtes un de ces écrivains mal compris, mal aimé, malheureusement récupéré par certains dont vous n’aviez pas même imaginé qu’ils s’intéresseraient à votre œuvre, tandis que les autres – ceux précisément qui devraient vous lire absolument et vous inviter à leurs tribunes, à la manière dont ils s’empressent de le faire avec un Houellebecq – vous honniraient sans même vous avoir vraiment lu… Si tel est le cas, expliquez-nous quelles en sont les raisons, et en quoi cela vous paraît finalement logique. Et expliquez-nous aussi en quoi vous seriez un épigone houellebecquien… Ne seriez-vous pas plutôt un disciple contrarié (ou pas d’ailleurs) de Philippe Muray ? Mais là aussi, n’est-ce pas un peu vite dit et caricatural ? Quels sont vos « modèles » et quel est votre projet littéraire au bout du compte : être un littérateur antimoderne, un fictionnaire naturaliste, un romancier du quotidien, un romantique postmoderne, un nouveau Stendhal, la vie mouvementée en moins, mais quand même, un nouveau Stendhal, non ? Mais Cyrille Bertrand plairait-il à Julien Sorel ?
Je n’ai malheureusement rien de croustillant à raconter, ni même, je le crains, de déclarations fracassantes à révéler. Mes romans sont publiés mais pas tous : un de mes romans (sur L’Éducation nationale) a été refusé par trois éditeurs. Quand je propose un recueil d’aphorismes à une maison d’édition, je vois bien que cela ne l’intéresse pas. J’ai cependant le projet de réunir, un jour, dans un seul volume, des articles publiés dans diverses revues. J’ai même écrit une pièce de théâtre (La Résurrection d’André) que personne n’a lue. Le roman est totalitaire. Il n’y a que lui pour pousser les portes des maisons d’édition. Tous les écrivains sont mal compris. J’ai l’impression que je ne serai jamais complètement compris, et c’est heureux car je me dis, après chaque roman : « Il faut que j’enfonce le clou, que je recommence. » J’écris des livres pour ceux qui les aimeront : « Ceux qui savent me devinent, et pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas me comprendre, j’amoncellerais sans fruit les explications » (Baudelaire). Pour l’heure (et peut-être pour toujours), la presse de gauche (en grande partie) boude mes romans, alors que la droite leur fait bon accueil. Je suis très content, évidemment, d’être soutenu par de grands critiques de droite, mais je regrette que ceux de gauche n’en disent rien : le font-ils par simple ignorance de mon existence, ou par une négligence assumée ? Un de mes amis, étonné que je puisse m’interroger à ce sujet, m’a dit : « C’est normal que Le Monde ou L’Obs ne chronique pas La Poursuite, tu te moques de ses lecteurs. » C’est injuste : je me moque de tout le monde, droite comprise. Mon idée est que les progressistes ne peuvent se permettre de perdre du temps avec des écrivains qui ne sont pas totalement de leur camp, ces critiques sont des militants. Et c’est injuste pour une autre raison : la littérature, pour moi, est au-dessus de toutes les idéologies. La politique est une chose seconde, d’un intérêt spirituel subalterne. Je pourrais dire, comme Kafka, que je déteste tout ce qui n’est pas la littérature. – Je ne me sens pas du tout un épigone de Houellebecq ni un disciple de Muray. Ce sont deux auteurs que j’ai lus et que j’aime beaucoup. Mais ils ne représentent, à eux deux, peut-être même pas 1 % de mes lectures. L’esprit humain rapporte toujours l’inconnu au connu, c’est un réflexe de défense, ancré dans notre psyché. C’est pourquoi des lecteurs, par paresse, par réflexe, rapprochent mes romans de ces deux écrivains. Il faut une comparaison, un casier, un tiroir. L’esprit classe, catégorise, épingle les écrivains sur un tableau de liège. Quand Flaubert a publié Madame Bovary, on a rapproché son œuvre de celle de Balzac, les Scènes de la vie de province. Je ne me compare pas, évidemment, à ces deux géants, mais je donne ce cas comme un exemple du phénomène. Schopenhauer est mon principal point d’accord avec Houellebecq ; et mon principal désaccord philosophique avec Muray (lequel se revendique d’Hegel). Houellebecq, de formation scientifique, se passionne pour la science-fiction, le clonage, le transhumanisme ; de mon côté, j’attire l’attention sur la disparition de la perception littéraire du monde au profit de la perception scientifique, disparition qui figure, pour moi, la catastrophe. Or, la littérature, c’est la voix de la sensibilité et de l’intelligence, la voix de la vie invisible, cette vie cachée derrière les apparences, la peau, les clichés. – S’il faut me coller à moi-même une étiquette (est-ce utile ?) je suis peut-être un « romantique antimoderne », au sens qu’a donné Antoine Compagnon à cette notion. Mes modèles ? Le terme conviendrait plus à Cyrille qu’à moi, mais allons-y : Montaigne, Pascal, Molière, Shakespeare, Voltaire, Sade, Chateaubriand, Balzac, Nerval, Leopardi, Poe, Baudelaire, Flaubert, Schopenhauer, Nietzsche, Proust, Pessoa, Valéry, Drieu, Woolf, Gombrowicz, Sartre, Aymé, Chestov, Pavese, Cioran, Bernhard, Kundera, Barnes, etc. – Julien Sorel, c’est certain, n’aimerait pas Cyrille Bertrand, et vice-versa. Je n’ambitionne pas d’être un nouveau Stendhal, outre la prétention d’un tel projet, je dois confesser n’être pas un stendhalien. Si j’aime bien Stendhal, je lui préfère Flaubert.
5 – Si votre roman permet une prise de conscience salutaire, serait-ce celle que la littérature ne peut rien, ou bien au contraire, qu’elle peut encore tout, notamment au regard de ce que Cyrille Bertrand décide en accomplissant finalement son « vœu » d’écriture ? Votre personnage, emporté par le cours de son existence et des contingences, parvient ainsi à dépasser ses angoisses et à prendre son destin en main. En ce sens, l’écriture représente pour lui une sorte de victoire sur ce qui lui a été infligé socialement, mais aussi la découverte que, dès que l’on prend une décision pour soi, les choses sont possibles. Pour autant, que peut la littérature face à ce désenchantement complet du monde qui l’obsède et le hante, sinon une simple échappée qui le ramènera à nouveau à cette réalité du monde actuel qu’il déteste ? D’après vous, Cyrille Bertrand malgré sa sincérité, ne se complait-il pas dans des fantasmes alimentés par des clichés eux-mêmes bien-pensants, consensuels et quasi contre-productifs, c’est-à-dire foncièrement « petit bourgeois » – tout comme les nostalgiques aiment rien tant que cette idée qu’ils se font d’un passé auquel ils n’ont jamais eu à se confronter ? Seriez-vous d’accord, in fine, de dire que Cyrille Bertrand est aussi à sa façon un anti-héros stendhalien ?
La littérature agit lentement, progressivement. Sa force est très grande, mais elle ne peut changer le monde. Encore une fois, Cyrille échappe au désenchantement par un « vœu » d’écriture (l’expression est bien trouvée). Il se sauve seul, sans volonté de sauver les autres (les sauveurs du monde sont déjà légion, inutile d’ajouter une unité supplémentaire à cette bande d’emmerdeurs). Cyrille n’a pas « la nostalgie d’un autre temps », il n’est pas non plus dans « la posture ». Quels sont les fantasmes et clichés « bien-pensants » et « petit-bourgeois » auxquels croit Cyrille ? Voulez-vous dire que l’amour de la littérature serait un cliché ? Une posture ? Un fantasme de petit-bourgeois nostalgique ? Cyrille n’est pas nostalgique. Il se révolte même contre la nostalgie. Il a vécu des moments (comme nous tous) qui l’ont transporté, des moments poétiques, que ce soit à Madère ou à Naples, il a compris qu’une existence, au-delà des œuvres, se mesurait à la somme de ces moments qu’un individu, au soir de sa vie, pouvait revendiquer. – Cyrille est un héros stendhalien par sa recherche du bonheur, par sa solitude. Mais il n’est pas un héros stendhalien par sa profonde mélancolie, par une réussite sociale qu’il rejette.
Entretien © Patrice Jean & D-Fiction – Illustrations © DR
(Guérande, avril 2021)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
