Érudit, virtuose, flâneur, subtil, brillant, les qualificatifs ne manquent pas pour tenter de cerner Gabriel Josipovici, écrivain inclassable et profond, inventif et envoûtant, qui occupe une place à part dans la littérature britannique contemporaine. L’auteur d’Hotel Andromeda (Quidam 2021) ne saurait être assimilé à quelque mouvement esthétique (qu’il soit réaliste, moderniste, ou postmoderniste), ni intégré à quelque groupe littéraire artificiellement formé. Né en 1940 de parents juifs russo-italiens romano-lévantins, il a déjà passé la quarantaine quand, en 1983, le magazine Granta décide de réunir les « meilleurs jeunes romanciers britanniques », parmi lesquels figurent Pat Barker, Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes, Salman Rushdie, William Boyd ou encore Kazuo Ishiguro. Mais ces auteurs célébrés et reconnus par l’institution et par le grand public ne constituent pas sa famille littéraire et les premières affinités de Gabriel Josipovici sont à chercher outre-Manche. C’est à Nice, puis à La Bourboule, que le jeune garçon passe son enfance pendant la guerre avant de partir vivre en Égypte, pays natal de sa mère, puis à l’adolescence de s’installer définitivement en Angleterre. C’est à cette période qu’il découvre À la recherche du temps perdu et la lecture de Proust lui donnera assez de confiance pour commencer à écrire dès l’âge de dix-sept ans. Quelques années plus tard, les ouvrages de Marguerite Duras, Claude Simon et Alain Robbe-Grillet bouleversent sa conception de la forme romanesque qu’il s’efforcera lui-même de renouveler dans ses futurs écrits. Au fil du temps, il s’adjoindra d’autres compagnons littéraires partout dans le monde : Franz Kafka, Thomas Mann, Samuel Beckett, Georges Perec, Aharon Appelfeld, Thomas Bernhard, Saul Bellow, parmi d’autres.
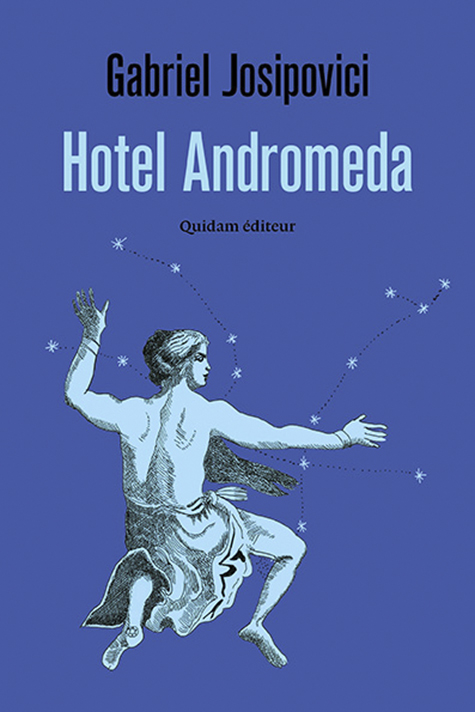
Depuis The Inventory, paru en 1968, il a publié dix-neuf romans dont Hotel Andromeda est l’avant-dernier à ce jour, sorti en Grande-Bretagne en 2014. Écrivain prolixe naviguant entre les genres, Gabriel Josipovici est aussi l’auteur de nouvelles, de pièces de théâtre et d’ouvrages de critique et théorie littéraire, portant en particulier sur le modernisme : The Lessons of Modernism (1977) et What Ever Happened to Modernism? (2010). En 2001, il consacre une biographie à sa mère, la poétesse et traductrice Sacha Rabinovitch avec laquelle il entretint une relation très forte, et quelque vingt années plus tard, publie un essai sur l’oubli, Forgetting. Le 22 mars 2020, jour de l’équinoxe de printemps et vingt-troisième anniversaire du décès de sa mère, il débute son journal du confinement qu’il intitule 100 Days et nomme un « alphabet de la mémoire ». Chaque jour, il y consigne des souvenirs autobiographiques et des réflexions sur la littérature, ses propres livres et le langage.
L’œuvre romanesque de Gabriel Josipovici, au style minimaliste et épuré, dépeint le quotidien de personnages dans leurs activités ordinaires (marcher, parler, penser, écrire, manger…) et transcrit leurs conversations sans fioritures ni effets. De façon subtile et détournée, elle aborde les tragédies de l’histoire mondiale (la Shoah dans Dans le jardin d’un hôtel [1993, Quidam 2017], la guerre en Tchétchénie dans Hotel Andromeda). Elle révèle aussi l’intérêt de l’auteur pour diverses formes artistiques en plus de la littérature : la musique dans Goldberg : Variations (2002, Quidam 2014) et Infini – l’histoire d’un moment (2012, Quidam 2016), la peinture dans The Air We Breathe (1981) autour de Claude Monet et Contre-jour: Tryptique d’après Pierre Bonnard (1984, Gallimard 1989), les arts visuels par le biais du portrait décalé du sculpteur américain Joseph Cornell que propose Hotel Andromeda. Plusieurs des romans de Josipovici traduits en français mettent en scène des artistes torturés par les affres de la création : dans Moo Pak (1994, Quidam 2011), un auteur déambule dans les parcs et rues de Londres, et tente d’expliquer à son ami son incapacité à écrire son magnum opus ; dans Hotel Andromeda, le personnage principal, Helena, ne cesse de s’interroger sur la manière dont elle devrait rédiger le livre qu’elle souhaite consacrer à la vie et l’œuvre de Cornell. Ces interrogations furent précisément celles de Josipovici qui, pendant des années, chercha en vain la forme adéquate pour écrire un ouvrage sur Cornell.
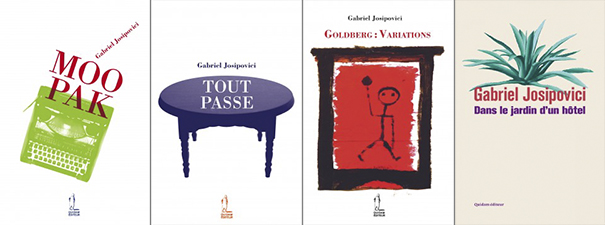
Hotel Andromeda fait coexister plusieurs espace-temps et plusieurs modes d’écriture. Dans une pièce exiguë de son appartement, Helena se débat intérieurement avec son texte sur Cornell dont elle propose de longs extraits au lecteur (transcrits en italiques) ; au sous-sol ou au dernier étage de l’immeuble (une forme de boîte à la Cornell), elle trouve refuge chez des voisins bienveillants à qui elle confie ses doutes sur son travail ; lorsqu’elle se promène à Hampstead Heath avec Ed, le photo-reporter tchèque qu’elle héberge parce qu’il a supposément connu sa sœur en Tchétchénie, elle cherche en vain à comprendre la situation terrible à Grozny et à trouver un sens à sa petite vie bourgeoise et confortable, loin de tout conflit. L’art poétique et insaisissable de Cornell, la guerre en Tchétchénie, la fragilité des rapports humains, autant de sujets qui se croisent dans un roman aux multiples entrées.
Hotel Andromeda est le deuxième roman de Gabriel Josipovici que j’ai eu le plaisir de traduire après Dans le jardin d’un hôtel en 2017. Une passion commune pour la littérature innovante de Grande-Bretagne avait conduit Pascal Arnaud de Quidam Éditeur et moi-même à nous retrouver, d’abord autour de l’œuvre de B.S. Johnson pour la traduction de la biographie que Jonathan Coe lui a consacrée, B.S. Johnson. Histoire d’un éléphant fougueux (2010), puis autour de celle de Gabriel Josipovici. Lire et traduire Hotel Andromeda, c’est accepter de se laisser surprendre par les changements de rythme, de registre et de style. Les dialogues dépouillés exigent de rester au plus près du texte, dans sa nudité élémentaire, afin de laisser poindre le sens et l’émotion qui naissent souvent des silences et des répétitions. Il importe de respecter les maladresses et hésitations du journaliste tchèque qui décrit dans un anglais fragile et trébuchant les désastres de la guerre. Les passages consacrés à Cornell, les extraits de ses lettres et journaux, et les interrogations du personnage principal sur sa propre activité d’écriture invitent à pénétrer à la fois l’esprit de l’artiste américain dont certaines notes demeurent cryptiques et celui de la critique d’art qui remet constamment en question sa démarche.

La traduction du roman devait s’accompagner d’une immersion prolongée dans la vie et l’œuvre de Cornell, à l’image de ce que fit Josipovici lui-même. L’auteur confia dans un entretien que l’image de l’artiste américain commença à le hanter après qu’il avait vu les photographies prises par Hans Namuth d’un Joseph Cornell âgé, assis dans son jardin et dans son bureau d’Utopia Parkway, clichés qu’Helena décrit dans le roman et qu’il me fut essentiel d’observer à mon tour. À ceci s’ajouta la lecture de la biographie de Deborah Solomons, Utopia Parkway: The Life and Work of Joseph Cornell (1998), qui avait permis à Josipovici de mieux percevoir les contradictions de l’artiste et l’avait encouragé à rédiger son roman. Pour mieux saisir la portée des passages consacrés aux œuvres de Cornell dans le roman, je scrutai le détail de ses collages, photomontages et boîtes dans l’ouvrage de Lynda Roscoe Hartigan, Joseph Cornell: Navigating the Imagination (2007) et dans le catalogue de l’exposition « Joseph Cornell et les Surréalistes à New York » présentée au Musée des Beaux-arts de Lyon en 2013-14. Remontant plus loin encore dans ses sources d’inspiration, je consultai avec bonheur les livres d’astronomie populaire du dix-neuvième siècle, en particulier ceux de Camille Flammarion, où Cornell découpa des images et constellations. Enfin, la lecture de Joseph Cornell’s Theater of the Mind: Selected Diaries, Letters, and Files, dirigé par Mary Ann Caws (1993), me permit de m’imprégner du style si particulier des journaux et lettres de cet artiste solitaire, contemplatif et désespéré. Car traduire Gabriel Josipovici, c’était aussi traduire Joseph Cornell, ses tourments couchés sur le papier autant que l’imagerie poétique de son art.
Texte © Vanessa Guignery – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
