Ce qu’on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir ou lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. (C. Baudelaire)
Il est temps d’abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard pour tenir à être raisonnable et instruit – ce qui a mené à une vie sans attrait. Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout autres ou de cesser d’être. (G. Bataille)
Disons le d’emblée, La Conjuration (Fayard, 2013) de Philippe Vasset, n’est pas un roman « traditionnel », estampillé « qualité française », comme les multiples sous-produits culturels qui envahissent chroniquement les tables des librairies. Aussi l’horizon d’attente de ceux qui le liront comme tel risque-t-il d’être déjoué, pour ne pas dire déçu.
Certes, Philippe Vasset fait une concession au réalisme romanesque à la française : un « héros » (le narrateur), une « diégèse » (la création d’une secte, et partant, la recherche du lieu – et de la formule), une « péripétie » (l’abandon du projet par le héros, qui décide de faire cavalier seul). On conçoit aisément ce que n’importe quel épigone de Michel Houellebecq aurait imaginé à partir de cette trame (au même titre, d’ailleurs, de ce qu’en auraient dit les commentateurs : « dérangeant », « subversif », etc.). à première vue, La Conjuration se présente donc exactement comme le prolongement romanesque d’Un Livre blanc (Fayard, 2007) – son pendant, au sens pictural du terme.
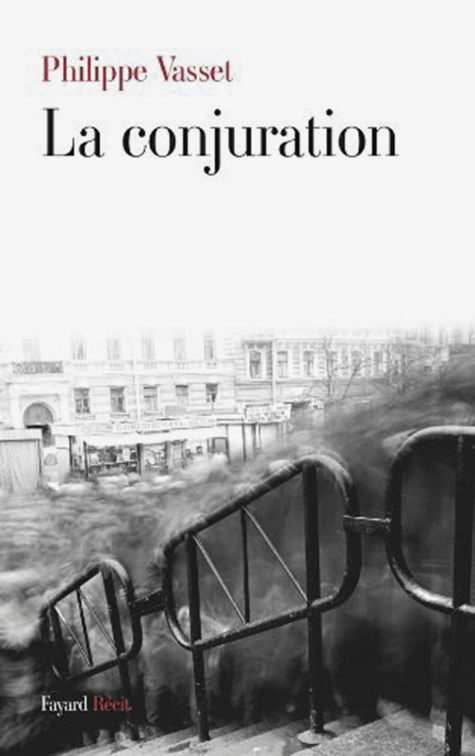
Au deux tiers du livre toutefois, Philippe Vasset donne congé à un schéma narratif in fine très convenu, délaisse les vieilles chaussures du roman français, dévoilant, dans une mise en abyme implicitement ironique, l’imposture, sinon l’échec de la démarche – celle du réalisme, comme celle de l’entreprise de son « héros ». Dans un passage extraordinaire, assis au centre d’un square du 13e arrondissement, après un moment de stase digne du fantastique métaphysique régnant dans les toiles de De Chirico, le narrateur prend conscience qu’il n’y aura de Salut que dans les entrailles de la ville. Le livre bascule alors dans une pure épiphanie poétique, celle des lieux en déshérence où l’on entre par effraction. Comme un passe-muraille, le personnage central du livre décide d’investir non plus les « zones blanches » (explorées dans Un Livre blanc), désormais livrées aux soutiers de « l’industrie de la conscience » (Hans Magnus Enzensberger), mais aux « zones noires », secrètes, opaques, espaces interstitiels qui sont autant d’angles morts de l’idéologie – territoires aveugles soustraits à nos regards.
Héritier de Gordon Matta-Clark, du Jean Echenoz de L’Occupation des sols, et bien sûr, de Georges Perec, par le regard de son héros, Philippe Vasset nous donne à voir la ville, pour ainsi dire, en « coupe sagittale » ; tel un mangeur de murailles digne de Serge Brussolo, son personnage central « ouvre » l’espace urbain, nous montre l’envers du décor, pour mieux s’y fondre ; la ville se retrouve ainsi retournée comme un gant. Dans l’anonymat nocturne des appartements vides, ou pleins du bruit de la respiration des dormeurs, dans ce monde couturé d’absences, au creux des ombres et des empreintes, toute une constellation d’objets intimes (extimes ?) révèlent alors au narrateur la potentialité émancipatrice d’un quotidien transmué en nuit intérieure, en esthétique de la disparition. Très vite, ce Fantômas des temps postmodernes comprend qu’il se doit d’épouser le silence des masses fantômes.
Par une sorte de boucle à la fois narrative et diégétique, notre monte-en-l’air renoue alors avec le projet initial : créer une secte, non plus une petite entreprise vulgairement commerciale, mais un groupuscule conjuratoire. La trame du livre s’inscrit dès lors dans une mythologie littéraire (Balzac, Hugo, Sue, Dumas, etc.) qui commence au 19e siècle, celle du souterrain parisien (égouts, catacombes) – lieu propice à toute les conjurations, véritable machinerie de la Comédie humaine -, et qui se poursuit avec la littérature de genre dans la première moitié du 20e siècle (Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain, Gustave Le Rouge, etc.) à laquelle Philippe Vasset rend hommage. Nul complot cependant, nul esprit de sacrifice, seul demeure un cortège éphémère fait d’hommes sans qualités, communauté inavouable de ceux qui n’ont pas de communauté -, nouveaux argonautes arpentant sans relâche le dedans de notre monde, dessinant la géographie de nos aliénations – qui hantent notre mauvais sommeil.
Société secrète, agglomérat d’individus disparate en interaction permanente, optant pour le ludique contre le policier, ces nomades urbains inventent non seulement une nouvelle forme de socialisation, mais surtout, renouent avec les temps anciens de la gnose : bénédictins échappés du cloître, le moindre angle mort de la ville – parkings, cages d’escaliers de secours, tunnels, balcons, terrasses, bureaux vides – se transforme en lieu de culte transitoire ; pour ces corps glorieux, chaque angle mort est ressuscité – si tant est que, comme nous l’apprend la théologie -, le propre de la résurrection consiste à surmonter l’opposition entre extérieur et intérieur, sujet qui connaît et objet connu. Plus de rite dans cette conjuration, tissée de la même matière que les rêves : débarrassée des ornements du cérémonial, celle-ci se conçoit in nuce comme une désorientation de nos regards, de nos routines et, paradoxe fécond -, « production » d’un espace fait de lignes brisées, de potentialités infinies, circumnaviguable, comme les océans ; réappropriation, enfin, dans le prisme de cette géométrie inversée, des traces, celles des singularités quelconques qui inscrivent leur identité au recto de l’enfer social. Nombreuses sont donc les brèches à ouvrir dans la cage de fer du capitalisme, multiples les « ressources invisibles d’un temps qui obéit à d’autres lois et qui, par surprise, dérobe quelque chose à la distribution propriétaire de l’espace » (Michel de Certeau).
Plus atopique qu’utopique, cette conjuration devient ainsi clairement politique, sans forcément être prescriptrice : toutes les barrières du contrôle social tombent, tous les obstacles « du règne cohérent de la misère » (Guy Debord) s’effacent : non-circulation, étanchéité, cloisonnements ; c’est depuis ce Passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps que se construisent politiquement et poétiquement les situations ; à la fin du livre, la précipitation des conjurés dans « l’infinie liberté de n’être personne », dépouillés d’eux-mêmes, délestés de toute prédication, fait office d’assomption existentielle et, la langue enfin, rédime le reste – le régime fiduciaire de tout ce qui précède (le réalisme, la secte) -, pour se faire poème, bruissement, s’abolir dans la rumeur du monde, présente à l’univers entier. Il se pourrait bien que La Conjuration soit le premier roman « situationniste » digne de ce nom.
Texte © Xavier Boissel – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
