L’Histoire est un puits sans fond bien que ce fond, aussi intouchable qu’improbable, semble n’en être finalement que la surface. C’est ainsi que se révèle à nos yeux le cinquième livre d’Olivier Benyahya : Frontières (Fayard, 2019). Ce roman, dont le déroulé est presque celui d’un conte « fantastique » à la Rabbi Nahman si cher à Kafka – dans le sens où cette littérature de l’interprétation amène, par son refus de la scénarisation intégrale, à s’interroger sur ce qu’est un texte littéraire et sur son rapport à la réalité – a ainsi tout d’un super X-Files, ces dossiers du FBI dont les affaires non classées étaient considérées, en leur temps, « aux frontières du réel ». L’importance du sujet exposé par l’auteur est digne d’une véritable enquête historique, philosophique et politique aux frontières, elle, de la paranoïa la plus troublante et explosive qui soit.
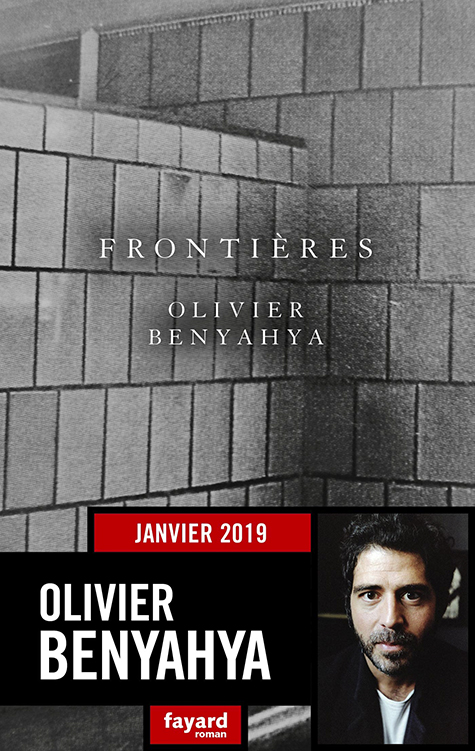
Voilà de quoi il s’agit : le narrateur – un éditeur d’une soixantaine d’année – est amené à revisiter son propre passé à la faveur d’un article qu’il a commandé à un jeune écrivain pour une revue dont il assure la direction. Rapatrié d’Algérie, devenu père sous les mandats de François Mitterrand, témoin de ce retour du refoulé antisémite au cœur même de la république avec l’attentat de la rue Copernic, observateur déchiré de ce retour de bâton des tensions israélo-palestiniennes et de la guerre du Liban avec l’attentat de la rue des Rosiers, l’homme a vu défiler le tout Paris comme le tout venant artistique et littéraire de l’époque, et fraie son chemin comme éditeur respectable et respecté, voulant par dessus tout, que ses auteurs aillent « au bout » de ce qu’il estime être leur « sujet ».
Partageant avec l’écrivain – dénommé « W » comme les agents doubles – cette conviction que l’écriture devait « être en prise avec la substance vitale » et « créer des brèches dans la manière d’habiter un sujet », il n’en attend ainsi pas moins de celui à qui il confie la tache ardue de rédiger un article fouillé sur le juge Richard J. Goldstone. Signataire du fameux rapport du même nom pour les Nations unies, qui menace l’état hébreu de « crime de guerre » après l’opération Plomb durci lancée en 2008 par l’armée israélienne dans la bande de Gaza, le juge remet soudain en question les conclusions initiales de son rapport, affirmant que s’il avait su à l’époque ce qu’il savait à présent, « le rapport aurait été un document différent ».
Nous sommes alors en 2011. Au-delà de « la guerre à Gaza, des responsabilités de chacun, des états d’âme d’un Juif par rapport aux actes d’Israël », ce revirement tardif du juge retient l’attention de l’éditeur du fait que, outre faire un « bon papier » pour sa revue, il représente surtout à ses yeux une « matière dont il est possible d’extraire des essences« , ce « truc » indicible qui permet de porter, sous la forme d’interrogations difficilement exprimables, un quelconque intérêt à ce qui se passe encore en ce bas monde. Donnant toute liberté à « W » d’évoquer comment « le rapport Goldstone avait pu être instrumentalisé par certains acteurs de la société française », l’écrivain démarre son enquête en « appréhendant l’intériorité du juge à la manière d’un objet de fiction », s’embarquant sur « une voie parallèle » en tirant des ficelles, puis des fils, et enfin – à l’ébahissement de l’éditeur lui-même – la pelote entière d’une toute autre histoire : celle de deux hommes du passé, de deux « fantômes » – Lazar et Gruner – qui ressurgissent de ces couloirs souterrains de la réalité historique que sont souvent ces « poubelles du monde », tel que les qualifie lui-même « W ».
Les faits n’étant jamais le fruit du hasard, l’éditeur a connu les deux individus pour les avoir rencontrer une trentaine d’années plus tôt, tout comme Lazar a lui-même connu Goldstone, tandis que Gruner a connu un autre homme dont il a été proche et qui fut son meilleur ami à Auschwitz durant leur déportation, et que l’on pourrait ici identifier comme le « Troisième Homme » de toute cette histoire qui hypnotise alors « W » au point qu’il semble « n’avoir plus prise » sur elle. Ce troisième homme en question, devenu célèbre grâce au livre qu’il écrivît sur la Shoah et qui le consacrât comme un écrivain comparable à Soljenitsyne, n’est pourtant pas l’homme que semble avoir si bien connu Gruner lorsqu’il le retrouve des années plus tard, colportant alors la folle rumeur que cet auteur mondialement connu n’a pas vécu ce qu’il affirme car il n’est simplement pas celui qu’il prétend être, alléguant ainsi que celui-ci a simplement usurpé l’identité de son ami, sans doute le véritable auteur de ce récit si célèbre de la Shoah.
C’est évidemment une rumeur problématique, très problématique, et c’est parce qu’elle est problématique qu’elle fascine sans doute « W », tout comme Olivier Benyahya pour qui elle est devenue cette « structure narrative globale », cette bête se nourrissant d’elle-même dont il a réussi à proposer, avec Frontières, un ouvrage dense, intense, presque foudroyant dans sa conception, porté par un souffle de liberté total et un désir de vie hors du commun, à la manière où « W », ce double parfait, brûlant de ce « désir d’échapper » toujours, est lui-même entièrement animé par « l’idée de renaissance ». En effet, sa lecture procure l’étrange sensation de traverser une nouvelle dimension de la réalité à l’instar de l’un de ces étonnants livres évoqués par l’éditeur :
Des personnages apparaissaient de manière abrupte, puis ils disparaissaient. Des personnages dont l’importance semblait pourtant première dans la chronologie. Et l’exposé de cette chronologie, la narration, faisant fi d’un principe de vraisemblance systématique, semblait elle-même embrasser une temporalité autre.
Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR
Ce compte rendu a fait l’objet d’une première publication sur le site du magazine Transfuge (mars 2020).
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
