Peut-être que si j’avais reçu le prix Pulitzer à l’âge de 73 ans (The Road, 2006), je me serais arrêté là. Il faut savoir ménager sa sortie. Partir sur un succès critique et public n’est pas donné à tout le monde. Les derniers livres de Norman Mailer étaient catastrophiques et entachent de manière rétrospective les chefs-d’œuvres de sa jeunesse. Ceux de Philip Roth, qui a pourtant eu la lucidité de se retirer à 80 ans, étaient tout de même dispensables et ne font que rabâcher ad nauseam des figures qu’il avait souvent développées par le passé : l’impuissance, le cancer, le vieux professeur d’université qui tombe amoureux de l’une de ses étudiantes, etc.
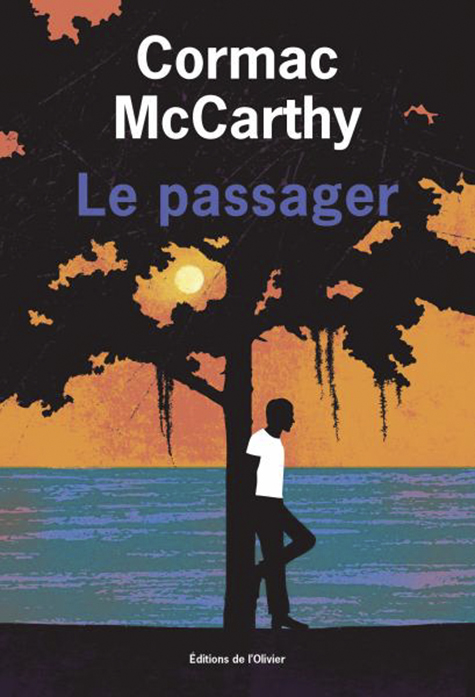
Cormac McCarthy a pourtant choisi de revenir après 17 ans de silence pour donner non pas un, mais deux livres qui vont paraître coup sur coup : Le Passager et Stella Maris (L’Olivier, mars & avril 2023). L’auteur a surtout connu la célébrité en France avec son dernier roman, éclipsant pour une majorité d’entre nous l’aspect gothique faulknérien de son œuvre antérieure au profit d’une aura postapocalyptique trompeuse. Il s’agit d’un malentendu. Le succès de l’adaptation cinématographique de La Route (2009) et de la série télévisée concomitante The Walking dead (2010) a sans doute contribué à ce quiproquo dans une atmosphère favorable aux cataclysmes et aux morts-vivants. En réalité, McCarthy a la réputation aux États-Unis d’utiliser un vocabulaire inusité depuis le 14e siècle et non de jouer à Mad Max dans le désert qu’il habite (El Paso). On m’accusera de critiquer un génie ayant bouleversé les lettres américaines durant un demi-siècle et ma seule légitimité est celle du lecteur assidu. Or, je suis aujourd’hui fort dépité devant cette publication inattendue et tardive (l’auteur aura 90 ans au mois de juillet). Dépité, car ces deux ouvrages laissent a posteriori un sentiment de désespoir et de confusion prégnants. On m’accusera d’un jeunisme mal venu (je n’ai plus l’âge), de tirer sur l’ambulance, de faire preuve d’une arrogance injustifiée, mais le fait est que la presse française aura sans doute du mal à critiquer le dernier opus de celui qu’elle a porté aux nues, qui plus est pour de mauvaises raisons.
Le Passager est un roman de 544 pages qui ne raconte pour ainsi dire rien. Le livre s’ouvre sur un dialogue de 20 pages entre deux personnages dont on ignore tout et dont l’un s’avérera plus tard être une hallucination. Après ce préambule décourageant, on se sent comme le trépassé qui pénètre dans l’Enfer de Dante et tombe sur cette inscription : « Toi qui entres ici, abandonne tout espoir ».

Bobby Western est un plongeur professionnel qui, en fouillant l’épave engloutie d’un avion, découvre que l’un des passagers est manquant aussi bien que la boîte noire. Une fois revenu sur la terre ferme, le FBI le soupçonne de détenir un secret, dont il ignore pourtant tout. Quoi qu’il en soit, ne vous attachez pas à cette intrigue qui est abandonnée par l’auteur au bout de 50 pages. De cet avion, de ce fameux « passager » qui donne son titre au livre et de son secret, vous ne saurez jamais rien. En réalité, McCarthy s’en fout. Le livre se concentre alors sur la longue errance du protagoniste qui était amoureux de sa sœur, une mathématicienne brillante et psychotique qui s’est suicidée. Le tout est interrompu de manière périodique par les dialogues que ladite sœur, Alicia, entretenait avec le mirage d’un nain handicapé qu’elle appelait le Kid Thalidomide.
De vastes quantités de personnages entrent et sortent de cette histoire comme des fantômes sans y laisser la moindre trace. Les longs dialogues qui s’en suivent sont consacrés au sens de la vie, ou plutôt à son absurdité qui cache une vaste somme d’horreurs indicibles (« without malefactors, the world of the righeous is robbed of all meaning », p. 142). Le père de Bobby et Alicia était un physicien qui travaillait à la construction de la première bombe atomique dans les années 40 à Los Alamos. Leur mère, quant à elle, était technicienne dans le laboratoire d’Oak Ridge, près de Knoxville, où on enrichissait l’uranium destiné à Little Boy. Le handicap du Kid imaginaire, dû à ce médicament prescrit aux femmes enceintes dans les années 50, aussi bien que le patronyme des deux personnages principaux et leur filiation semblent pointer du doigt de manière unanime la culpabilité de l’Occident dans la deuxième moitié du 20e siècle (« All of history is a reharsal for its own extinction », p. 369), la culpabilité de la science en général, la responsabilité des Européens après la Shoah et celle des Américains après Hiroshima (« A calamity can be erased by no amount of good. It can only be erased by a worse calamity », p. 370). Enfin, cette culpabilité s’incarne dans l’histoire d’amour incestueuse, maudite et impossible qui conduit au suicide de manière inévitable, le sud dégénéré des communautés calvinistes étant désormais entaché par le complexe militaro-industriel aussi bien que par la bigoterie et la ségrégation du passé.

Après tout, pourquoi pas ? Le problème est que McCarthy nous a déjà fait le coup. On revient finalement à Knoxville dans le Tennessee, là où se déroulait déjà l’intrigue de Sutree (1979). Le frère et la sœur étaient déjà amoureux l’un de l’autre dans Outer dark (1969) et le personnage principal s’appelait déjà le Kid dans All the pretty horses (1992), pour ne donner que quelques exemples. On a l’impression, page après page, d’assister à un long digest de l’œuvre entière de McCarthy par lui-même, les bouts d’un roman précédent étant collés à ceux d’un autre, jusqu’aux détails que l’auteur réutilise, je crois, et c’est ce qui est dramatique, sans s’en rendre compte. En outre, rien de tout cela n’a de sens, comme les bribes d’un discours qu’on aurait haché menu et remonté dans le désordre. Comment en vient-on à parler de transsexualité, des avantages mécaniques de la Maserati Bora ou, cerise sur le gâteau, de l’assassinat de Kennedy ? Je l’ignore. Le plus troublant est que ce n’est jamais vraiment ennuyeux ou mauvais. Il y a même beaucoup de réflexions passionnantes, disséminées çà et là, mais qui tombent le plus souvent comme un cheveu sur la soupe au détour d’une scène qui n’a rien à voir. Certes, la vie n’a pas de sens, mais il y a déjà eu Beckett pour le dire. Certes, la vie est absurde, mais faut-il que le roman qui dénonce cette absurdité le soit à son tour de façon mimétique ? Louis Jouvet disait : « Pour bien jouer un homme ivre, il faut être sobre comme un chameau ».
Enfin, il y a Stella Maris, présenté comme un codicille au roman et qui s’avère être, au fond, the real McCoy. Sauf que ça n’est pas un roman, mais une pièce de théâtre, soit 200 pages de dialogue ininterrompu et sans même une didascalie, entre Alicia Western et son psychiatre lors de son internement volontaire en 1972 dans une institution dont le nom donne son titre au livre. Le fait que cette histoire soit divisée en deux ouvrages distincts, que le premier soit littéralement insensé et que le deuxième ne soit pas un roman comme annoncé sur la couverture n’en finit pas de troubler le lecteur qui l’était pourtant déjà tout à fait. Or, je pense que ce deuxième volet du diptyque se suffit à lui-même, et si l’éditeur avait eu le courage de chahuter un vieux monsieur très talentueux et couvert de gloire, il aurait coupé à peu de chose près les 544 pages du prologue inutile et déroutant pour ne mettre en scène que les 200 suivantes avec Margot Robbie dans le rôle principal (on peut rêver…).

McCarthy réussit pourtant là quelque chose d’extraordinaire, car il fait parler un personnage féminin dont l’intelligence est censée dépasser la sienne et celle du lecteur (du moins, en ce qui me concerne). Or, ce défi à haut risque et presque impossible, est ici parfaitement relevé. Je pense au contre-exemple absolu qu’était La Déesse des petites victoires (Anne Carrière, 2012), premier roman de Yannick Grannec et dans lequel on assistait aux dialogues inconsistants et ridicules d’Albert Einstein et Kurt Gödel à Princeton dans les années quarante. Ils devisaient alors du temps qu’il fait ou des soucis de leurs femmes respectives devant un lecteur sidéré par tant de banalités. Comment faire parler des génies quand on ne l’est pas soi-même ? Comment montrer l’accélération de la pensée quand on fonctionne à vitesse normale et que son lecteur aussi ? Soit on leur fait énoncer des lieux communs, soit on les rend incompréhensibles. Mais, il faut croire que McCarthy avait la ruse et l’expérience pour réussir ce coup-là, car ces échanges au sujet de Wittgenstein, de l’inceste et des mathématiques sont passionnants tout en étant accessibles, ou tout du moins on a l’impression d’y comprendre quelque chose alors qu’on n’y comprend pas grand-chose, et c’est justement cette impression du lecteur, fruit d’une illusion sous-tendue par l’empathie de l’auteur qui rend le texte si attractif.
Alicia est fascinée par Gödel, qui est devenu fou. Il cessa de s’alimenter et pesait 29 kilos au moment de sa mort. Elle est fascinée par Grothendieck, qui lui aussi est devenu fou. Il abandonna les mathématiques après les avoir révolutionnées afin que ses recherches ne servent pas le secteur militaire. Dans ses mémoires, Récoltes et semailles (Gallimard, 2022), il écrivit, non pas des démonstrations, mais une recette du kimchi coréen en douze pages que j’ai personnellement tenté de mettre en pratique. Alicia, quant à elle, n’a pas beaucoup d’appétit et voit littéralement des nains partout. Cette réflexion métaphysique sur les mathématiques, leur existence préalable à toute chose ou la beauté de cette illusion, pourrait être aride, mais l’émotion affleure à chaque page et la certitude du suicide final qui n’apparaît pas dans ce livre, mais est évoqué dans l’autre (est-ce à cela qu’il sert ?), donne aux monologues d’Alicia, une coloration particulière (« The first rule of the world is that everything vanishes forever », p. 171).

La réalité est une illusion derrière laquelle se tapit le mal absolu et cette obsession hante toute l’œuvre de McCarthy. En fin de compte, ne serait-ce pas plutôt chez Lovecraft qu’il faille aller creuser pour lire ce dernier livre que dans les premières amours faulknériennes, l’auteur de The Road étant natif de Providence, Rhode Island, comme celui de L’Appel de Cthulhu ? (« Because I knew what my brother did not. That there is an ill-contained horror beneath the surface of the world, and there always had been”, p. 152).
Je me demande dans quelle mesure Stella Maris pourrait être une base théorique, une sorte d’axiome ou de théorème et The Passenger, sa mise en pratique, sa représentation graphique. Il faudrait alors lire les deux livres dans l’ordre inverse, sans suivre les préconisations de l’éditeur. Je me demande dans quelle mesure la représentation serait délibérément bancale afin de justifier une formule erronée qui ne mène qu’à la folie et la mort.

Il est intéressant de constater que McCarthy s’est intéressé sur le tard au génie mathématique qui est pourtant réputé comme le propre de la jeunesse. En effet, la médaille Fields, équivalent du prix Nobel pour les mathématiques, n’est remise qu’à des candidats de moins de 40 ans (Grothendieck la reçut d’ailleurs en 1968 à l’âge de 38 ans… Il était moins une !). Je m’interroge. Décidément, ce pays n’est pas pour le vieil homme. Ce testament littéraire en miroir est aussi et peut-être uniquement un jeu sur ce que l’on comprend et ce que l’on ne comprend pas, sachant que l’univers de McCarthy (et certainement le nôtre) se résume à une alternative très simple : soit il n’y a rien à comprendre, soit on n’y comprend rien :
– He read your thesis ?
– He read three different drafts of it, actually.
– Did he understand it ?
– Pretty much. He understood what was wrong with it.
– And that was ?
– That nobody could understand it. (p. 151)
Texte © Mikaël Hirsch – Illustrations © DR
My 2 cents est un workshop de lectures critiques in progress de Mikaël Hirsch.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
