Qu’un type singulier d’expérience d’écriture ne réponde pas à la production éditoriale, mais en somme, la fasse taire, la terrasse, c’est ce que je voudrais suggérer ici à propos de Mathias Richard.
Cela expliquera donc ceci : que la publication de chacun de ses opus passe inéluctablement à la trappe des recensements, comptes rendus, analyses et autres référencements journalistiques et médiatiques, structurant non plus ce bon vieux « champ littéraire » (concept bourdieusien appartenant à un monde sociologiquement dépassé), mais le « marché social », autre sorte de champ s’il en est : celui des followers et des likes, de l’artificialité et de la superficialité, de présentisme et de vortex temporel, bref le champ de toutes les névroses adverses, morbidesses et perverses conditionnées au pathos et aux déplorations de cette aire sidéral du vide.
Parmi les opus qui auraient pourtant dû soulever un minimum de curiosité de la part des critiques dont c’est le métier, comme de tous ces prétendus professionnels qui se pincent de savoir lire, déjà ce volume : Syn-t.ext [1].
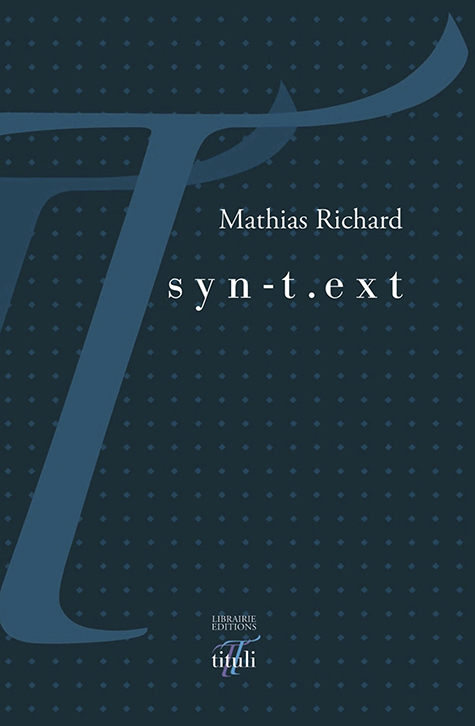
Tout est dans le titre, c’est-à-dire dans les mots, comme nous le montre si bien la langue des oiseaux. Ainsi, de ce célèbre psychanalyste rangeant Joyce parmi les Pères des « diologues » [2] – entre Moïse et Maître Eckhart – pour nous permettre de saisir toute la dimension du « Sinthome » [3] que le grantécrivain irlandais représentait. De la même manière, bien que plus expéditive au regard même des limites de ma contribution, je classerai Mathias Richard avec ces saints-écrivains que sont, entre autres [4], Antonin Artaud, Pierre Guyotat, Isidore Isou, Ezra Pound, Kathy Acker, ou encore chez les contemporains, Sylvain Courtoux, Thomas A. Ravier, Brice Bonfanti, Stéphane Sangral, Denis Ferdinande, ou bien James Sacré, qui forcent également le respect pour l’exigence de leur posture comme de leur geste artistique.
En effet, ces écrivains représentent la continuité d’un seul et même créateur, précisément ce fameux « Sinthome » incarnant l’émergence et la puissance d’une voix, à savoir celles d’une langue, c’est-à-dire au fond, celles d’une parole que Mathias Richard qualifie donc de « syntexte » [5] quand Isou, empreint de ce laughing out loud qu’il maîtrisait avant l’heure, le réalisait sous la forme d’un Traité de bave et d’éternité [6].
Peu importe, Sinthome et Syntexte, même combat, la Bave et l’Éternité, tout comme l’Ombilic et les Limbes leur étant constitutifs dans cette quête impossible, sinon absolue, de l’esprit et des mots, tel que le défend Artaud [7] et que le geste de Mathias Richard prolonge de façon si novatrice et juste :
Un syntexte est une manière de traiter les millions de fragments d’informations qui nous environnent. Il représente un point où la littérature s’effondre infiniment sur elle-même. […] Le travail poétique est un chemin qui peut nous mener à la connaissance de la réalité extérieure. [8]
Mais un autre opus de notre auteur aurait dû également retenir l’attention de bien des personnes qui, pourtant, sont passées outre : 2020, l’année où le cyberpunk a percé [9]. À commencer par les éditeurs [10] qui l’ont refusé lui préférant sans doute feelgood et junk books aussi mièvres qu’insignifiants – sans même parler de ces recueils de « poésie blanche », fades et ringards, que certaines grandes maisons publient très sérieusement – quand il s’agissait, devant un tel événement planétaire, de proposer des œuvres originales, subjectives, prospectives, à l’instar de cette « poéscience » (« science-poésie ») capable d’enrichir :
la palette des possibles en termes d’action et d’écriture créatives, en y diminuant la part de fiction, tout en y ajoutant une dimension réelle et performative produisant des « œuvres » comme des fichiers exécutables qui altèrent les pensées et les comportements, et en créent d’autres. [11]
Et de continuer avec ces experts impliqués à penser notre société à l’heure de ses crises globales, infernales, terminales sur lesquelles ils déblatèrent à longueur de tribunes fastidieuses et rébarbatives, quand ce livre de Mathias Richard donne à saisir un témoignage aussi fin intellectuellement et fort humainement qu’il en est bref et percutant.
Mais de compter aussi ces professionnels de la « culture » si prompts à réveiller les morts avec grandiloquence quand il s’agirait alors seulement de diffuser de façon concrète – auprès des plus jeunes comme des plus âgés, des plus passionnés comme des plus ignorants en la matière, mais qui ne demandent que de découvrir – une parole toujours en-vie, à savoir celle de la majorité des sur-vivants que sont devenus tous ceux qui, depuis cette crise sans fin du Covid, œuvrent pour l’Art en son nom, et non pour le Spectacle au nom de contenus standardisés proposés par des manifestations culturelles et autres festivités de saison tout aussi standardisées pour lesquelles – en l’état des lieux – nous n’avons plus ni goût de nous en réclamer, ni grâce de nous y intéresser, ni cœur de nous y rendre.

Enfin – et on y revient toujours – de ne pas oublier ces journalistes et critiques qui, dans la presque totalité des médias mainstream, ne défendent plus que ce dont précisément ils devraient se détourner à mesure que les réseaux sociaux les supplantent, à savoir de ce mouvement consumériste, de ce règne de la quantité, de cette vulgarité ambiantielle par lesquels leur fonction, leur influence, leur crédibilité s’édulcorent toujours plus.
Ainsi, dans cette présentation aussi troublante que poignante de son livre, Mathias Richard revient sur les motivations d’écriture de celui-ci comme de ses enjeux, indiquant qu’il est :
une réponse à l’impossibilité-annulation de presque tout dans de nombreuses vies, dont la mienne, depuis le premier confinement. Ce n’est pas un livre appartenant au genre de la science-fiction, mais des notes d’écriture rédigées à l’intérieur d’un monde (le nôtre) devenu ce qui, auparavant, a pu être qualifié de SF. La seule SF, ici, est celle du présent, un présent souvent dystopique, cauchemardesque, laissant l’humain sur le carreau. [12]
Mais si tous ces prétendus lecteurs professionnels que nous avons évoqués plus haut, ou bien alors si certains encore dotés d’une conscience quant à cette question de la voix, de la langue, de la parole, encore capables de sentir vibrer en eux la page, le temps, l’espace, le sinthome, le texte, le syntexte, à savoir l’espace de l’espace de l’écriture, si tous ceux-là, donc, devaient ne lire qu’un seul opus de Mathias Richard, ils devraient alors faire l’expérience totale, textuelle, vocale, performative, existentielle, de cette expérience À travers tout [13].
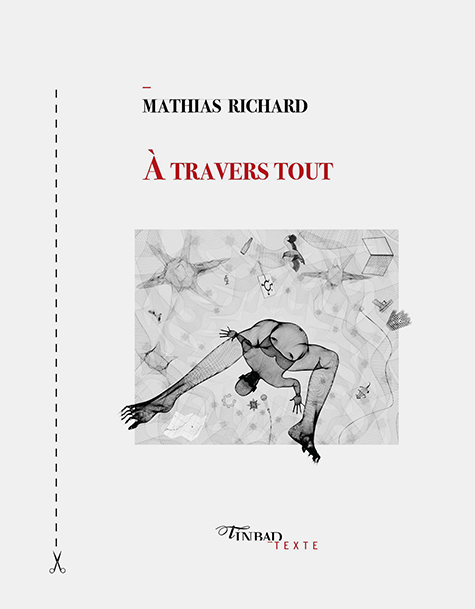
À travers tout est, en effet, le « grand œuvre » de Mathias Richard, tout à la fois livre-somme « Testament », et Livre des livres. Les textes qui le constituent en sont aussi éclatants et pénétrants qu’ils en sont autant de déchirures, de déchirements, de coups déchirants qui d’un coup de dés jamais n’abolira ces coups du hasard, que seules certaines œuvres peuvent produire parce qu’elles sont justement nécessaires, vivantes, urgentes. C’est grâce à leur pouvoir qu’il nous est possible de sortir de ce conditionnement de morts-vivants, de cette bien-pensance de petits-bourgeois, de cette zone de confort dépressive qui nous étouffent et nous écrasent, à la manière dont Kafka estime lui-même que « si le livre que nous lisons ne nous réveille pas d’un coup de point sur le crâne, à quoi bon le lire ? ».
Ainsi, au-delà de quelques échanges écrits avec Mathias Richard, je ne l’ai jamais rencontré ni même parlé de vive voix. Je n’ai jamais assisté à aucune de ses performances poétiques ou collaboré à aucun de ses projets artistiques. Je ne sais rien de lui, et le peu que je connais me fait dire que nous suivons des chemins d’écriture bien différents. Cependant, à chaque fois que je lis ses livres, et que j’ai l’occasion de m’y replonger comme aujourd’hui, je peux affirmer une chose : je l’entends en moi. J’entends sa voix, sa langue, sa parole. J’entends ses mots. Je les entends comme on ne peut les entendre que chez des auteurs dignes de ce nom, chez les écrivains de cœur et d’esprit que sont ces fameux Sinthomes d’ici et d’ailleurs, sinon de toujours. Et cela ne saurait donc me tromper quant à la valeur de son œuvre.
Ce sera donc par ses propres mots que je conclurai ma contribution en citant in extenso « Maintenant » [14], un texte d’une intensité et d’un à-propos tout à fait saisissants au regard de ce que nous vivons en cette ère planétaire de logorrhée digitale abêtissante, texte dont la dimension hic et nunc si fabuleusement benjaminienne ne doit là aussi, j’imagine, rien à ces coups du hasard :
Plus tard, ça n’existe pas. Plus tard, c’est maintenant.
Avant, ça n’existe pas non plus. Avant, c’est maintenant.
Plus tard, c’est maintenant. Bien plus tard, c’est encore maintenant. Et maintenant, c’est maintenant.
Maintenant, c’est là. Là, c’est ici. Ici, c’est proche. Ici, c’est ce qu’on sent. C’est ce qu’on sent à cet instant, précis, dans cette aire, cette vibration, cette présence, cette co-présence, ensemble. Là, c’est nous. Et nous, c’est toujours. Et toujours, c’est maintenant. Et maintenant, ça nous tient. Et maintenant, ça se défait, et se refait, et se redéfait, et se fait d’une autre manière. Maintenant, ça bouge, ça nous tient, c’est ici, pas pour longtemps, mais pour toujours. Maintenant, c’est pour toujours. Et pour toujours, ce sera maintenant. Maintenant c’est pour toujours, plus tard ce sera maintenant.
Nous continuons. Nous allons de l’avant, partant d’un avant qui n’en finit pas.
Et t’en fais pas, on est là. On est là, maintenant, pour un petit moment, un bref moment. Mais ce moment, c’est pour toujours. C’est pour toujours, quelque part, même quand on ne sera plus là. Maintenant, c’est là, c’est en toi et c’est en moi. C’est pour toujours. Quelque part. Car le temps a plusieurs sens. Dans le maintenant, il y a quelque chose qui part, qui disparaît. Dans le maintenant, il y a quelque chose qui est là pour toujours. Car le toujours est dans chaque instant. L’éternité est dans chaque instant.
Dans chaque petit maintenant, il y a quelque chose qui part, et il y a quelque chose qui est pour toujours. L’éternité, c’est quelque chose que nous vivons à chaque seconde. Dans chaque seconde, il y a de l’éternité. Dans chaque seconde, il y a quelque chose qui ne sera jamais pareil, qui disparaît à jamais. Et dans chaque seconde, il y a une éternité.
Nous pouvons sentir l’éternité, elle nous frôle. Nous pouvons sentir l’éternité. Dans notre courte vie, nous pouvons la sentir.
Texte © Caroline Hoctan – Illustrations © DR
Ce texte a fait l’objet d’une première publication dans Freeing [Our Bodies] (n° 11, janvier 2024). Nous en donnons ici une version légèrement corrigée.
Pour lire la présentation du numéro par son éditeur, Yoann Sarrat, c’est ici.
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.

[1] Mathias Richard, Syn-t.ext : amatemp, Paris, Éd. Tituli, 2016, 248 p.
[2] Cf. Colette Soler, « Œdipe, après », Psycha Analyse, 26 septembre 2009, consultable en ligne : « Si la fonction père est fonction de dire, alors elle peut être suppléée, et une vraie suppléance n’est pas une stabilisation, elle change la structure. La preuve par Joyce, que dès 67 Lacan épinglait du nom de diologue, soit un savant mélange de la fonction père, je pourrais dire avec les termes plus tardifs, savant du dire, dieure. Joyce a suppléé par son dire propre, ce pourquoi j’ai dit qu’il a réussi à se passer du Père, en s’en servant ».
[3] Cf. Jacques Lacan, Le Séminaire, Livre 23 : Le Sinthome, sous la direction de Jacques-Alain Miller, Paris, Le Seuil, 2005.
[4] Il faudrait évidemment évoquer bien d’autres auteurs ici, mais je ne cite cette poignée de noms que pour mieux illustrer mon propos concernant Mathias Richard, non pour me lancer dans une étude de fond.
[5] Mathias Richard, Syn-t.ext, op. cit., p. 209 : « Syntexte signifie ‘texte synthétique’, et ce n’est pas uniquement un jeu de mot lacanien avec saint-texte, cela peut s’écrire et se dire de multiples manières significatives : syntext, syntexe, synt.exe, synt.exp, syn-t.ext. On peut ajouter un g pour faire sy(g)n-t.ext, pour accentuer la dimension ‘signe’, ou un h (synth.ect.) pour accentuer le côté synthétiseur ».
[6] Isidore Isou, Traité de bave et d’éternité, éd. Hors Commerce, 2000. Cf. également Frédérique Devaux, Traité de bave et d’éternité d’Isidore Isou, Crisnée (Belgique), Yellow Now, 1994. On comprendra les points communs entre le Syn-t.ext de Mathias Richard et le Traité de bave et d’éternité d’Isou par ce propos qu’y tient ce dernier : « Je crois premièrement que le cinéma est trop riche. Il est obèse. Il a atteint ses limites, son maximum. Au premier mouvement d’élargissement qu’il esquissera, le cinéma éclatera ! ».
[7] Antonin Artaud, L’Ombilic des limbes in Œuvres, éd. établie, présentée et annotée par Évelyne Grossman, Paris, Gallimard, 2004, Quarto, p 105 : « Je voudrais faire un Livre qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n’auraient jamais consenti à aller, une porte simplement abouchée avec la réalité ».
[8] Mathias Richard, Syn-t.ext, op. cit., p. 222.
[9] Mathias Richard, 2020 : l’année où le cyberpunk a percé, Marseille, Caméras Animales, 2021, 66 p.
[10] Mathias Richard, « Cybernétique et confinement : pour une poéscience de la survie », D-Fiction, 15 déc. 2021 : « Les éditeurs professionnels d’aujourd’hui ne font pas leur travail vis-à-vis de la littérature, vis-à-vis d’auteurs tels que moi utilisant l’écriture comme art. Les journalistes et les critiques non plus. Et beaucoup de libraires suivent. C’est toute une chaîne d’incompétences, qui affaiblit le concept même, l’idée même de littérature, et l’exigence liée, au sein de notre société. Tout ça pour avoir en rayon, d’un côté, de la fiction standardisée et commerciale, certes bien ficelée, prête à être adaptée en film ou série, et de l’autre, des « auteurs » influenceurs experts en réseautage, communication, obtention de subventions, résidences, publications et invitations, dont les livres ne sont que des prétextes, des alibis (que personne ne critique) pour être dans ce réseau, ce circuit. C’est le pire à mes yeux, car c’est une falsification de la littérature qui ne dit pas son nom, et qui est légitimée, validée au nom de l’État (subventions, résidences, aides, événements rémunérés, bourses, publications, etc.) et des grandes entreprises (fondations, comités, résidences, aides, événements rémunérés, publications, etc.). Machiavel efface Proust d’un revers de main. Pourquoi est-ce possible ? Parce que tout le monde se fout de la littérature, mais personne ne se fout du pouvoir… Question de valeurs ».
[11] Idem.
[12] Idem.
[13] Mathias Richard, À travers tout (Poetry Strikes Back), Paris, Timbad, 2022, 440 p.
[14] Ibidem, p. 387.
