Je me suis toujours demandé si tout projet d’écriture ne reposait pas simplement sur une disposition physiologique. Jusqu’à l’époque romantique, les auteurs pensaient souvent en termes d’inspiration ou d’enthousiasme, quasi prophétique. La parole était portée par un souffle, un pneuma qui emportait le corps tout entier et formait un horizon d’attente de lecteurs aptes à être eux-mêmes transportés par ces vaticinations.
La littérature, dans le sillage des textes religieux qui en constituent la part maudite, aime prophétiser, et les moralistes du Grand Siècle, dans leur maîtrise oratoire du paradoxe, en sont peut-être les modèles absolus. Avec ce que l’on peut continuer à appeler les temps modernes, l’enthousiasme a cédé le pas à la colère, voire à la révolte. Ce n’est plus porté par une inspiration communicative que l’auteur projette d’écrire, mais par une volonté farouche d’en découdre avec un principe de réalité dans lequel il ne se reconnaît pas ; principe qui pourrait entrer en opposition avec ce plaisir du texte dont parlait Roland Barthes. C’est donc animé par ce que j’estimais être un sentiment légitime de colère que l’entreprise d’écrire un essai contre l’écriture inclusive m’est tout d’abord apparu. Quand le principe de réalité consiste à remplacer sournoisement l’étude de la littérature par l’apprentissage des techniques de communication, ne faut-il pas entrer en guerre ?
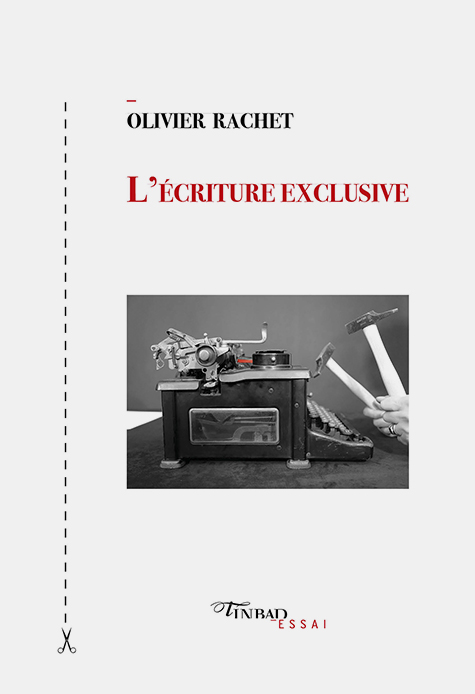
Le processus que j’évoque n’est autre que l’affaissement du français dont j’ai pu mesurer, en tant qu’enseignant de lettres modernes pendant une vingtaine d’années, la rapidité avec laquelle il emportait sur son passage le goût des humanités, la connaissance des différentes strates à partir desquelles le français s’est bâti, et n’a cessé de s’enrichir et d’évoluer. J’avais l’intime conviction que ce que l’on nommait écriture inclusive relevait davantage de l’appauvrissement que de l’enrichissement, de l’instrumentalisation que, disons, d’une poétique.
Le titre initial, sans doute trop polémique ou provocateur – À bas l’écriture inclusive ! – a finalement été remplacé par un retournement que j’espère opératoire. Est-il encore utile de citer la proposition de Guy Debord dans La Société du spectacle ? : « Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux ». Nous y sommes.
Relevant bien plus que d’une simple astuce rhétorique, l’expression même d’écriture inclusive me paraissait relever d’un tour de force, comme il existe des coups d’État qui ne s’appuient pas toujours sur la force armée. Celui de Louis-Napoléon Bonaparte du 2 décembre 1851 consista seulement à conserver le pouvoir qui lui avait été confié en tant que président de la Deuxième République. C’est en laissant advenir les choses que le pire finit parfois par s’imposer. Il en va de l’écriture inclusive comme de l’institutionnalisation de la violence, elle advient sans que l’on n’y prenne garde.
L’analogie que je tisse ici a bien sûr ses limites tant elle pourrait donner à penser que je recours moi-même à un retournement hyperbolique transformant une simple marque graphique en parangon de la tyrannie ! Et pourtant, parler d’écriture inclusive sonnait déjà faux à mes oreilles, comme une déclaration d’intention ou une pétition de principe qui se serait drapée dans des habits trop grands pour elles : ceux d’idéaux républicains, d’égalité notamment, qui n’en demandaient peut-être pas tant !
Que la langue puisse d’autre part servir un projet politique d’émancipation, par nature louable, reste aux antipodes non seulement de ma pratique linguistique, mais de ma conception même de la littérature. Si le projet avait consisté à féminiser les noms de métier et à pratiquer l’accord de proximité, je n’y aurais vu aucun inconvénient. Mais avec l’irruption du point médian, l’orthographe était dès lors mise à mal. L’orthographe, et non l’écriture justement. En parlant de mon côté d’une écriture exclusive, je comptais rappeler la primauté de la littérature et de l’écrit sur la langue parlée, et ramener l’écriture inclusive à ce qu’elle est : une tentative intimidante d’en finir avec la lecture au profit d’une oralisation impossible à enseigner.
Mon essai (Tinbad, 2024), mais dans une dimension volontairement carnavalesque sur laquelle je reviendrai, se situe au cœur de questions relatives aux notions de genre et de neutre qui agitent l’espace médiatique. Ces questions en apparence légitimes me semblent souvent témoigner d’une méconnaissance historique des errements sans fin de la langue et de crispations identitaires qui sous couvert d’ériger la différence (d’orientations sexuelles, d’origines, d’appartenances diverses) en modèle ne font bien souvent que perpétuer un enfermement qui ne dit pas son nom.
Dans son essai Guerre civile des Français sur le genre (On verra bien, 2020), Gilles Magniont montre bien, en lecteur averti des Anciens et notamment de Vaugelas, l’inadéquation entre le marquage grammatical et la question sexuelle. Contrairement aux idées reçues – dont il est toujours de bon ton de se demander par quels idéologues elles ont été envoyées ! –, le Grand Siècle était moins prescriptif qu’on ne le pense, sachant qu’il s’agissait moins d’inciter à ce que le masculin l’emportât sur le féminin qu’à véhiculer le « bon usage » qui était alors celui de la Cour, incluant dit Vaugelas, aussi bien les hommes que les femmes.
A-t-on oublié que c’est en France que, sous le nom de Précieuses, des femmes ont œuvré en faveur d’une connaissance partagée des arts et comme l’a justement montré Molière, que la sottise n’épargne ni l’un ni l’autre sexe ? La question du genre est, en effet, souvent biaisée par une approche clivante et dogmatique qui oppose conservateurs jugés réactionnaires et progressistes autoproclamés les défenseurs de la veuve et de l’orpheline ! S’il fallait montrer patte blanche, comme y invite non sans malice Gilles Magniont dans son entretien sur D-Fiction, j’aurais plutôt tendance à me définir, après Orwell, comme un conservateur de gauche, sachant que l’émancipation ne va pas sans une connaissance de notre passé, fût-il glorieux et pathétique !
Je ne crois pas à une nouvelle querelle futile des Anciens et des Modernes, mais à leur possible dialogue. Pratiquant à mes heures perdues la critique littéraire, je me situe davantage dans cet « espace mouvant et contradictoire » dont parle Sollers au début de Théorie des Exceptions, permettant d’embrasser des temporalités diverses et des individualités antagonistes. Ce que j’appelle littérature est justement la capacité à se mouvoir entre les différents discours de savoir, pour échapper à la fixation dogmatique ; autre visage de ce que d’aucuns nomment l’identité.
Reste enfin la question du Neutre qui est sans doute la moins bien comprise. Il va sans dire que je me situe davantage dans la perspective d’un Barthes qui assimile le Neutre à une oscillation du sens, une quête de la nuance beaucoup plus que dans un militantisme mu par une volonté d’en découdre avec le marquage du Neutre par le masculin. Au final, ce qui m’a animé est sans doute ce plaisir de carnavaliser la langue qui est le propre de la littérature française, depuis Le Roman de Renart ou les romans parodiques de Rabelais ; conscient que l’esprit de sérieux ne sied qu’aux ridicules, fussent-ils ou non précieux !
Texte © Olivier Rachet – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
