Il n’est pas difficile de « pitcher » Les Forces (Le Sous-Sol, 2025), le deuxième roman de Laura Vazquez. Une jeune fille, « bizarre », mal à l’aise dans une famille « normale », dont les parents « adoptent depuis toujours et de manière automatique les comportements socialement adaptés », constate que « le monde va mal ». Une fille contactée sur une application lui donne rendez-vous dans un bar lesbien. Elle se fabrique « ce qu’on appelle un style » pour « se fondre dans le groupe ». Les rencontres qu’elle fait ne dissipent pas son malaise. « De l’extérieur, j’avais l’air de kiffer, mais je me divisais ». On la conduit alors à une « vieille lesbienne ultra-puissante », obèse, qui, depuis une arrière salle, se roule sur un lit immense, et trace pour celles qui se sentent « mal dans le monde » des parcours particuliers. Pour la narratrice, ce sera l’écriture de poèmes. Mais pour cela, il faudra franchir des étapes, faire face à la mort, se libérer des solutions miracles. L’ascension d’une montagne la conduira à un autre rapport au monde.
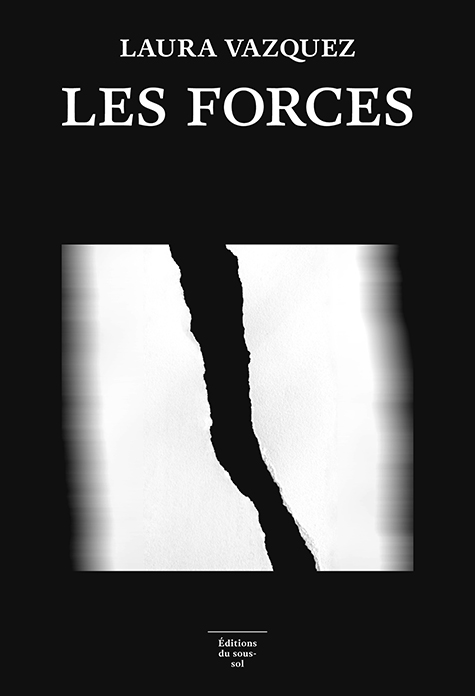
Roman d’apprentissage, annonce le prière d’insérer, tout en précisant que les « motifs » du genre sont « détournés ». On en reconnaît la trame, tout en voyant bien que le résumé proposé plus haut ne rend pas compte de ce qui fait l’originalité de ce texte. L’effet de sidération qu’il produit conduit le plus souvent à s’attacher aux péripéties les plus pittoresques – on n’ose dire anecdotiques – ou à la portée contestataire du discours, sans saisir les enjeux essentiels du roman, que le titre même, Les Forces, appelle à décrypter. Plus que d’un détournement, on s’oriente vers une sorte de décapage du roman, une mise à nu de ses ressorts.
Comme dans Le Livre du large et du long, Les Forces met en question le rapport au monde et au langage. Rapport d’opacité, d’extériorité, vécu passivement, voire dans la crainte, et qui crée chez la narratrice une « douleur […] installée depuis l’enfance ». Elle se résume en un constat : « tout le monde ment ». Sa réponse est l’effacement, la fuite dans la conformité : « Je suis d’accord avec vous, afin que vous ne me tuiez pas » ; « Je me pliais de l’extérieur. À l’intérieur, j’étais abstraite et sans langage et dans la vérité ».
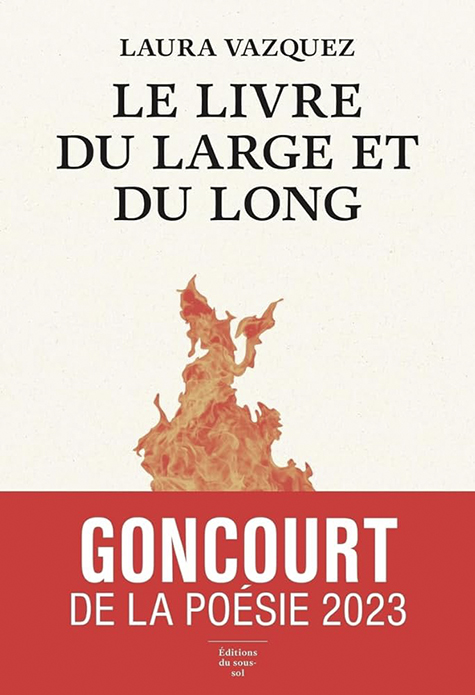
La narratrice, enfouie sous des mots qui ne sont pas les siens, arrive à grand peine à lire le monde et les autres. Elle a pourtant la capacité de percevoir leur douleur, de les soigner en passant « [ses] yeux comme des baumes sur les personnes ». Mais elle n’a pas vécu les expériences qui lui permettraient d’avoir au langage un rapport maîtrisé et apaisé.
Le livre de Laura Vazquez n’est pas un « roman d’apprentissage » au sens classique d’histoire de l’accès d’une adolescente à la maturité. Pas plus le « roman d’une idée » sur la langue et le sujet de l’énonciation. Son originalité est de raconter de front les épreuves qui attendent la narratrice et les effets qu’elles auront sur les mots, les phrases, les poèmes qu’elle produira. En retour, la réparation de ce « quelque chose de cassé dans [ses] phrases il y a longtemps » l’autorisera à dire la tendresse et la simplicité du monde.
Le roman peut ainsi se lire comme cet apprentissage, exprimé dans une langue qui évolue au rythme de son appropriation. Déprise autant que maîtrise : il faut quitter les mots des autres pour ceux où le corps agit et parle. À la toute fin du roman, le constat d’un bonheur possible s’énonce par « Je faisais des phrases avec ma bouche ».
Les Forces est un roman du corps, du langage et de la société. « L’ordre courant » que rejette la narratrice, et qui la nie, est économique, social, linguistique et sexuel. « J’aimais les femmes comme on dit ». Un « comme on dit » où se formule la déviance, « l’erreur mentale », qu’est l’homosexualité. Pour trouver sa place, même dans le groupe où elle a trouvé refuge, la narratrice va adopter les « goûts des autres », dire « des phrases et des pensées dans l’air du temps ». Laura Vazquez montre le corps comme objet à lire, et lieu d’une forme élémentaire d’écriture. « Pour m’adapter, je traçais sur mon corps des signes de malaise », dit-elle, après la rencontre d’une fille timide. « Mes doigts portent des bagues, mes oreilles des boucles, ces signes indiquent : je suis tel type de personne, reconnaissez-moi ».

Inversement, elle lit sur les visages et les corps, prédisant d’après une infime modification de bouche ou de paupière une révolte ou un effondrement. Espace de signes – il y a de véritables mots du corps – il est aussi ce qui jouit, se drogue, souffre, vieillit, meurt. Les dégradations physiques de Claudie, la pythie du bar lesbien ne sont pas passées sous silence. Dans les membres, les os, la peau s’expose une vérité. La narratrice imagine ainsi Nia, la fille qu’elle a rencontrée, dialoguant avec son propre squelette comme avec un oracle. Elle-même ne dit pas ce qu’elle pense d’un « poète qui mangeait de la terre pour ressentir le lien avec la matière » dont elle a lu l’histoire, mais on la retrouve elle-même, à la fin, presque dans la même position : « J’ai recouvert mon corps, il ne restait que mon visage. J’étais la terre finalement. Je faisais des phrases avec ma bouche ».
Reste la poésie. Dans le chapitre central du roman, la narratrice, dont on a remarqué le « vide dans [ses] yeux », est appelée par Claudie : « Il paraît que tu énonces des phrases inattendues », lui dit-elle. Elle l’envoie « dans la niche de celles qui écrivent des poèmes », qu’on nomme « Le mystère et la vérité ». « Il faut que tu te fasses éclater le cerveau », lui dit-on. Le discours de la femme qui l’accueille consiste en un dynamitage en règle des certitudes qu’elle avait en arrivant, et sur quoi reposaient ses premiers poèmes « pas ouf ».
« Personne ne sait écrire un poème ».
Adieu aux envies :
« Aucun poète n’a envie d’écrire un poème », et « Tu ne vas pas vouloir, tu vas te laisser dépasser ». Pas de recette, donc, mais pour guérir « la tare », le mal qui la ronge, « le sentiment d’incomplétude inhérent à l’existence », il faudra cesser de « se croire en dehors », de « voir les choses du dessus ». La consigne est claire : « Il faut que cherches ailleurs ». « Va chez les personnes qui se trouvent près de la mort. »
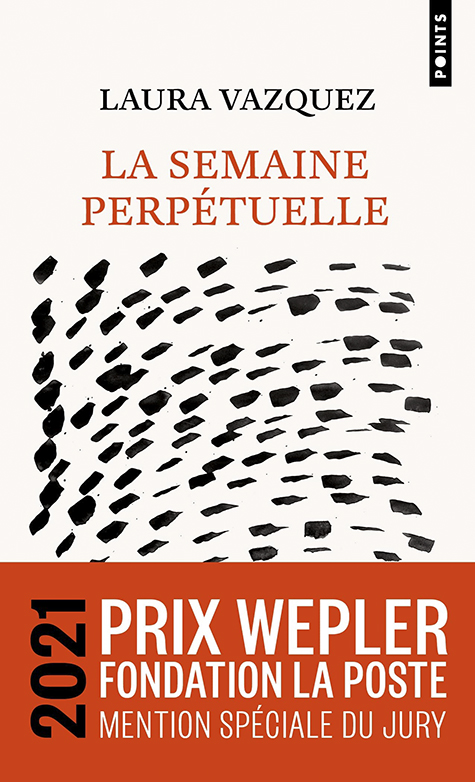
Les épreuves commencent dans la Maison des morts : « Je ne savais pas ce que j’allais devenir », dit la narratrice qui arrive en plein désarroi dans ce qui ressemble à un squat. Elle a brûlé ses papiers, s’éprouve, comme le temps, « cassée », « déboîtée ». Contrairement à La Semaine perpétuelle, la mort n’est pas affrontée dans son horreur concrète. Elle est évoquée, racontée ou représentée symboliquement, comme par ces joueurs de billes qui « meurent à eux-mêmes », en s’annihilant « dans la contemplation d’une sphère parfaite ». Dans la proximité avec les « personnes en train d’essayer de mourir », elle trouve une certaine tranquillité.
Paradoxalement – si l’on excepte au début du roman des scènes de supermarché rappelant là encore La Semaine perpétuelle – c’est dans ce chapitre, que l’on attendrait très abstrait, que le réel, en particulier social, est le plus présent. Il s’incarne ici en un « ancien assistant social » qui expose longuement les mécanismes d’exclusion et le récit illusionniste « mental, économique » du capitalisme qui « détruit le sens du monde ».
La narratrice, sur de vieux journaux récupérés, réécrit des récits tronqués en leur donnant causes et conséquences, les « parce que » et les « donc ». Elle pourra, à l’étape suivante, considérer avec détachement les propositions plutôt comiques des différentes « Sectes diverses unies dans un immeuble ». Elle en retient une sorte de récit condensé de son odyssée, plus ou moins annonciateur de son retour : « alors elle rentre ».
Des péripéties finales, la principale est une ascension. Pour les arbres, les grandes roches et les petites pierres, le ciel, elle a des « pensées fraternelles ». Elle fusionne avec tout cela au rythme de « l’exercice du corps ». C’est au sommet d’une montagne et sans épiphanie glorieuse que s’accomplit l’ultime abaissement de la narratrice, qui s’enterre – comme Laura Betti dans Théorème de Pasolini – pour une fusion qui lui rend la parole. L’itinéraire, avec son passage par l’empire des morts, l’ascension et la réduction à la terre-élément, relève bien du récit initiatique et mobilise ses motifs mythologiques.

Mais Laura Vazquez fait plus que « revisiter le genre », « détourner les codes ». D’abord la narration s’y conforme assez peu. Des épisodes viennent souvent en rompre la continuité, des réflexions, sur les mots, la réalité semblant boucler, avancent en spirale. Il est intéressant, d’ailleurs, de voir avec quelle liberté Laura Vazquez passe de la poésie au théâtre et au roman sans lâcher sa thématique, sans abandonner ce qui la rend instantanément reconnaissable : son énonciation. Faite de phrases brèves, péremptoires, elle alterne entre le constat factuel et la proposition métaphysique. Les citations sont exposées au fil de la lecture, les descriptions sont minimales. Le réel surgit ailleurs, dans des scènes d’un naturalisme puissant, corporel, qui évacuent toute impression d’abstraction ou de fable philosophique. Les « forces » du texte sont peut-être celles qui mettent en tension ces pôles opposés, de même que les forces du récit, entre corps, langage, société et nature, produisent une poétique matérialiste puissante. Ainsi le roman peut se conclure sans naïveté sur la réactivation du souvenir d’un bonheur pour l’espèce humaine.
Texte © Alain Nicolas – Illustrations © DR
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
