ISABELLE ROZENBAUM rencontre IRÈNE JONAS dans un entretien croisé sur leur démarche photographique respective et sur l’ambition de leurs œuvres de faire advenir une image révélatrice :
1 – Isabelle : Irène, tu es une photographe plasticienne française et en parallèle, tu exerces comme sociologue. Je t’ai découverte à travers tes publications et tes expositions, notamment La Valise dans le placard (Galerie Thierry Bigaignon, 2021). Or, certaines de tes séries (Amniotique, Dormir dit-elle, Rosa Bonheur… Réminiscences) ont particulièrement retenu mon attention au regard de leur résonance avec mes propres réalisations photographiques et vidéos, par exemple avec Dormeuses, Chambres d’échos et Insomnies de l’ensemble Image manquante, ainsi que Rêve bleu 1 # Blue Dream et Rêve brun 1 # Brown Dream de l’ensemble Sleeping Works. Interpellée, je t’ai contactée pour te proposer ce dialogue, ce que tu as accepté avec intérêt. C’est ainsi que nous avons convenu d’échanger sous la forme de questions réciproques. Je démarre donc sur ton parcours : pourquoi avoir choisi parallèlement la photographie et la sociologie comme terrains de recherche ? Est-ce pour te sentir légitime de questionner l’Autre et tenter d’avoir des réponses essentielles sur le genre humain avant d’oser exprimer ta vision personnelle ?
On ne peut véritablement parler de choix, mais davantage d’un désir de ne pas abandonner l’une des pratiques pour une autre, et du souhait d’arriver un jour à non seulement les faire cohabiter, mais dialoguer ensemble. L’essentiel de ma vie professionnelle se caractérise davantage comme une forme d’alternance entre la sociologie et la photographie, avec souvent la sensation que l’écriture me vidait alors que la photographie me remplissait. Il y a eu au fil des années des tentatives de construction, comme l’introduction de la photographie dans des rapports sociologiques, mais j’en étais rarement satisfaite. Il faut souligner que dans les années 1980, être sociologue et photographe, ou simplement avoir deux compétences, cataloguait la personne davantage du côté des dilettantes que des « pro ». Le temps qu’il m’a fallu pour exprimer une vision personnelle ne relève donc pas d’une légitimité que mes terrains de recherche m’auraient apportée, mais davantage de la convergence à un moment T entre un ensemble de circonstances personnelles d’un côté, et des évolutions sociales de l’autre. Enfin, il me semble que la pratique sociologique et l’acte photographique me placent dans des états très différents. Lors d’entretiens, même si tu ne perds pas de vue les questionnements qui t’intéressent, tu n’es qu’à l’écoute de l’autre, de façon à pouvoir rebondir, relancer, faire préciser, etc. Tu te fais taire pour mieux entendre l’autre. Au cours des prises de vue, en tous cas celles que j’ai faites pour Crépuscules (2002), si je me taisais, c’était pour mieux m’entendre. D’où la difficulté, voire l’impossibilité, à faire coexister exactement au même instant démarche sociologique et photographique. Dans le livre Mémoires de campagne (2022) qui regroupait une étude sociologique menée dans le Perche et un travail de photos peintes lors d’une résidence au Champ des impossibles, j’avais fait le choix, d’abord de mener l’entretien, puis de faire les photographies, soit sur le lieu lui-même soit sur le chemin du retour. Le lien entre l’image et la parole de l’autre pouvait ainsi s’éloigner de la pure illustration pour se rapprocher d’une évocation de ce que les mots de l’autre avaient produit chez moi.

2 – Irène : Je commencerai par aborder ce qui nous distingue dans le point de départ de nos parcours qui néanmoins convergent. Tu soulignes que ce sont des autoportraits qui t’ont littéralement mise en face de cet « au-delà » que représentait l’extra-ordinaire de l’intimité, qu’ils te dévoilaient de toi-même. Je me sens autant étrangère qu’admirative de cette pratique… Pourrais-tu évoquer ce choix qui s’est poursuivi dans nombre de tes séries?
Est-il possible de concevoir qu’ « au commencement » était le visage, et que ce « n’était que solitude et chaos » ? Photographier le mien a été une nécessité d’introspection de ce moi – autre qu‘idéal – qui jusqu’alors, me paraissait invulnérable, mais ne me renvoyait – à vrai dire – qu’un piteux reflet de souffrances étouffées, et de tristesse infinie. Pour expérimenter toutes les sensations et émotions brutes que je pouvais ressentir, j’ai donc commencé à photographier mes différentes facettes aux maquillages outranciers, au rythme de Earth Died Screaming. Je me suis jetée littéralement en pâture devant l’objectif au risque d’y percevoir bien autre chose de ce que j’imaginais ou contrôlais. Mais, j’ai eu peur : peur de toutes ces bouches rouges criantes et putassières que je dessinais, peur de tous ces regards perçants, violents et mélancoliques que j’enregistrais, au point de décider – à la vue de l’un de ces autoportraits perturbateurs du réel – que ce serait le dernier. Je me suis donc censurée… Par la suite, certains photographes travaillant sur la question de l’intime – tels que Dieter Appelt, Lee Friedlander, John Coplans ou Friedl Kubelka – m’ont aidé à nourrir ma réflexion sur le sujet tout comme les peintres Francis Bacon et Alexej von Jawlensky, et en particulier les œuvres de ce dernier intitulées Méditation (peintes en 1936) que j’ai découvertes lors d’une exposition en Arles. Admirer ses toiles méditatives les yeux fermés fut un véritable choc esthétique et cosmique. J’ai alors repris mon projet initial, mais cette fois, les yeux clos. J’ai commencé à photographier frontalement mon visage et en gros plan. Puis, après avoir composé sur ma peau de véritables visages éphémères colorés de pigments purs, je shootais à l’aveugle, l’appareil photo à bout de bras, et cadrait habilement mon visage après de multiples essais. Mon nouvel enjeu était de faire apparaître ce qu’il y avait de plus intime, de moins superficiel, sans avoir recours à la toute-puissance du regard, et de défaire tout jeu social, toute identification, toute séduction, toute agitation à travers ces Automorphoses. Était-ce à nouveau une illusion de ce moi ? Par la suite, j’ai construit un sténopé, appareil pauvre par excellence, puisque je l’ai fabriqué à partir d’une simple boîte en carton peinte de noir à l’intérieur, et d’une ouverture à la taille d’un trou d’épingle pour laisser entrer la lumière. J’avais le désir qu’un observateur neutre m’observe, me capte endormie une nuit entière pour qu’une image puisse s’inscrire sur le négatif, ce qui paradoxalement m’aidait à m’endormir. Je l’ai vécu comme un jeu entre apparition et disparition sur la surface sensible, tout dépendait de la sérénité et du mouvement de mes nuits. Être objet et sujet, à la fois, me semblait étrange ou étranger, mais cet objet rudimentaire posé sur mon lit ne m’apparaissait aucunement intrusif comparé à un appareil photo professionnel. Ces sommeils particuliers et ces visages révélés sur le papier photo m’ont amenée à rêver davantage, voire quelquefois, à cauchemarder de mort-nés, d’embryons fantomatiques me remémorant alors, un souvenir enfoui de ma vie prénatale en compagnie d’un jumeau, malheureusement mort bien avant terme. Est-ce pour cette raison que « l’image manquante » me préoccupe tant, et depuis si fort longtemps ?
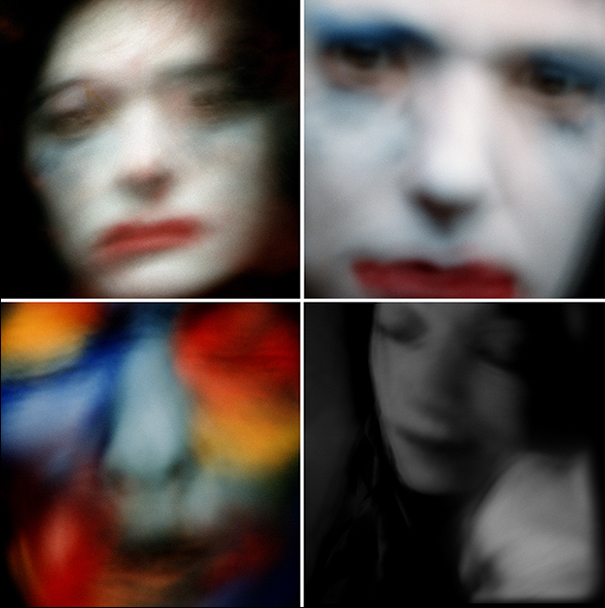
3 – Isabelle : Une des approches que nous avons en commun, pointe la préoccupation de l’élément eau, voire l’amniotique, que tu interprètes dans nombreuses de tes séries photographiques. Pourrais-tu m’expliquer ce besoin tel que tu l’écris : « Il y a, sous l’eau, comme une régression aussi douce qu’angoissante. Au rythme des vagues qui s’échelonnent à la surface, oscillent l’envie de se laisser bercer et la peur d’étouffer. La mer se fait alors refuge ou linceul tour à tour accueillante ou menaçante ». Les visages des personnes que tu photographies sont généralement vus de dos, presque effacés, fantomaux ou absents, mais jamais frontaux. Que désires-tu suggérer, ou faire naître ainsi ?
Pour répondre à la première question, il me semble que se laisser aller à mettre la tête sous l’eau sans peur, constitue un passage initiatique. Mais au-delà de ces prouesses enfantines, peut-être seule la mer procure-t-elle cette sensation d’être sur le fil du rasoir entre bien-être et cauchemar, douceur et violence, vie et mort. Tout pouvant basculer soudainement dans l’autre extrême. Ne dit-on pas « être sous l’eau » ou « avoir la tête sous l’eau » lorsqu’on est débordé, ou pris de court, n’utilise-t-on pas également l’expression « sortir la tête de l’eau », lorsqu’on arrive au terme d’une situation pénible. Ces expressions font référence à l’image de ne plus pouvoir respirer, voire d’être noyé et de ne pouvoir respirer à nouveau qu’une fois à l’air libre. Quant à l’idée d’être submergé, elle évoque la vague qui envahit et impose sa force en nous recouvrant totalement. Mais l’on parle aussi d’ « être heureux comme un poisson dans l’eau ». Car finalement, pour toutes et tous, il s’agit bien de « se jeter à l’eau », au propre et au figuré, pour son plus grand bonheur une fois l’appréhension passée. En ce qui concerne ma façon de photographier les gens, il me semble que la plupart de mes choix sont issus d’une contrainte. Si éviter la frontalité a d’abord été lié au problème grandissant que pose le droit à l’image, elle s’est finalement révélée correspondre à une sensation d’être au monde. J’ai toujours eu l’impression d’être derrière, derrière des personnes qui s’éloignent, derrière l’histoire avec un grand H. Petite, on évoquait autour de moi une guerre que je n’avais pas connue, adolescente j’entendais parler d’un Mai 68 pour lequel j’étais trop jeune pour y participer, adolescente je m’incrustais toujours dans groupes de personnes plus âgées que moi et d’une façon générale, dans ma vie d’adulte, je courais derrière le savoir de mes aînés. Photographier les gens de dos, c’est garder une vision enfantine de silhouettes qui s’éloignent sans pouvoir les rattraper. C’est peut-être aussi éviter l’absorption par le regard de l’autre et la frontalité de son visage pour laisser une plus grande part à l’imagination… une sorte d’envers du décor.

4 – Irène : « Les yeux clos », « shooter à l’aveugle », « être captée endormie par un observateur neutre », sont autant de termes que tu viens d’évoquer et qui renvoient à une forme de sommeil ou d’absence lors de la prise de vue. Et pourtant ton travail qui est réuni sous un thème État de veille évoque davantage une notion de vigilance au monde, même si la mise en scène de la série Antichambres suggère un personnage assoupi qui s’en extrait. Peux-tu développer cette antinomie que l’on trouve dans ta démarche (en est-ce vraiment une ?) entre sommeil/veille, s’extraire/observer, abandon/acuité ?
Ces termes que tu évoques dans le début de ta question font précisément référence aux séries Automorphoses et Dormeuses tout en appartenant au thème Image manquante, et non à État de veille. Ces deux thèmes sont totalement différents puisque, concernant le premier, il s’agit d’intime, et concernant le second, d’extime. Mon regard est forcément « autre » selon que je dois explorer mon existence, ou bien soulever des problématiques sociétales, éthiques ou environnementales (ses marges, ses dimensions cachées, ses subjectivités inconscientes, ses disruptions…). Dès le début de mes séries photographiques, utiliser mon propre corps comme matériau vivant a été un défi, tant vis-à-vis de ma conscience aiguë de la mort que de l’abîme, comme si, réaliser des autoportraits les yeux fermés, allait me permettre d’accéder à d’autres réalités alors même que mes premiers autoportraits les yeux ouverts, se révélaient laids, moroses, voire mortifères. Néanmoins, j’ai poursuivi ce cheminement en confiance, faisant petit à petit le tri de toutes sortes de pensées et d’images conditionnées, stéréotypées, mais surtout autocensurées. Concernant la série Dormeuses, l’intention d’utiliser mon sténopé posé sur le lit tel un regard neutre qui enregistrait mon visage endormi, a été un acte tout à fait délibéré, mais sans attente définie afin que l’œuvre se fonde elle-même, tout en jouant pour ma part le rôle de ce « regardeur regardé » métaphysique (cf. Pierre Alechinsky, Regardeur regardé), sinon quantique d’ « observateur observé » (paradoxe de Wigner). C’est donc différent du regard neutre méthodique – tel que l’a si remarquablement filmé Wim Wenders dans The End of Violence et que j’ai proposé à ma manière dans 2020 : A Viral Odyssey – concernant ces caméras de surveillance qui enregistrent sans distinction l’espace public ainsi que les us et coutumes de la population, cette dernière n’ayant jamais connaissance des exploitations de données, ni de leur historicisation. Mais une question s’impose alors à nous : existe-t-il vraiment un regard neutre ? Déjà en 1977, Susan Sontag soulève cette question d’usages de l’image dans Sur la photographie (trad. 1982) :
La photographie a des pouvoirs dont aucun autre système de fabrication d’images n’a jamais joui, parce qu’à la différence de ces systèmes antérieurs, il ne dépend plus de celui qui fabrique l’image.
Le thème État de veille est né d’une vision hypercritique et biopolitique développée depuis la mort de mon père, au regard de ces guerres intestines mondiales, qu’elles soient économiques, hégémoniques ou technologiques. Ainsi, la série Antichambres revendique un mode de vie en relation avec notre biotique, loin du stress, de la fatigue et du désespoir. On y voit un être allongé au milieu de la foule et dans des lieux insolites à la manière dont le propose Protagoras :
L’homme est la mesure de toute chose : de celles qui sont, du fait qu’elles sont ; de celles qui ne sont pas, du fait qu’elles ne sont pas.
Cette attitude est une façon de témoigner qui, elle-même, suscite une nécessité de déconstruire les récits qu’on nous impose, non pas en se basant sur les dualités que tu cites, mais par un mouvement subtil qui se manifeste entre ces dichotomies, nous interrogeant ainsi, jour et nuit, sur le sens de notre propre présence au monde, mais aussi sur cette présence à laquelle il nous faut donner un sens, si possible non duel et qui sorte des sentiers battus…

5 – Isabelle : Nous avons, toutes deux, des travaux en commun intitulés Insomnies, même si tu as changé finalement le titre de ta série au moment de publier Dormir dit-elle (2018), titre qui est un hommage à Marguerite Duras. Pourrais-tu nous éclairer sur ce qui, à la fois, a fait ombre à tes nuits agitées et a nourri ton imagination ? Est-ce ton histoire familiale liée au Désastre qui sollicitait un surcroit de vigilance, une écoute silencieuse, ou encore une manière de contourner ou d’affronter, pour toi, ce qui est de l’ordre de l’indicible ? Peindre sur tes originaux photographiques n’est-il pas une manière de faire émerger ou immerger quelque chose – mais quoi exactement ? – dans ces « sur-images » (cf. Annie Le Brun & Juri Armanda, Ceci tuera cela : Image, regard et capital, 2021) ?
D’aussi loin que je me souvienne, le sommeil et moi n’avons jamais été très liés. Je le fuyais autant qu’il me fuyait. Rétrospectivement, je pense même que la perspective d’un réveil sonnant tous les matins à la même heure – après des nuit perturbées – m’a rapidement dissuadée d’aller vers un travail salarié, aux horaires réguliers. La nuit, bien à contre-cœur, s’est inscrite comme le moment d’une nécessaire vigilance. S’y est glissée une mémoire d’un autre temps, des non-dits, des crises familiales, puis des morts. Cet état de « qui-vive » n’est heureusement pas le seul qui a peuplé ces moments de veille car, dès lors que s’estompe l’angoisse du lever le matin, ces moments nocturnes peuvent devenir d’une grande richesse. Souvent, ils m’ont offert la solution à un problème, à la construction d’un article ou simplement au démarrage d’un nouveau projet. Pour répondre à ta seconde question, je me suis peu interrogé sur les raisons qui m’ont rapidement conduite à avoir envie de peindre sur mes photos. Le déclic en a été une photographie de Jan Saudek que j’ai découvert lors d’une exposition dans les années 80. Elle représentait un enfant assis sur un passage à niveau pendant le passage d’un train à vapeur. Ce cliché n’est pas représentatif de l’ensemble de son travail, mais elle a eu un écho qui se prolonge encore aujourd’hui en moi. Jan Saudek disait qu’une photographie devait « couper le souffle » avec quelque chose de complètement nouveau, j’ai juste pensé devant cette image que j’aurais aimé faire plus que toute autre, et j’ai commencé à peindre mes photographies. Je connaissais, bien sûr, ces vieilles cartes postales noir et blanc travaillées à l’encre de chine ou ces anciens portraits de famille retouchés, mais sur cette image, l’ajout de la couleur s’éloignait d’une volonté d’ajouter du réalisme à une photographie noir et blanc, pour devenir onirique. Je supposais qu’il l’avait rehaussée avec des encres. J’ai alors passé des heures à tester sur des tirages noir et blanc les différentes façons d’y ajouter de la couleur. Essais d’encres, de pastels, d’acryliques, pour finalement m’arrêter à la peinture à l’huile extrêmement diluée. Parfois, une série que je pense achevée peut rester en noir et blanc dans un placard, des mois, voire des années. Mais elle ne prend véritablement vie que le jour où je décide de sa tonalité. Un peu comme s’il y avait de l’inachevé tant que je n’y avais pas apposé mes couleurs rêvées. Ce n’est qu’au moment où je peins sur mes originaux que l’histoire se raconte, que je quitte une thématique pour entrer dans une narration et une forme de musicalité. Quelque chose commence à ce moment précis. Je pourrais comparer cette situation à une autre que j’ai vécue dans l’écriture d’articles ou de livres sociologiques, ce moment où tout ce que tu as réalisé comme entretiens, ce que tu as lu, toutes tes notes et esquisses de plan que tu as accumulées, s’articulent dans un mouvement que tu ne maîtrises pas vraiment jusqu’à constituer un déroulé fluide. En dehors de cela, il y a probablement un désir de mise à distance du présent et de la réalité des couleurs ou lumières. Un peu comme s’il fallait que je laisse s’effacer les teintes originales pour ne garder que les impressions du moment et pouvoir poser les couleurs de mes souvenir sur les photos. Une façon de faire silence sur le monde tel qu’il apparaît sur la pellicule pour le réinterpréter.
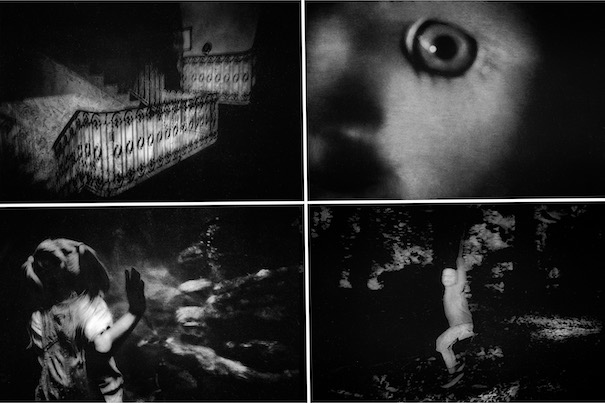
6 – Irène : Il me semble que dans Automorphoses, tu transformes aussi la photographie non par un ajout de peinture sur l’image, mais par un ajout de temps de pause ? Ce temps qui permet de passer de l’auto-portrait à l’auto-rêvé, même si cela t’a ensuite conduit à revenir au noir et blanc pour les Dormeuses, mais toujours avec cet ajout du temps ou de la proximité. Ce n’est pas seulement de cette série que je souhaitais que tu me parles, mais de Les Sélavy sous influence, au-delà de l’allusion clairement énoncée à Rrose Sélavy, et donc à Marcel Duchamp, le choix de ton titre évoque instantanément le film de Cassavetes, Une femme sous influence. Est-ce un hasard ?
La plupart de mes séries sont effectivement habitées d’un rapport étroit avec la notion de temps et d’anachronismes de la mémoire comme l’a si bien pensé Walter Benjamin. Mon processus photographique ressemble à un vrai chantier diachronique, à une fouille de vestiges intergénérationnels, matériels ou immatériels, imprégné très vite, lui-même, par un sentiment intérieur de cette « image manquante ». Un jour ou bien une nuit, une image oubliée de mon enfance a surgi de ma conscience, et ainsi, m’a permis de mettre du sens et du lien entre toutes les photographies et vidéos que j’avais réalisées auparavant. Pourtant, j’avais la sensation que cette image en cachait une autre sous-jacente. Malgré cette impression tenace, peu à peu, chaque série photographique s’est imposée d’elle-même, et impose sa forme avec son souffle, son sujet avec son rythme, ses désastres avec ses désillusions, impliquant le temps psychique et le temps du rêve. D’ailleurs, j’ai récemment eu un rêve qui m’a quelque peu interpellée : il m’était dit qu’il fallait que je me prépare car on allait changer de monde du jour au lendemain. Je l’ai interprété comme un glissement temporel, un véritable défi face à un nouveau rapport au réel. Cinq années auparavant, déjà angoissée de sentir une accélération, ou une désynchronisation de l’horloge commune, je me suis mise à écrire, comme si écrire rendait manifeste le présent par-delà l’espace et le temps, et par incidence, mes photographies se sont enrichies de cette nouvelle expérience. À ce jour, j’ai conçu une sorte de biofiction intitulée Rozebud, en étroite relation avec le rosebud d’Orson Welles, sous la forme de 99 textes en regard de 99 images issues de mes réalisations photographiques et documents d’archives familiales. Concernant la série Les Sélavy sous influence, j’ai rencontré un jour dans une boutique de lingerie, un homme intrigant et singulièrement vêtu. Après quelques échanges, je lui ai laissé ma carte de visite au cas où il désirerait me joindre pour être photographié. Peu après, il me contacta et adhéra au projet photographique que je lui proposais, mêlant les différentes facettes qu’il revendiquait publiquement, à l’image de celles de Rrose et de Marcel Sélavy. Il l’accepta comme un jeu, curieux de voir et de se voir représenté dans un double mouvement, entre ciel et terre selon la symbolique de l’Arbre des Séphirot (Arbre de Vie), telle une dynamique de création en lien avec le monde matériel et le monde spirituel. Cela m’a alors permis de mettre en scène différents aspects de notre être, de ses métamorphoses « sous influence », des forces qui nous échappent, d’où le rapport indirect que tu fais – j’imagine – avec le film Une femme sous influence. Dans une certaine mesure, ce n’est peut-être pas un hasard. J’ai moi-même été influencée et inspirée très jeune par la liberté de regard incisif de John Cassavetes sur les événements ordinaires que sont le mariage, l’infidélité, le divorce, l’amitié, le deuil… Cassavetes a examiné les affects de la classe moyenne comme on pourrait examiner un microbe ou un virus au microscope. Ce film, en particulier, nous saisit par sa puissance viscérale sur la vie d’un couple en crise, et notamment, sur celle du personnage de Gena Rowlands jouant une mère qui essaie de se libérer des « influences » qui l’étouffent, que ce soit celles de son quotidien, de sa famille et de son entourage. Certains la jugent folle parce qu’un peu perturbée et excessive, mais surtout parce qu’elle ose remettre en question, plus ou moins consciemment, les habitus, la morale, la bien-pensance sociale, mais également, les valeurs traditionnelles de la famille avec une terrible interrogation, à la fin du film, sur le trauma refoulé dont elle est atteinte, et qui a à voir avec sa relation – sans doute incestueuse – au père. Pour ma part, j’ai visionné de nombreuses fois ce film. Même s’il provoque un état de malaise profond, il nous fait bien comprendre les refoulements, la servitude et l’oubli de soi en tant que femme dans la société patriarcale, hétéronormative et politically correct, avec toutes les conséquences collatérales que cela engendre… depuis des temps ancestraux.

7 – Isabelle : Ton nom de famille Jonas m’intrigue. En effet, par rapport à la plupart de tes sujets ou titres photographiques impliquant l’élément eau – Tempêtes, Amniotique, Pêche à terre, Plages de la Baltique, Le Vaisseau fantôme, Débarqués – il semble résonner avec l’histoire biblique de Jonas, jeté à la baleine par les matelots qui le tiennent responsable de la tempête. Peux-tu m’expliquer si la trame jonasienne a un lien à ton inspiration et à tes obsessions aquatiques ? Lors de l’exposition Les Tempêtueuses (Galerie La Chambre claire de Douarnene, 2022), il est notamment dit que : « Irène Jonas est à l’écoute des tempêtes comme à celle des gens dans sa quête de sociologue. L’esthétique est toujours présente, comme une consolation de l’indicible ». Jusqu’à quel point donc tes œuvres s’inspirent-elles de ce mythe, et si oui, comment ? Ton titre, Les Tempêtueuses, joue d’ailleurs sur les termes « tempétueux » et « tueuses ». Comment l’expliciterais-tu ?
Ce qui est plaisant dans nos échanges, ce sont les interrogations qui naissent de tes questionnements. Je n’avais jamais fait le lien entre Jonas et mes « obsessions aquatiques ». Je ne sais s’il existe réellement, mais l’image me plaît. Il y a dans ce nom de la désobéissance, de la culpabilité, la tempête, le ventre de la baleine, mais aussi, une traduction : la colombe. Il y a bibliquement la notion de repentir, mais étant profane, je peine à l’intégrer. C’est aussi le nom d’un syndrome, le syndrome de Jonas, qui dans un premier temps a été théorisé par Abraham Maslow pour être, finalement, repris par la vulgate du développement personnel en entreprise afin de définir les individus qui souhaitent réussir en ayant peur que cela arrive. Je refermerai vite la porte du développement personnel, la sociologue Eva Illouz a merveilleusement bien décrit ces dérives de la réussite psychique générée par l’idéologie méritocratique. Pour revenir à ta question, consciemment, je ne me suis absolument pas inspirée de ce mythe. Je me souviens juste que l’exclamation « Ah, comme la Baleine ! », qui ne manquait de fuser chaque fois que je prononçais mon nom de famille, m’a progressivement obligée à rétorquer : « Non, comme le prophète… ». Quant aux tempêtes que j’ai été photographier dans ce port du Finistère sud, leur violence exacerbe le sublime et l’angoisse. J’ai déjà évoqué cette double dimension de douceur et de danger que peut représenter le fait de mettre la tête sous l’eau, la tempête si belle à contempler fait, elle, planer la menace d’être submergé. Mettre la tête sous l’eau relève d’un choix personnel, la tempête nous met en face d’une puissance que nous ne pouvons maîtriser et qui peut nous submerger. En caricaturant, je pourrais dire que l’on ressort grandi d’avoir réussi à nager sur l’eau et tout petit face aux colères de Poséidon. Enfin, ces tempêtes qui ont existé de tout temps sur l’océan ne sont pas sans prendre une dimension particulièrement « tueuse », compte tenu du réchauffement climatique et de la montée des eaux.

8 – Irène : Si l’eau apparaît comme un fil directeur dans beaucoup de mes séries, il me semble que le nombre et les nombres ont une grande importance pour toi. Dans Banquets d’enfer, on ne peut être que frappé par le nombre de verres et d’objets sur la table. Dans Insummabilis, la conception de ta série détaille la récurrence visuelle. L’énumération, la répétition, le découpage dans le temps et du temps, la notion d’image manquante (moins une) font également partie de ta démarche, peux-tu m’en parler ? La série Insummabilis m’a beaucoup troublée… Elle renvoie à ces jeux enfantins des « Sept erreurs » ou à celui de « Trouver l’intrus », obligeant à regarder attentivement chaque photographie alors que l’ensemble, excepté une seule, est exactement identique. À plusieurs reprises, j’ai été obligée de bien regarder ces mêmes visages, plutôt que de les survoler pour en repérer « l’intrus ».
Les nombres et leur symbolique ont fasciné, depuis la nuit des temps, de nombreuses philosophies et sciences comme pouvoirs d’interprétation, d’association, d’organisation et de représentation, mais aussi, comme « lois de création ». Pour ma part, je suis captivée par le déchiffrement du monde à partir des nombres, des combinatoires, des permutations et des labyrinthes. Je pense que la lecture des œuvres de Georges Perec, de Jorge Luis Borges, de Roland Barthes, ou encore, de Philip K. Dick, ont contribué fortement à l’intérêt que je porte à cette symbolique des nombres. Il y a vingt ans, lors d’un voyage en Israël, j’ai découvert la ville de Safed – la plus haute du pays – mais également, l’une des quatre villes saintes. En la visitant, contre toute attente, j’ai eu un coup de coeur pour un carré magique exposé dans une galerie qui représente un ordonnancement de dix colonnes et dix lignes dont chaque case contient une lettre hébraïque. Je n’ai pu faire autrement que de l’acquérir, mais sans raison particulière, sinon celle d’une certaine « hypnose ». Pendant des années, il est ainsi resté accroché au mur de mon atelier sans que je ne m’en préoccupe, même si j’avais un certain plaisir à le voir. Et un beau jour, j’ai voulu connaître la signification de l’addition de la valeur numérique de ses lettres, telle que la gematria le propose. J’ai donc étudié les lettres que ce carré contenait et les ai interprétées par la valeur du nombre qu’elles représentent chacune. C’est à ce moment-là que la vie des nombres a fait partie intégrante de mes recherches, et en particulier, le nombre 23, qui symbolise cette lettre devenue manquante dans la Torah, et invisible pour nous et dont les kabbalistes affirment qu’elle ne réapparaîtra que dans une prochaine période terrestre. Ainsi, pour les uns, le nombre premier 23 serait la somme des valeurs ordinales des lettres Aleph (1) et Tav (22), et serait donc intimement lié au « commencement » et à la « fin » de toutes choses. Le nombre 23 est ainsi devenu pour moi un véritable stimulant pour mon imaginaire car toutes les symboliques étant présentes dans les 22 lettres de l’alphabet, le nombre 23 correspondrait à une autre dimension, une autre étape, voire une autre vision de la réalité. D’où le projet photographique Image manquante – cette image métaphysique des origines – sous la forme d’un carré magique comprenant 23 séries photographiques autonomes et combinatoires (529 photographies au total). Les photographies des séries Banquet d’enfer et Insummabilis auxquelles tu fais allusion, mais aussi des séries La Danse Transmacabre, Le Ça, Alter Ego, Hantologie, travaillent effectivement sur l’anachronisme du temps et des temps et ses décodages, que ce soit donc sur des sujets intimes ou familiaux, ou bien au sujet des cycles de l’incarnation humaine sur terre. Pour le nombre 9, s’il m’intrigue, c’est parce que mon nom de famille possède 9 lettres. Ainsi, deux séries ont émergé à partir de ce chiffre : Automaton et Portrait de l’artiste en notices bio qui ont pour enjeu de questionner le rapport aux identités multiples tel que le décrit l’écrivain italien Claudio Magris :
[…] les identités ne peuvent jamais être photographiées, c’est-à-dire définies, mais devraient toujours être « cinéma-tographiés », car elles ne sont pas statiques, mais dynamiques, elles bougent, changent et se transforment au fil du temps.

Depuis quelques années, pour constituer ce processus photographique combinatoire, à savoir de ce que peut encore une image artistique et dialectique (Walter Benjamin) face aux images conversationnelles ou testimoniales (André Gunthert), j’ai fait le choix de ne pas exposer mes séries séparément, en attente de la totalité constitutive du carré magique. Avant d’exposer cet ensemble in situ, il est néanmoins visible en ligne sur la plateforme collaborative où nous nous échangeons aujourd’hui. En parallèle à mes travaux, je poursuis une réflexion sur le défi de l’image virtuelle et l’enjeu de la photographie plasticienne à l’heure des outils d’intelligence artificielle qui génère des images à partir de textes. Je pense inévitablement au théoricien de l’art et psychologue, Rudolf Arnheim qui écrit en 1969 dans La Pensée visuelle (trad., 1976) que « percevoir visuellement, c’est penser visuellement ». Il montre que les deux systèmes cognitifs (système intuitif et système de la faculté de pensée) communiquent en association, en symbiose, et non pas en dissociation, en dichotomie, ou en dualité, car la « pensée productrice » ne peut exister sans sa composante perceptive. Un questionnement s’impose alors à moi à propos de l’importance croissante des recherches sur l’intelligence artificielle : lorsqu’on se sert de l’AI pour réaliser des images à partir de mots clés choisis, ne s’arrête-t-on pas, en définitive, à ne « voir » qu’une image générique, reconnue ou conditionnée par les schémas normatifs dans lesquels nous vivons ? Ou bien alors, l’AI ne pourrait-elle pas « perce-voir » une image autre qu’artificielle et qui se révèlerait à nous par une intelligence non plus « artificielle », mais plutôt organoïde (IO) ?
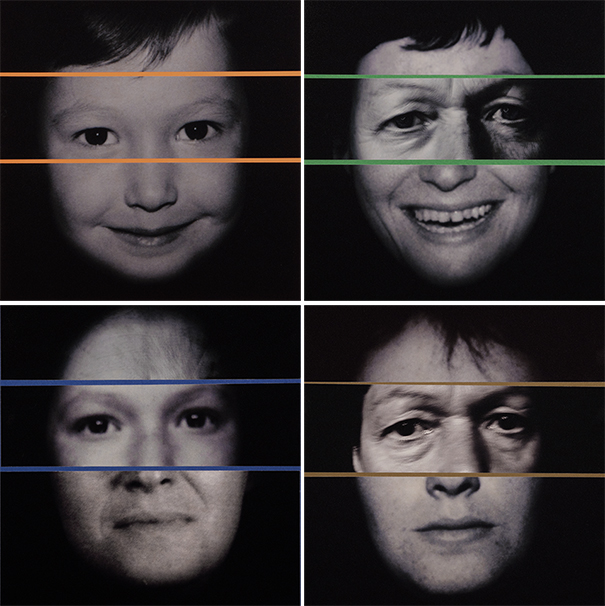
9 – Isabelle : Sony World Photo Award vient de récompenser une photographie de l’artiste berlinois Boris Eldagsen générée par l’intelligence artificielle. Cela change-t-il pour toi quelque chose dans ton approche de la photographie ? Comment vois-tu l’évolution de la photographie plasticienne, notamment par rapport à ta propre création, à ta propre pratique, dans les années à venir ?
C’est probablement avec ce genre de questionnement que je me sens le plus clivée entre mes deux métiers. Quand on parle d’IA, il me semble difficile de se limiter à la photographie, et au secteur culturel, sans tenter de comprendre l’impact considérable que cela va avoir au plan éthique, social et économique pour l’ensemble de la société. Serge Abiteboul, informaticien et chercheur à l’ENS écrit ainsi en 2018 :
Le monde numérique s’est développé si vite qu’il en est encore au stade du western : les injustices foisonnent, l’État ne comprend pas assez bien pour légiférer correctement, et les citoyens sont perdus.
En ce qui concerne la photographie, l’IA semble être, aujourd’hui, au cœur des débats comme lors du congrès CEPIC ou du Parlement de la photographie. Les divers articles de Gilles Courtinat, constituent également une bonne base de réflexion, de mise en perspective des questionnements et de recensement des réalisations. Quel rôle cela jouera dans ma propre pratique ? Franchement, je l’ignore encore, mais il y a une certaine excitation à penser que ce que l’on exprime par des mots puisse se traduire directement en images, puis être affiné par d’autres mots jusqu’à un résultat qui correspondrait à mon attente. Il y a là, de fait, un nouveau terrain d’expérimentation qui se profile. Je crois que je suis assez lente, et pour le moment j’observe. Je tourne autour sans savoir si je m’en emparerai… ou pas !

Texte & Illustrations © Irène Jonas & Isabelle Rozenbaum
(Paris & Bordeaux, 2022-2023)
Si vous avez apprécié cette publication, merci de nous soutenir.
